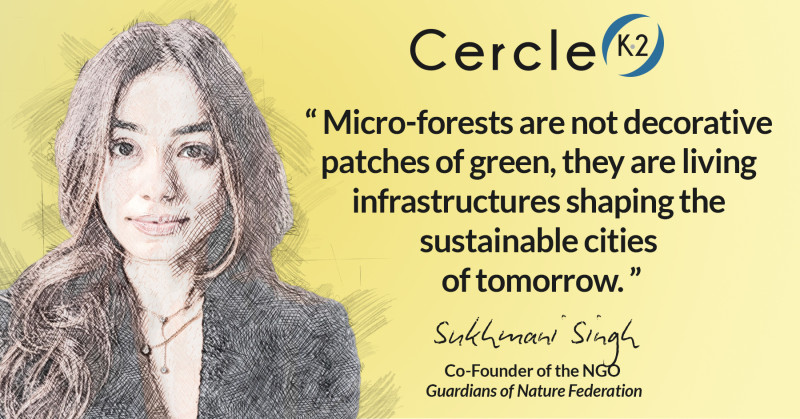Les micro-forêts : un outil politique essentiel pour un urbanisme résilient
14/11/2025 - 7 min. de lecture
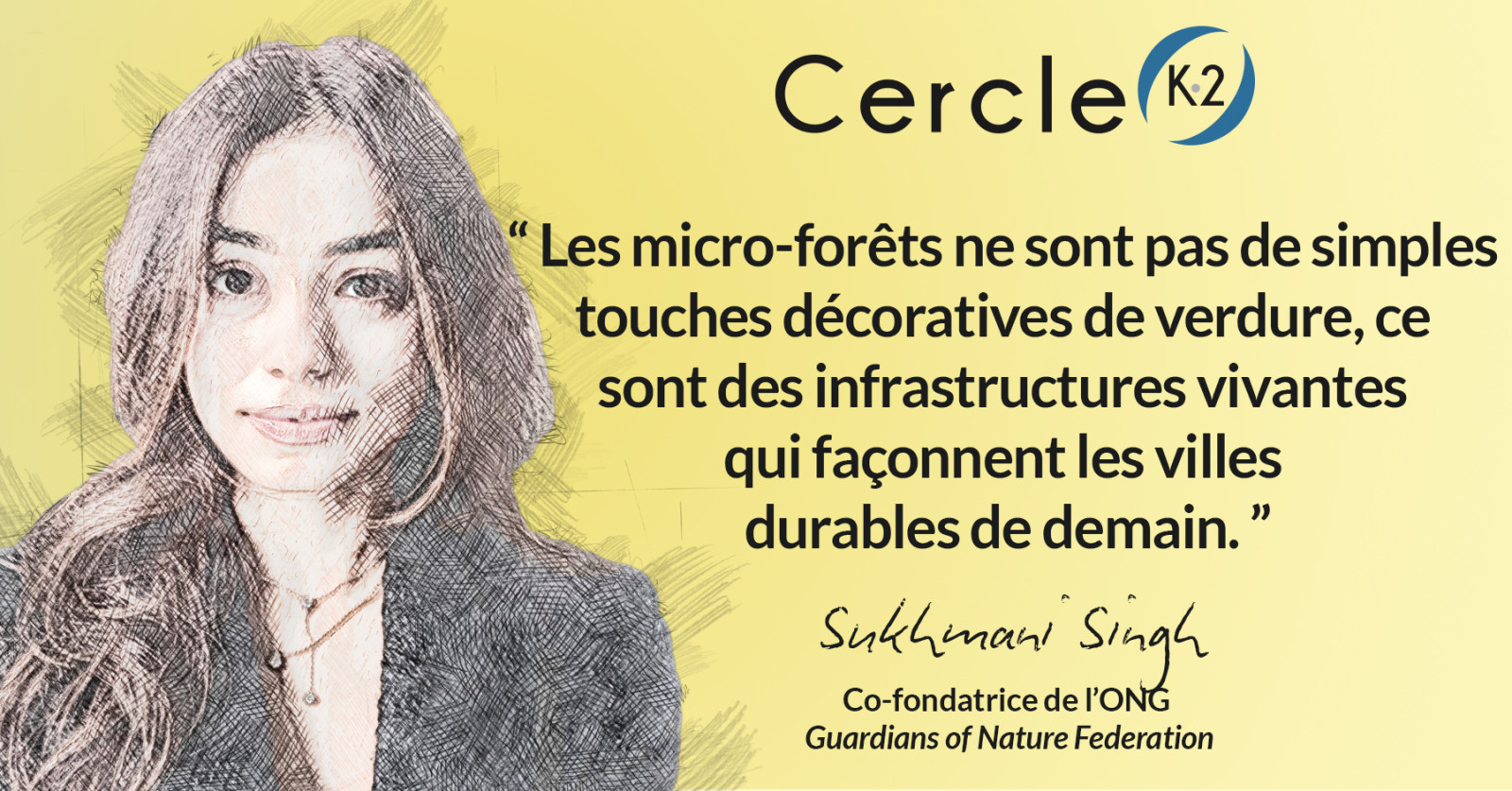
Cercle K2 neither approves or disapproves of the opinions expressed in the articles. Their authors are exclusively responsible for their content.
Sukhmani Singh est co-fondatrice de Guardians of Nature Federation, une ONG internationale basée en Inde.
---
Voir la version en anglais / English version here
---
Les scientifiques et les décideurs politiques s'accordent de plus en plus à considérer les micro-forêts urbaines comme une solution efficace et évolutive aux défis urbains contemporains. Conçues comme des écosystèmes compacts et riches en biodiversité, elles offrent non seulement une valeur esthétique, mais aussi une infrastructure tangible pour l'adaptation au changement climatique, le stockage du carbone et le bien-être des communautés, ce qui les rend essentielles à la transition vers des villes durables et résilientes.
Les micro-forêts utilisent la méthode Miyawaki, une technique de reboisement accéléré mise au point par le botaniste japonais Akira Miyawaki. Le concept de base consiste à planter des arbres indigènes de manière dense, souvent trois par mètre carré, après avoir mené des études de terrain pour déterminer la végétation naturelle potentielle (PNV) de la zone. Cette approche par couches imite la succession écologique naturelle afin d'établir rapidement une infrastructure verte fonctionnelle. La vitesse est significative, avec des gains de 10 à 15 fois supérieurs sur une période de 20 à 30 ans, et l'objectif est d'atteindre la succession forestière climax beaucoup plus rapidement que les 200 ans requis par les méthodes traditionnelles.
I. Contexte : l'impératif des infrastructures vertes urbaines
Les villes, qui abritent plus de 55 % de la population mondiale, sont au cœur des efforts mondiaux d'atténuation du changement climatique. Cependant, elles sont confrontées à un stress environnemental immense : les zones urbaines consomment environ 78 % de l'énergie mondiale et contribuent à plus de 70 % des émissions mondiales de dioxyde de carbone (CO₂) issues des combustibles fossiles. Cette urbanisation intense exacerbe des phénomènes critiques tels que l'effet d'îlot de chaleur urbain (ICU) et l'accélération de la perte de biodiversité.
L'urgence de traiter ces risques est confirmée par des évaluations économiques récentes. Les villes mondiales devraient subir les pertes économiques les plus importantes liées au changement climatique. Le coût social du carbone (CSC) lié aux impacts urbains domine les estimations mondiales, représentant environ 78 % à 93 % du CSC mondial total. En outre, le fait de ne pas tenir compte du réchauffement local (UHI) entraîne un biais à la baisse important dans les évaluations des pertes économiques.
Le modèle de micro-forêt est particulièrement adapté aux environnements urbains difficiles et le besoin de telles solutions à faible empreinte est universel, en particulier dans les quartiers historiques ou centraux des villes.
II. Les avantages à fort impact et à faible empreinte des micro-forêts urbaines
Ces « mini-jungles urbaines » offrent des avantages environnementaux immédiats et localisés :
- Atténuation du changement climatique et séquestration du carbone : les arbres urbains remplissent des fonctions environnementales cruciales, notamment en filtrant les polluants, en atténuant le ruissellement des eaux pluviales et en réduisant les effets du changement climatique en abaissant les températures et en stockant le dioxyde de carbone. Des études démontrent que la modification stratégique de la composition des espèces dans les stratégies de verdissement urbain pourrait augmenter considérablement les taux de séquestration du carbone de 47,8 % à 114 % par an. Cela souligne l'importance du choix des espèces pour maximiser les avantages environnementaux.
- Résilience thermique : les micro-forêts fournissent une ombre luxuriante, atténuant l'effet d'îlot de chaleur urbain. Des recherches menées sur les micro-forêts à Cambridge, dans le Massachusetts, ont montré qu'elles étaient plus fraîches de 20 degrés Celsius (36 degrés Fahrenheit) que l'herbe environnante pendant les heures les plus chaudes de la journée. Les parcelles Miyawaki plus anciennes présentent également une micrométéorologie moins extrême que les zones extérieures environnantes.
- Biodiversité et santé des sols : les parcelles de verdure concentrées restaurent la biodiversité et ramènent la flore et la faune indigènes dans les zones métropolitaines. Elles améliorent également la fertilité des sols. Des études montrent que les parcelles Miyawaki présentent de meilleures caractéristiques physiques, chimiques et biologiques que les parcelles traditionnelles et les forêts secondaires.
Les micro-forêts en action : exemples mondiaux
Les initiatives de micro-forêts restaurent les habitats indigènes et apportent des avantages localisés dans le monde entier. Au moins 40 millions d'arbres ont été plantés dans 19 pays grâce à 2700 projets utilisant cette méthode :
- France : Boomforest a lancé des projets à Paris (par exemple, le talus de la Porte de Montreuil) et à Lyon (neuf mini-forêts), et des projets de recherche sont en cours à Toulouse et à Nice (qui s'est engagée dans le cadre du défi « Trees in Cities » de la CEE-ONU à planter 280 000 arbres d'ici 2026, soit cinq fois plus qu'aujourd'hui, et qui actualise ses politiques d'urbanisme afin d'utiliser des espèces adaptées au climat). La mairie de Paris s'est engagée à planter 170 000 arbres selon la méthode Miyawaki.
- Engagements européens : Nice et Bordeaux ont pris des engagements en matière de foresterie urbaine dans le cadre du défi « Trees in Cities Challenge ». Genève a planté ses deux premières micro-forêts urbaines en Suisse, et Lausanne vise à augmenter sa couverture forestière de 20 % à 30 % d'ici 2040.
- Projets menés par les citoyens : des initiatives telles que Urban Forests en Belgique et Citizens Forests en Allemagne mettent l'accent sur l'action citoyenne, tandis qu'Earthwatch Europe a planté plus de 200 petites forêts au Royaume-Uni et en Europe continentale.
- Inde : 20 microforêts ont été créées à New Chandigarh, dans le Pendjab, par l'ONG Guardians of Nature Federation. Le projet pilote « Mon village, ma forêt » dans le district de Fazilka, au Pendjab, vise à créer 75 microforêts. Une plantation Miyawaki a également été créée sur le campus de l'université de Saurashtra à Rajkot afin d'étudier les valeurs ethnobotaniques et pharmacologiques.
- Chine : la mégapole de Shenzhen fait l'objet d'une étude de cas sur les nouveaux cadres de surveillance du carbone, et Shanghai a évalué les parcelles Miyawaki sur une période de restauration de 10 ans.
- Californie : Des micro-forêts sont en cours de plantation à Los Angeles (LA Microforests et Griffith Park) et à Berkeley (Urban Pocket Forest).
- Nord-est/Midwest des États-Unis : Des initiatives sont également en cours à Cambridge, dans le Massachusetts (Danehy Park Forest) et à St. Paul, dans le Minnesota (quartier de Rondo).
III. Intégration des politiques : de la philanthropie à l'infrastructure obligatoire
Les micro-forêts ne doivent pas être considérées comme de simples aménagements verts, mais comme une pierre angulaire essentielle de la politique urbaine officielle et de la planification générale obligatoire pour la construction d'infrastructures adaptées au climat. Les politiques doivent imposer l'allocation d'espace pour ces interventions écologiques, obligeant les urbanistes à définir l'espace urbain en termes de santé planétaire.
Les décideurs politiques et les urbanistes sont vivement encouragés à intégrer officiellement des quotas minimaux de reboisement dense et indigène dans toutes les stratégies de développement municipal, afin de garantir que le passage nécessaire à des espaces publics centrés sur la verdure se fasse dès maintenant, dans l'intérêt collectif de la société urbaine. L'urgence de cette mesure est soulignée par la constatation qu'une réduction stricte des gaz à effet de serre est dans l'intérêt des régions urbaines du monde entier.
Toutefois, la mise en œuvre de ces politiques doit être nuancée, en tenant compte des principales contraintes :
Limitation spatiale : la plantation d'arbres pour augmenter la couverture forestière est particulièrement difficile dans les centres urbains denses, où les infrastructures limitent souvent les espaces verts. Cela nécessite de remédier aux limites des modèles d'urbanisme rigides, tels que ceux qui tentent de geler le développement des villes pendant des décennies. Au lieu de se concentrer exclusivement sur les routes pour la circulation automobile, l'urbanisme doit donner la priorité à la définition de l'espace urbain en termes de rues pour les personnes, d'interaction et de santé planétaire. Par exemple, une analyse des quartiers historiques de 15 villes polonaises a révélé que la couverture réelle du couvert forestier ne variait que de 15 % à 34 %, malgré un potentiel calculé de 31 % à 51 %. Cela signifie que pour maximiser l'impact écologique, il faut souvent sélectionner stratégiquement les espèces en fonction de la zone géographique plutôt que de la quantité pure.
Coût d'investissement : la méthode Miyawaki se caractérise par un investissement initial important par rapport aux techniques classiques de reboisement. Les recherches indiquent que le taux de séquestration du carbone des forêts Miyawaki est environ 10 à 15 fois supérieur à celui de la régénération naturelle sur une période de 20 à 30 ans. Par conséquent, compte tenu de ses avantages écologiques considérablement accélérés, il est important d'inclure la méthode Miyawaki dans les budgets stratégiques pour des initiatives efficaces et à fort impact en matière de réduction des émissions de carbone en milieu urbain.
Structure de gouvernance : le déploiement réussi de micro-forêts résulte souvent d'un engagement communautaire et localisé. Cela nécessite une gouvernance décentralisée grâce à des partenariats multipartites impliquant les autorités locales, les ONG et les groupes communautaires.
Bien-être fonctionnel et alignement ESG : en matière de gestion urbaine, le « bien-être » d'une ville repose sur ses performances fonctionnelles optimales. Les solutions prendraient en considération des facteurs tels que le passage d'un modèle d'émissions axé sur les secteurs de production industrielle (scope 1) à un modèle basé sur la consommation des utilisateurs finaux, comme les bâtiments résidentiels et commerciaux (scope 2). En plus de mettre en œuvre des solutions ciblées, telles que des mesures d'efficacité énergétique pour ces zones axées sur la consommation, les collectivités locales intègrent des indicateurs de durabilité qui renforcent la résilience à long terme et la vitalité fonctionnelle du paysage urbain en intégrant ces systèmes vivants dans la conception des projets. En outre, les politiques devraient tirer parti des outils basés sur le SIG pour optimiser ces stratégies d'atténuation spatialement complexes afin de les adapter aux conditions locales et de faciliter leur intégration transparente dans le budget carbone national.
Donner la priorité à ces espaces verts centrés sur l'humain aujourd'hui est l'investissement le plus stratégique que la politique puisse faire pour les villes durables et résilientes de demain.
---
List of References:
1. Zhu, Yiwen & Zhang, Yuhang & Zhang, Yi & Zheng, Bo. (2025). Tracing CO2 emissions across megacity landscapes: beyond citywide totals to structural heterogeneity and mitigation. Environmental Science and Ecotechnology. 27. 100602. 10.1016/j.ese.2025.100602. Link
2. Kacprzak, Malgorzata & Ellis, Alexis & Fijałkowski, Krzysztof & Kupich, Iwona & Gryszpanowicz, Piotr & Greenfield, Eric & Nowak, David. (2024). Urban forest species selection for improvement of ecological benefits in Polish cities - The actual and forecast potential. Journal of environmental management.366. 121732. 10.1016/j.jenvman.2024.121732. Link
3. https://unece.org/media/press/365714
4. Monteiro, Barbara, "WHAT IT TAKES TO GROW A MICRO FOREST AT NEW COLLEGE OF FLORIDA" (2023). Theses & ETDs. 6404. Link
5. Zeybek, Osman. (2025). Evaluating the Miyawaki Afforestation Technique in Urban Landscapes: Opportunities and Challenges. Iconarp International J of Architecture and Planning. 13. 313-337. 10.15320/ICONARP.2025.326. Link
6. Estrada, Francisco & Lupi, Veronica & Botzen, W.J. & Tol, Richard. (2024). Urban and Non-Urban Contributions to the Social Cost of Carbon. 10.21203/rs.3.rs-4671262/v1. Link
7. Kim, Soo-Yeon & Kerr, Gaige & Donkelaar, Aaron & Martin, Randall & West, Jason & Anenberg, Susan. (2025). Tracking air pollution and CO2 emissions in 13,189 urban areas worldwide using large geospatial datasets. Communications Earth & Environment. 6. 10.1038/s43247-025-02270 Link
8. Link
14/11/2025