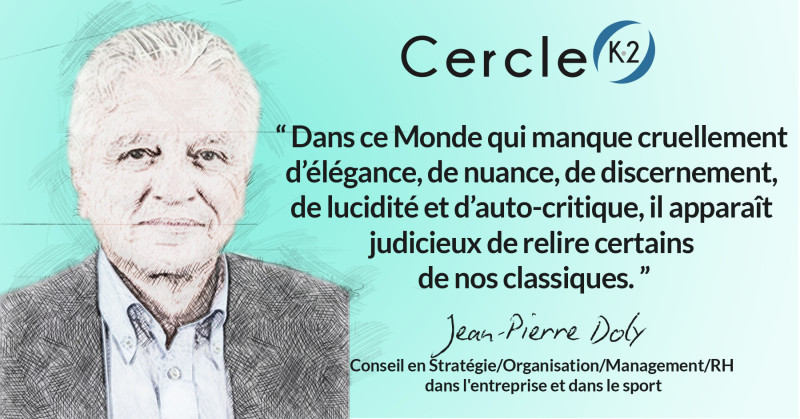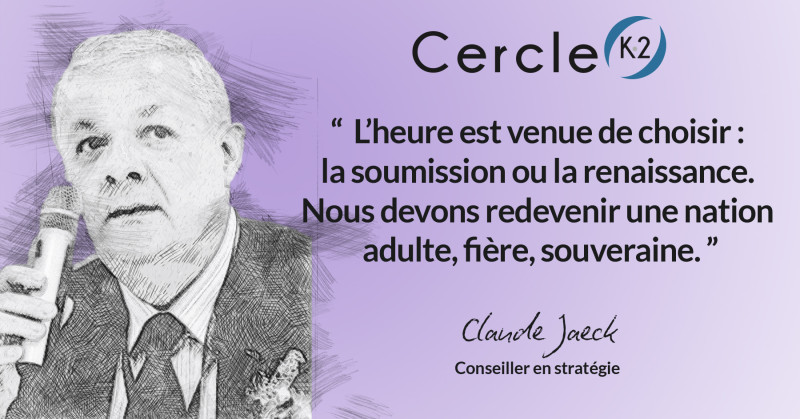La Chine entre économie, diplomatie, innovation et transformation urbaine
27/05/2025 - 12 min. de lecture

Cercle K2 neither approves or disapproves of the opinions expressed in the articles. Their authors are exclusively responsible for their content.
Diplômée de Fudan University et d'HEC Paris, Sophie Zhou Goulvestre dirige le cabinet de conseil SR2C.
---
Lors de mon voyage à Shanghai en avril dernier, j’ai eu l’opportunité de participer à plusieurs ateliers thématiques animés par trois éminents professeurs chinois, chacun expert dans son domaine[1] ainsi qu’un ancien haut fonctionnaire, l’un des principaux architectes du développement de la ville de Shanghai de ces dernières décennies[2]. Cette mise à jour approfondie et structurée sur la situation en Chine, après le 3ème plénum du 20e Comité Central du PCC, les deux sessions de mars 2025[3] et l’élection du président Trump, s’est révélée précieuse pour mieux comprendre les dynamiques actuelles et les grandes orientations à venir de ce pays.

Voici une synthèse de mes étude et analyse, centrée sur quatre axes principaux :
1. La situation macroéconomique et les derniers dispositifs mis en place par le gouvernement chinois

Comme beaucoup d’autres pays, la Chine subit les conséquences persistantes de la morosité économique mondiale post-COVID : faible croissance, forte inflation liée à la guerre entre la Russie et l’Ukraine, rupture des chaînes d’approvisionnement globales, incertitudes sur l’avenir, taux d’intérêt élevés, effets de levier négatifs, etc.
Par ailleurs, le contexte géopolitique international est également chaotique et instable, marqué par une accélération des bouleversements historiques, un essoufflement de l’élan de la mondialisation fondée sur la démocratie, la répartition et les échanges libres à l’échelle mondiale, un mouvement grimpant d’anti-mondialisation (populisme et repli souverainiste), une remise en question des règles établies et une montée du risque de confrontation entre blocs géographiques, croyances et nations…
En effet, la Chine est aujourd’hui confrontée à d’immenses défis dont quatre majeurs :
À long terme :
- La disparition du dividende démographique et le ralentissement de la migration interne ;
- La résistance structurelle à la transformation et à la modernisation industrielles.
Et à court terme :
- L’insuffisance de la demande intérieure et extérieure, entraînant une baisse de la consommation, la faillite de nombreuses entreprises privées, et une forte pression sur le marché de l’emploi ;
- Les risques de crise immobilière et de dégradation du bilan, déjà visibles à travers les difficultés financières de certaines collectivités locales.
Face à cette situation inédite, le gouvernement a présenté, à l’issue des Deux Sessions du mars 2025, plusieurs mesures clés pour l’année en cours et le 15ème plan quinquennal (2026-2030) :
- La conception et la mise en œuvre d’un nouveau modèle de développement, reposant sur :
- Une nouvelle productivité fondée sur la stimulation de la demande intérieure, l’innovation scientifique, technologique et industrielle, ainsi que la création d’industries du futur intégrées, modernes, futuristes et de haute qualité,
- Une ouverture internationale de haut niveau,
- La stabilisation des marchés immobilier et boursier,
- L’amélioration continue du niveau de vie de la population et le maintien de la stabilité et de l’harmonie sociales,
- La mise en œuvre sans relâche des 14ᵉ et 15ᵉ plans quinquennaux.
- Et quelques objectifs chiffrés pour l’année 2025
- Taux de croissance économique : 5 %
- Taux de chômage : 5,5 %
- Création de 12 millions de nouveaux emplois urbains
- Hausse de l’indice des prix à la consommation (IPC) : 2 %
- Croissance des revenus des ménages alignée sur celle du PIB
- Équilibre de la balance des paiements (importations/exportations)
- Production céréalière : environ 1,4 billion de jin (斤)
- Réduction de la consommation d’énergie par unité de PIB : -3 %
- Amélioration continue de la qualité environnementale
2. Politiques et relations internationales : une diplomatie en mutation

Face aux bouleversements globaux sans précédent depuis un siècle et un contexte géopolitique instable, le gouvernement chinois affine sa stratégie internationale et diplomatique afin d’affirmer son rôle dans la gouvernance mondiale.
Concrètement, la Chine est en train d’amorcer une transformation majeure de sa diplomatie dans l’objectif de préserver sa stabilité stratégique, de poursuivre son développement économique et de s’imposer comme un acteur incontournable dans la redéfinition des règles internationales.
Une vision fondée sur cinq pensées fondamentales
Dès 2017, le président Xi Jinping a commencé à poser les fondations de cette nouvelle diplomatie chinoise autour de cinq visions clés :
- Un moment charnière dans l’histoire mondiale : la Chine estime que le monde vit une transition majeure, où les équilibres traditionnels vacillent ;
- Une communauté de destin pour l’humanité : au cœur du projet chinois, il y a l’idée d’un ordre mondial solidaire reposant sur l'interdépendance entre les peuples ;
- Un ordre équitable, au-delà de la domination : la Chine rejette l’hégémonie des puissances historiques et défend un modèle pacifique et multilatéral ;
- L’initiative “la Ceinture et la Route” : cette nouvelle route de la soie incarne la vision stratégique, notamment sur la chaîne d’approvisionnement globale de la Chine, la soie étant un symbole lequel mêle le commerce, la dialogue des civilisations et la puissance douce ;
- Une civilisation millénaire comme socle de valeurs universelles : forte de son riche héritage, la Chine entend proposer des repères culturels et éthiques à portée globale.
Une diplomatie proactive face à un monde en mutation
La Chine développe désormais une diplomatie dite « de grande puissance à la chinoise », axée sur la coopération gagnant-gagnant et le développement pacifique. Ce positionnement vise à :
- Anticiper les nouvelles crises liées aux instabilités géopolitiques et aux ruptures économiques,
- Répondre à la montée en puissance des pays émergents et à la multipolarisation du monde,
- S’adapter aux transformations technologiques, lesquelles redessinent les capacités productives humaines,
- Faire face au repli idéologique provoqué par le déclin du néolibéralisme et la montée du populisme et du nationalisme.
Aussi une stratégie d’influence culturelle et identitaire
La Chine renforce également son soft power en misant sur :
- Une réaffirmation culturelle, avec la promotion de son identité et de ses traditions dans une optique moderne,
- La promotion de l’unité nationale et de l’éducation à l’identité chinoise, élément central de la stabilité interne,
- L’exportation de ses valeurs, en passant d’une simple présence internationale (la Chine dans le monde) à une volonté d’influence globale (le monde selon la Chine),
- Une participation active à la création de nouvelles règles internationales qui reflètent sa vision d’un monde plus équilibré.
Enfin, une préparation à la compétition globale
Dans un contexte de rivalités accrues entre grandes puissances, la Chine entend renforcer ses outils diplomatiques, juridiques et médiatiques pour :
- Accroître son influence et son rôle dans la gouvernance globale,
- Aligner sur des normes internationales de haut niveau,
- Préparer une ouverture économique renforcée,
- Favoriser l’émergence d’un nouvel ordre mondial structuré autour de ses propres institutions et valeurs.
Se trouvant à un tournant, la Chine redéfinit sa stratégie diplomatique non seulement pour préserver ses intérêts, mais aussi pour proposer une alternative au modèle occidental. À travers cette transformation, elle affirme un projet global ancré dans son histoire, sa culture et sa conception du monde.
3. Intelligence artificielle, économie digitale et vie numérique en Chine

À l’empire du milieu, l’intelligence artificielle, l’économie digitale et la vie numérique ne sont pas de simples secteurs innovants, elles constituent le cœur stratégique des industries du futur du pays. Dans le 15ème plan quinquennal, ces technologies sont considérées comme moteurs de la « nouvelle productivité », un concept clé promu activement par le gouvernement chinois à travers ses politiques publiques ambitieuses.
Avant d’aller plus loin, il est utile de comprendre quelques définitions de cette vision du futur à la chinoise :
1. La vie numérique se définit comme une interaction permanente entre les mondes virtuel et réel, dans laquelle le virtuel est mis au service de la réalité.
2. L’industrie du futur, selon la Chine, repose sur un noyau technologique articulé autour de quatre piliers :
- L’intelligence artificielle (software),
- La robotique (hardware),
- Le calcul quantique (infrastructure),
- Le métavers (projection immersive d’une nouvelle génération de vie intelligente et digitale).
3. La nouvelle productivité se conçoit à travers :
- Des talents cognitifs hautement qualifiés (stratégie, créativité, capacité d’une décision complexe, compétences sociales et émotionnelles…),
- Des matériaux/outils de travail hautement technologiques (IA, cloud computing, blockchain, internet...),
- Des objets de travail élargis (environnement virtuel, données massives, exploration de l’océane profonde...),
- Une coordination optimisée entre les différents facteurs de production (intégration systémique, réseaux partagés…).
Et alors, où en est maintenant la Chine par rapport à l’état de l’art de ces technologies ?
De l’infrastructure à la digitalisation cognitive
Les deux premières phases de développement digital sont en effet déjà bien matures en Chine :
- Phase d’infrastructure numérique : construction d’un écosystème digital performant.
- Phase de transformation numérique : interconnexion des systèmes, exploitation des données, montée en puissance de l’économie de la donnée.
Ces fondations ont permis l’émergence d’acteurs chinois devenus incontournables à l’échelle mondiale, comme ces quelques marques connues :
- Alibaba (e-commerce, services cloud, paiement en ligne),
- TikTok / WeChat (réseaux sociaux),
- Meituan / JD.com (services O2O – online to offline – et de bout en bout),
- Etc.
Désormais, la Chine est entrée dans sa troisième phase, celle de la digitalisation cognitive, où la vie et l’économie peuvent être nativement numériques. Cette nouvelle ère ne se contente plus d’exploiter la technologie, elle la rend omniprésente et intelligible dans le quotidien des citoyens.
Des usages concrets déjà visibles
De nombreux cas d’usage témoignent de cette transformation en cours :
- Des jumeaux numériques représentant des personnes dans des émissions télévisées, des formations en ligne ou des jurys de concours,
- DeepSeek, une IA générative chinoise,
- Le grand succès de Nezha 2 (film d’animation avec effets spéciaux IA), de Black Myth Wukong (jeux vidéo avec IA pour améliorer le gameplay)[4] et des jeux de manga interactifs (à titre d’exemple, Genshin Impact de miHoYo)
- Le développement de lunettes AI/AR (réalité augmentée/intelligence artificielle),
- Des espaces pour d’expériences immersives dans le métavers à Shanghai, Pékin ou Guangdong,
- Des applications sectorielles du métavers : commerce, tourisme, culture, industrie automobile intelligente,
- Construction à Hong Kong d’un centre mondial des actifs virtuels,
- Etc.
Un modèle économique encore en construction
Si les usages semblent prometteurs, leur rentabilité commerciale reste à ce jour limitée. Des produits IA comme DeepSeek ne sont toujours pas viables financièrement, et les modèles économiques de ce secteur sont encore en phase expérimentale.
Toutefois, le succès commercial de certaines entreprises chinoises — comme Black Myth Wukong, Doubao ou miHoYo — laisse entrevoir une formule gagnante laquelle pourrait faire école :
Un scénario d’utilisation industrielle (grande échelle) + une valeur cognitive ou émotionnelle forte + un prix accessible = un produit durablement compétitif.
4. Shanghai : les coulisses d’un succès et les ambitions d’une métropole mondiale

« La stratégie n’est pas ce qu’il faut faire demain, mais ce que nous devons entreprendre aujourd’hui pour espérer un avenir ! »
Shanghai, véritable locomotive économique de la Chine, illustre à elle seule l’approche stratégique du développement urbain chinois : vision à long terme, adaptation constante et volonté d’innovation. De la transformation de Pudong dans les années 1980 à la construction de pôles d’excellence technologique, la ville façonne son avenir à travers des cycles de planification rigoureuse et de profondes mutations économiques.
Développons-nous un peu plus dans le détail sur sa réussite pendant ces dernières décennies, ses réalisations actuelles, ainsi que ses ambitions pour l'avenir :
Une stratégie pensée sur le long terme
Depuis 1985, Shanghai organise environ tous les dix ans de vastes discussions stratégiques. Ces réflexions ont structuré les grandes étapes de son développement, intégrées dans 9 plans quinquennaux et 3 grandes révisions de son urbanisme général. Du développement de la zone de Pudong à la consolidation de son soft power, Shanghai évolue en anticipant toujours les ruptures plutôt qu’en y réagissant.
Réinventer l’économie face aux défis structurels
La Chine fait aujourd’hui face à un tournant économique : tensions géopolitiques, raréfaction des ressources, contraintes environnementales… Le modèle de croissance extensif d’autrefois touche à ses limites. Dans ce contexte, Shanghai s’engage dans le rôle du laboratoire de la nouvelle compétitivité nationale. Elle incarne la transition vers un développement plus durable, fondé sur l’innovation et l’intelligence industrielle.
L’industrie, fondement du développement urbain
À chaque étape de sa croissance, Shanghai a su s’appuyer sur des projets industriels structurants pour impulser son essor urbain (Exposition Universelle de 2010, construction Baosteel[5], création de Zhangjiang Science City et de Lujiazui Financial City[6], etc.). Aujourd’hui, l’accent est mis sur l’industrie de haute technologie, numérique et verte. La ville s’engage dans une industrialisation axée sur la qualité et l'efficacité, plutôt que sur le volume.
Réformes institutionnelles et ouverture du pays de haut niveau
L’ouverture économique ne se limite plus à la politique commerciale, elle s’enracine désormais dans les institutions. Shanghai, sous l’impulsion de l’État, expérimente des zones de libre-échange, prépare son adhésion au CPTPP et participe activement à l’élaboration des nouvelles normes du commerce international. L’objectif est de devenir une plateforme mondiale de multinationales et d’investissements transfrontaliers.
L’innovation technologique comme moteur de puissance
Shanghai mise résolument sur l’innovation pour consolider son rôle de leader dans le renouveau national, et la Zhangjiang Science City en est l’épicentre. Aux côtés des laboratoires nationaux, la ville focalise sur le développement des projets technologiques d’envergure dans le circuit intégré, la biopharmaceutique, la fusion nucléaire contrôlée ou encore les modèles d’intelligence artificielle générative…
Un appui stratégique sur le secteur privé
L’économie privée constitue l’un des piliers de la modernisation économique. À Shanghai, la majorité des entités économiques sont privées, elles sont promues comme l’acteur principal de la dynamique innovante. L’État s’engage également à garantir leurs droits, encourager l’entrepreneuriat et favoriser les synergies entre acteurs publics et privés.
De la production à la consommation, un changement de paradigme
La transformation économique passe aussi par un changement de logique : de la production de masse à la consommation intelligente. Shanghai entend créer les marques premium nationales, accroître le pouvoir d’achat, repenser la fiscalité et créer de nouveaux espaces de consommation pour stimuler une demande intérieure qualitative.
Vers quatre pôles économiques d’envergure
La stratégie de développement futur de la ville repose sur la création de quatre pôles structurants :
- Des industries de haute technologie,
- Des infrastructures scientifiques majeures,
- Des plateformes financières internationales,
- Des infrastructures culturelles, sportives et touristiques.
Ces pôles ont pour objectif de faire de Shanghai un centre de gravité économique où convergent innovation, services et attractivité internationale.
Soft power et gouvernance moderne : cap sur 2035
À l’horizon 2035, Shanghai ambitionne de devenir une métropole socialiste moderne à influence mondiale. Son atout ? Un soft power fondé sur l’innovation institutionnelle, la culture, la gouvernance urbaine et l’attractivité globale. Face à la compétition internationale entre les grandes métropoles, elle entend imposer son modèle.
Mot de la fin : grâce à une planification stratégique cohérente, une ouverture institutionnelle maîtrisée et une dynamique d’innovation constante, Shanghai s’impose comme l’un des pôles urbains les plus ambitieux du XXIe siècle. Forte de son héritage et de sa capacité d’anticipation, la ville trace la voie d’un avenir où se mêlent modernité technologique, puissance économique et rayonnement culturel.
---
[1] Professeur Yuan Zhigang, directeur de thèse en doctorat (PhD), École d’économie de l’Université Fudan (top 2-3 en Chine); Professeur Zhang Yi, directeur de thèse en doctorat (PhD), Institut des relations internationales et des affaires publiques de l’Université Fudan (top 1-2 en Chine); Professeur Zhao Xin, directeur de thèse en doctorat (PhD), Institut de recherche sur les mégadonnées de l’Université Fudan (top 3 en Chine).
[2] Wang Sizheng, président de la Société de macroéconomie de Shanghai, est un expert en conseil et en évaluation pour les principales décisions administratives du gouvernement municipal de Shanghai. Il est également membre du comité consultatif d’experts pour le 15e plan quinquennal de la ville et économiste principal.
Diplômé de l’Université de Finance et d’Économie de Shanghai ainsi que de HEC Paris, il a longtemps travaillé au sein de la Commission de développement et de réforme de Shanghai. Il y a dirigé de nombreux projets nationaux et régionaux de grande envergure, ainsi que l’élaboration de plans et de politiques majeurs, acquérant ainsi une vaste expérience pratique et académique.
Il a notamment occupé les fonctions d’inspecteur, de directeur adjoint de la Commission de développement et de réforme de Shanghai, de directeur général de la Shanghai Investment Inquiry Company, du Centre d’information de Shanghai, d’inspecteur adjoint du Bureau de l’Exposition universelle de Shanghai et de directeur du département de la planification globale.
[3] Les deux sessions annuelles — la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC) et l’Assemblée nationale populaire (ANP) — sont communément appelées les « Deux Sessions ».
[4] Ces récits de grand budget autour de Nezha et de Wukong, deux icônes légendaires chinois, jouent également un rôle de renforcement d’influence culturelle et de confiance identitaire.
[5] Engineering et filière de la production d'acier
[6] Le symbole de Lujiazui Financial City est un bloc de trois gratte-ciels modernes se situant à Pudong, qui est également un spot le plus connu et populaire de la ville de Shanghai d’aujourd'hui.
27/05/2025