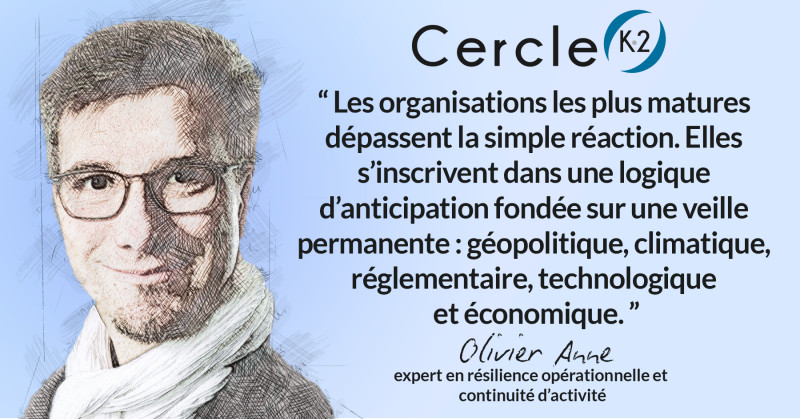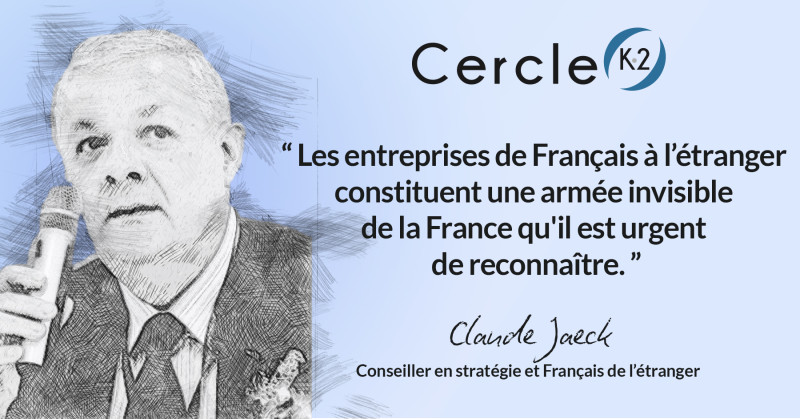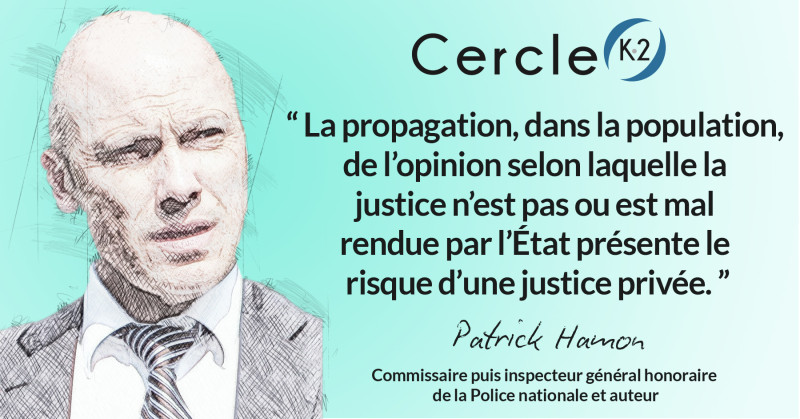Renseignement et vérité : entre rigueur méthodologique et quête philosophique
17/11/2025 - 2 min. de lecture
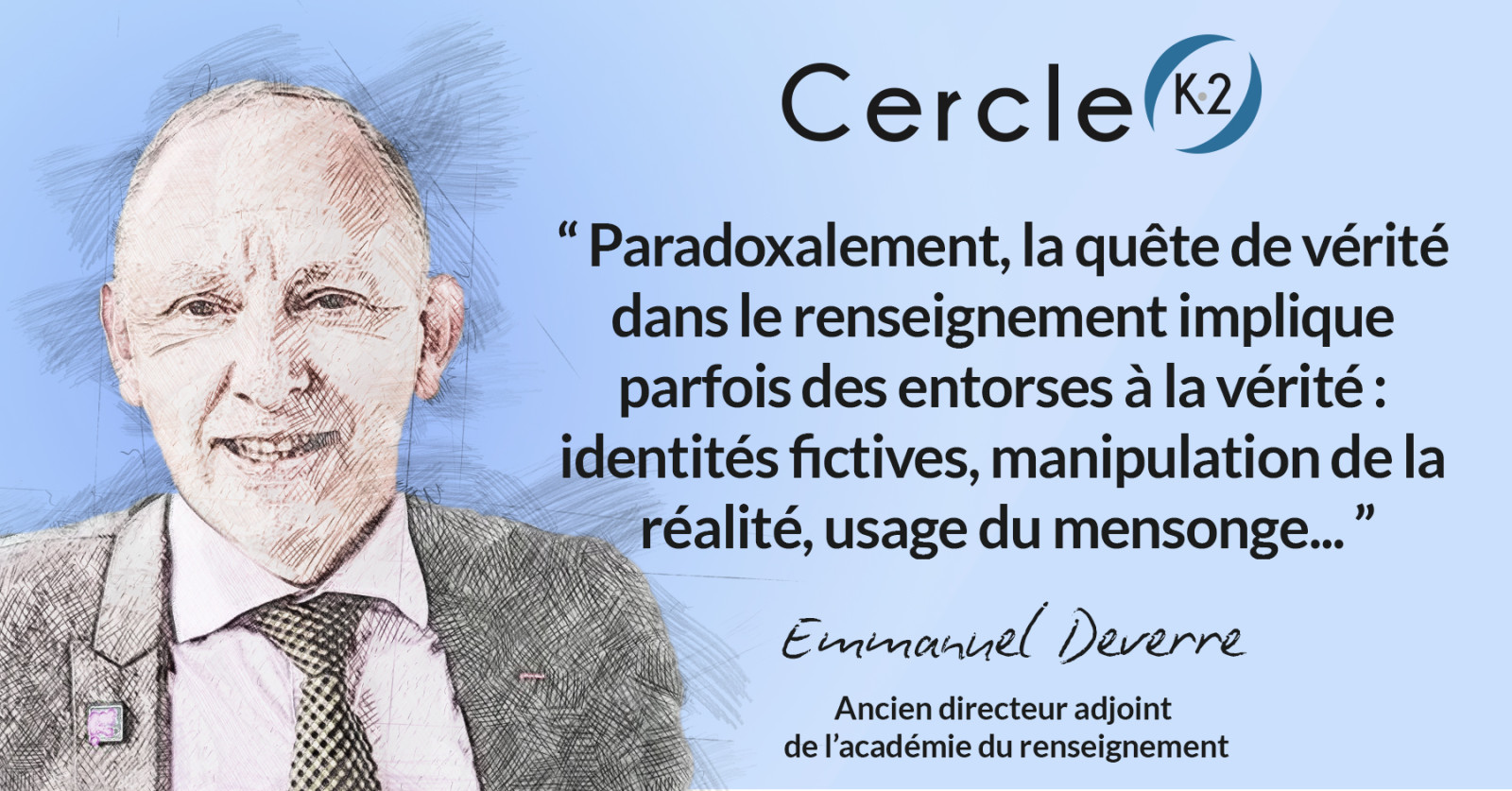
Cercle K2 neither approves or disapproves of the opinions expressed in the articles. Their authors are exclusively responsible for their content.
Emmanuel Deverre est Ancien directeur adjoint de l’académie du renseignement.
---
La recherche du renseignement est un métier singulier, marqué par la complexité de son environnement, la diversité des sources, et les contraintes humaines et techniques qui peuvent en déterminer la réussite ou l’échec.
Finalité du renseignement
Le renseignement vise à fournir à un décideur — qu’il soit public ou privé — des informations stratégiques ou tactiques lui permettant de comprendre une situation, d’anticiper une évolution ou de saisir une opportunité. L’objectif est clair : éclairer la décision pour qu’elle soit la plus pertinente possible.
Issu du latin renseignare (informer, éclairer), le renseignement repose sur un processus itératif : collecte de données, croisement des sources, analyse critique, et validation méthodique. Il ne s’agit pas d’une vérité révélée, mais d’une construction rigoureuse, encadrée par une déontologie exigeante — pluralisme, indépendance, vérification — visant à limiter les biais et les erreurs.
Vérité et post-vérité
La vérité, en revanche, relève d’un idéal philosophique : une adéquation parfaite entre les faits et l’intellect, comme le formulait Thomas d’Aquin, ou une correspondance entre propositions et réalité, selon les empiristes. Elle est absolue, intemporelle, et indépendante des perceptions individuelles.
Mais à l’ère numérique, cette notion est fragilisée par le phénomène de « post-vérité », où les émotions et les croyances personnelles prennent le pas sur les faits objectifs. Les fakes news, notamment en période électorale ou de crise sanitaire, illustrent cette dérive.
Le cycle du renseignement
Face à cette complexité, le renseignement s’appuie sur une méthodologie éprouvée : le cycle du renseignement. De l’orientation à la collecte, de l’exploitation à l’analyse, jusqu’à la diffusion, chaque étape contribue à produire une information fiable. Ce cycle peut être relancé indéfiniment par le décideur, en fonction de ses besoins.
Cependant, la formulation initiale de la demande doit rester ouverte et non biaisée. Une question trop orientée risque de produire un « faux vrai renseignement » ou d’occulter des signaux faibles essentiels.
Le risque de dérive : l’exemple de l’Irak
En 2003[1], les agences de renseignement anglo-saxonnes (CIA et MI6) ont dérogé à cette rigueur en fabriquant des preuves destinées à justifier l’intervention militaire en Irak. Ce cas emblématique rappelle que le renseignement, s’il est instrumentalisé, peut perdre sa légitimité.
Secret, confiance et éthique
En 2025, la société exige transparence et vérité, valeurs fondamentales en démocratie. Pourtant, le renseignement repose aussi sur le secret. Sa valeur dépend souvent du fait que son détenteur croit être le seul à en disposer.
Paradoxalement, la quête de vérité dans le renseignement implique parfois des entorses à la vérité : identités fictives, manipulation de la réalité, usage du mensonge. Ces pratiques ne visent qu’un seul objectif : offrir au décideur la meilleure compréhension possible de son environnement.
Mais même lorsque le renseignement est produit dans le respect de l’éthique — comme le soulignait l’amiral Canaris en parlant d’un « métier de seigneurs » — rien n’oblige le décideur à en tenir compte. La confiance ne se décrète pas : elle se construit dans la durée, par le respect de la déontologie et la qualité des relations humaines entre analystes et décideurs.
---
[1] Pour justifier l’intervention américaine en Irak, le président américain, G.W Bush Jr s’est appuyé sur un rapport du MI6 que Tony Blair avait demandé mais qui s’est avéré être un montage à posteriori.
17/11/2025