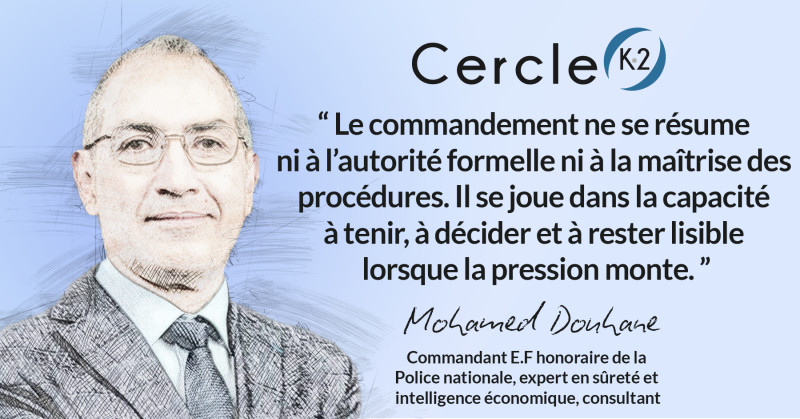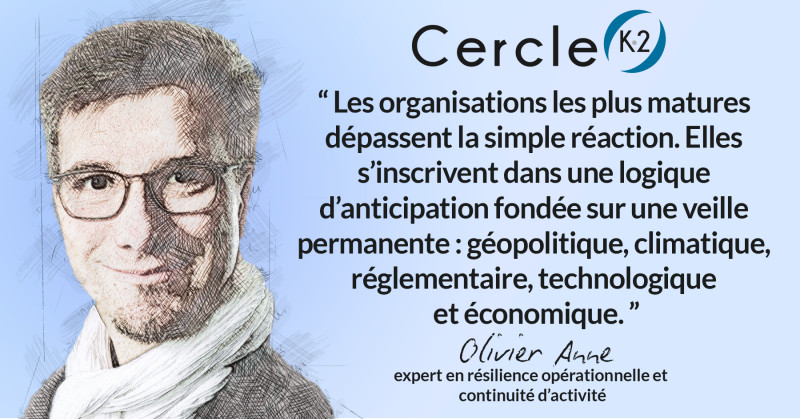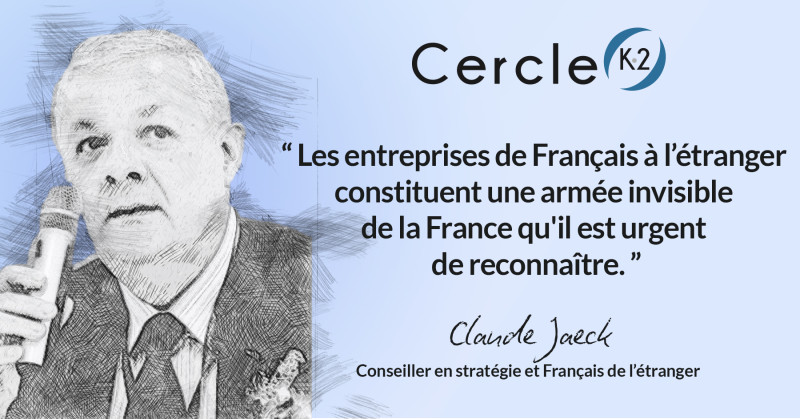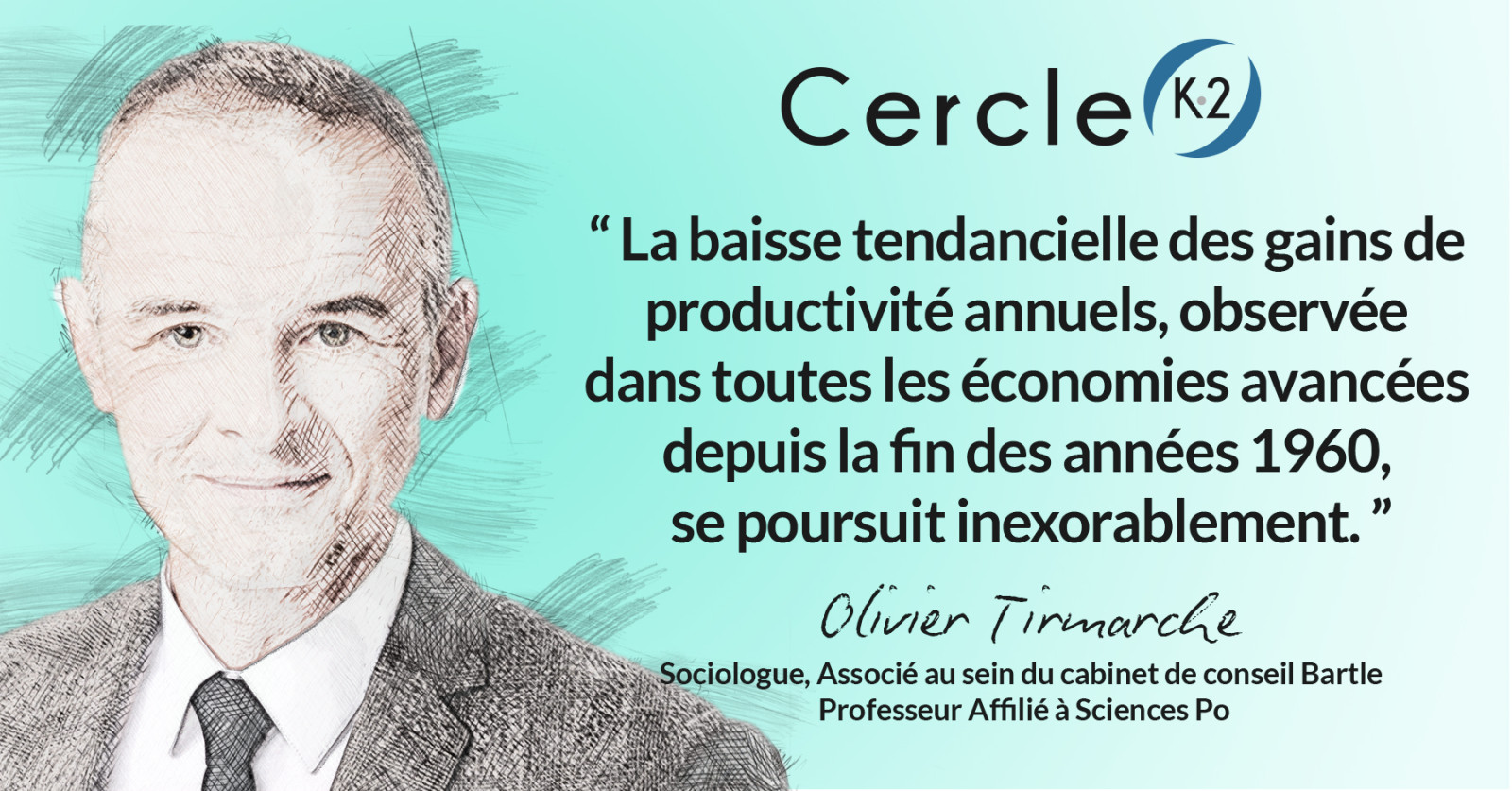
Cercle K2 neither approves or disapproves of the opinions expressed in the articles. Their authors are exclusively responsible for their content.
Olivier Tirmarche est Sociologue, Associé au sein du cabinet de conseil Bartle et Professeur Affilié à Sciences Po.
---
Sortir de l’agitation organisationnelle
Dans toutes les grandes organisations, nous assistons à une multiplication des projets de transformation et autres plans de performance[1]. Dans l’ensemble, ces plans et projets affichent des résultats décevants : la baisse tendancielle des gains de productivité annuels, observée dans toutes les économies avancées depuis la fin des années 1960, se poursuit inexorablement[2]. La vérité est que nous jetons beaucoup d’argent par les fenêtres. Nous vivons dans l’agitation organisationnelle.
La multiplication des plans et projets
L’agitation se manifeste en premier lieu par la perte de contrôle des portefeuilles de plans et projets dans les grandes organisations. Le nombre de plans et projets est si élevé que désormais les directions lancent des projets de… cartographie des projets. Autant dire que les managers sont perdus.
La multiplication des plans et projets n’est pas une réponse à la concurrence, du moins pas en première instance. Elle est un produit du jeu des intérêts particuliers. Pour les promoteurs du changement, les plans et projets sont des opportunités de valoriser leur savoir-faire ou leur personne. Dans le même temps, les acteurs potentiellement impactés par les changements peuvent difficilement refuser de participer : le mot "transformation" est devenu un blanc-seing, un totem, si bien que le refus s’apparente à une trahison.
La maigreur des résultats
La multiplication serait tolérable – au moins intellectuellement – si les plans et projets aboutissaient à des changements profonds et durables. Or les sondages suggèrent le contraire : deux tiers des porteurs sont insatisfaits des résultats obtenus, trois quarts des salariés doutent de la nécessité des changements, un tiers des projets sont abandonnés en cours de route. Cette réalité est ancienne : les premières études datent du milieu des années 1990[3]. Serions-nous aveugles ?
À vrai dire, l’absence ou la maigreur des gains de productivité importent peu aux décideurs : dans des contextes où les mauvais résultats peuvent être noyés dans la complexité des liens de causalité, la priorité est de pouvoir dire qu’on a fait quelque chose. De plus, l’action de changement a une vertu anxiolytique : elle fait diversion, elle réduit l’espace psychique disponible pour les anticipations négatives qui fondent l’angoisse.
D’aucun pourrait invoquer une piètre qualité de la conduite du changement pour expliquer les échecs. À cet argument, je rétorquerai que cette soi-disant piètre qualité est elle-même un dérivé de la multiplication des plans et projets, qui amène à limiter les moyens accordés à chacun. Disons les choses clairement : le flot des initiatives dépasse désormais les capacités d’absorption du changement par le corps social ; les salariés n’en peuvent plus.
Une autre explication possible des échecs serait la présence de défauts dans la conception même des cibles du changement. Nul doute que ces défauts existent, mais la plupart sont eux-aussi des symptômes de l’agitation, dans la mesure où ils trouvent racine dans une autre de ses causes profondes : la déconnexion des réalités de terrain[4], une déconnexion qui interdit d’évaluer les capacités d’absorption que j’évoquais précédemment, et qui alimente l’inflation.
Sortir de l’agitation
Il y a deux manières de lutter contre l’inflation. L’une d’elles est un traitement symptomatique : elle consiste à purger régulièrement le portefeuille des plans et projets, en décidant de façon arbitraire qu’il faut le réduire de moitié. Comme tout traitement symptomatique, le soulagement est temporaire. Il s’agit de contenir l’agitation plutôt que d’en sortir.
Pour en sortir véritablement, un traitement de fond s’impose. Ce traitement doit réduire le flux plutôt que le stock. Il doit s’attaquer directement au jeu des intérêts particuliers et légitimer le refus du changement. La solution est la création d’un tribunal du changement, dont la fonction est de tuer une partie des projets dans l’œuf. Le "tribunal" est une procédure contradictoire, au cours de laquelle un individu se fait l’avocat du projet, et un autre est explicitement mandaté pour instruire à charge. Les deux disposent d’un outil simple d’évaluation de la "bande passante" des fonctions concernées. La procédure implique aussi un jury, composé d’acteurs aussi désintéressés que possible, éloignés des relations de pouvoir dans lesquelles sont engagés les promoteurs du changement.
À ma connaissance, une seule entreprise a mis en place une telle institution. C’est bien dommage. Les bénéfices ne sont pas seulement économiques, mais aussi psychologiques : la régulation des portefeuilles projets contribue à protéger contre le sentiment d’absurdité que nourrit le management contemporain.
---
[1] D. Autissier, "Saturation du changement : mythe ou réalité ?", Forbes, juillet 2023
[2] Bruneau C., Girard P.-L., Évolution tendancielle de la productivité depuis 1976, France Stratégie 2022 ; Bergeaud, A., Cette, G. and Lecat, R. (2016): "Productivity Trends in Advanced Countries between 1890 and 2012," Review of Income and Wealth, vol. 62(3), pages 420–444.
[3] Voir par exemple : Kotter, John, “Leading Change: Why Transformation Efforts Fail”, Harvard Business Review, March–April 1995 ; Isern, Joseph and Pung, Caroline, “Organizing for successful change management: A McKinsey global survey”, The McKinsey Quarterly, June 2006 ; Greg Smith, Mandeep Dhillon, Raf Postepski, Chandler Hatton, Liam Collis, «"Driving adoption in digital transformation", Arthur D. Little, Mai 2018[4] Tirmarche O., Le nouvel horizon de la productivité : en finir avec le surtravail, Éditions Odile Jacob, Paris, 2020 ; Tirmarche O., "Réduire le surtravail, nouvel horizon de la productivité", Harvard Business Review France, 2020 : lien ; Tirmarche O., "Les sciences sociales au chevet de la productivité", Les Échos, Mai 2020
29/07/2025