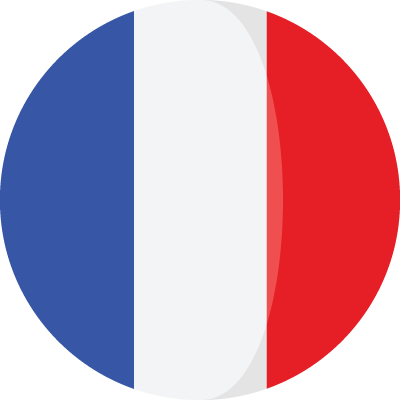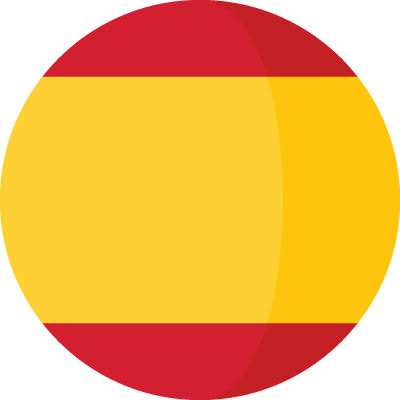Cercle K2 neither approves or disapproves of the opinions expressed in the articles. Their authors are exclusively responsible for their content.
Ronan Bretel est Juriste en droit de l'art, Doctorant, ENS Paris Saclay
---
Après un report causé par la pandémie de Covid-19, s'ouvre ce 2 septembre 2020 à Paris le procès des trois attentats terroristes de janvier 2015. À bien des égards, ces 50 jours d'audience où seront entendus les quatorze accusés renvoyés devant la Cour d'assises en présence de plus de 200 parties civiles et d'une centaine d'avocats serviront de mètre-étalon aux procédures judiciaires pour faits de terrorisme qu'aura à connaître notre pays dans les années à venir et, en premier lieu, de celle du Bataclan qui débutera en 2021. Au regard du droit du patrimoine culturel, cet événement judiciaire nous interroge sur le passage d'un procès dit historique à l'histoire judiciaire documentée pour la mémoire commune.
Qualifier juridiquement pour documenter la mémoire judiciaire
Du caractère historique du procès ...
Pour la première fois en France pour des faits de terrorisme, ce procès sera entièrement filmé conformément aux dispositions des articles L221-1 et s. du Code du patrimoine issus de la loi du 11 juillet 1985[1]. Portée alors par le Ministre de la justice Robert Badinter, elle introduisit en droit français ce système d'archivage audiovisuel ou sonore des "audiences publiques devant les juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire" lorsque leur captation "présente un intérêt pour la constitution d'archives historiques de la justice". L'article 18 de la loi du 15 juillet 2008 est venu préciser que ces enregistrements sont communicables "à des fins historiques ou scientifiques dès que l'instance a pris fin par une décision devenue définitive", contrairement au texte-matrice qui imposait un délai-tampon de 20 ans avant la consultation, sauf autorisation anticipée. Concernant la reproduction et la diffusion des enregistrements, celle-ci est libre après 50 ans, mais limitée à la seule échéance d'une décision devenue définitive concernant l'enregistrement des audiences des procès de crimes contre l'humanité ou "pour actes de terrorisme", comme est venu l'affirmer à titre dérogatoire l'article 69 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
C'est ainsi que mettant en branle ce dispositif juridique, les procès filmés de Klaus Barbie (1987), Paul Touvier (1994) et Maurice Papon (1998) constituent aujourd'hui un corpus historique, scientifique et patrimonial conservé à l'Institut National de l'Audiovisuel (INA)[2]. Jusqu'à la loi de 1985 adoptée dans la perspective de l'ouverture du procès de l’ancien SS et chef de la gestapo lyonnaise, l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse interdisait l'usage en salle d’audience de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image. L'article 308 du Code de procédure pénale proscrivait également toute captation à compter de l’ouverture de l’audience.
Les débats parlementaires d'alors témoignent de débats nourris entre deux finalités possibles pour le texte : une loi d'information immédiate du public qui consacrerait dans un dessein de transparence administrative un œil permanent sur le fonctionnement de la machine judiciaire ou bien une loi d'archivage qui permet la captation dans le seul intérêt de l'Histoire judiciaire.
Jusqu'à sa suppression par décret du 23 mai 2013, la Commission Consultative des Archives Audiovisuelles de la Justice (CCAAJ) était chargée, par la loi du 11 juillet 1985, d'inciter à la constitution d'un corpus filmique de mémoire judiciaire pour l'Histoire. Elle se prononçait sur l'opportunité de l'enregistrement ou non des audiences. L’ordonnance du 20 février 2004, ratifiée par la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, rendait d'ailleurs sa saisine obligatoire.
Jusqu'à ce jour, en matière criminelle, la loi de 1985 n'avait reçu d'application que concernant des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre.
L'intérêt historique juridiquement appréhendé[3] paraît double dans ces affaires. Il est externe en ce qu'il entend par le truchement de la captation garder mémoire des grands procès qui "revêtent une dimension événementielle, politique ou sociologique"[4] et marquent à ce titre l’histoire de la France, mais également interne en donnant à voir et certainement à comprendre le fonctionnement judiciaire autour de ces faits eux-mêmes jugés historiques. Mais est-ce l'historicité des faits ou du procès qui est visée par le législateur ? Il y a comme le relevait Marie Cornu[5] indubitablement un paradoxe à décider ab initio sur le mode intellectuel du tri de la science archivistique, ce qui permettra la construction de l'Histoire, en conditionnant quelle mémoire judiciaire a un plein droit à la postérité dans ce que la chercheuse sus-citée qualifie justement de "jugement prédictif de grande subjectivité […] exposé au risque d'arbitraire".
... à l'historicité des actes
Si nul ne peut nier que les faits terroristes de janvier 2015 frappant par le sang la liberté d'expression à travers les exécutions perpétuées à la rédaction de Charlie Hebdo ont un caractère historique, tout comme furent historiques les marches républicaines de réaction des 10 et 11 janvier ayant fait descendre dans la rue près de 4 millions de français, notamment à Paris en compagnie de 44 chefs d’États étrangers, le procès ici considéré présente-t-il pour autant un intérêt historique ? Rien n'est moins sûr. Dans le cas du procès de l'Hyper Cacher, la dimension internationale des faits, leur degré d'atteinte aux valeurs jugées fondamentales et leur dimension politique semblent pourtant avoir conduit le pouvoir judiciaire à se mettre au diapason de la réaction sociale en considérant que tel était le cas, quitte à raisonner sur l'historicité des actes.
Pourtant, ce procès sera nécessairement insatisfaisant. L'amertume de l'injustice ne pourra que se faire sentir à ne pas voir les auteurs principaux de ces attentats traduits devant la justice, ceux-ci ayant été tués lors des événements. De même, Hayat Boumeddiene (l'épouse d'Amedy Coulibaly) ainsi que les frères Belhoucine partis en Syrie ne répondront pas de leurs actes. Ne seront présents sur le banc des accusés que des individus soupçonnés d'avoir apporté un soutien opérationnel ponctuel aux criminels. La connaissance ou non de l'objectif terroriste va indéniablement être au cœur de l'instance, avec la difficulté habituelle pour la Cour de sonder les âmes. Les avocats vont tenter de montrer l'ignorance de leurs clients quant au dessein terroriste alors qu'ils auraient fourni les moyens du crime. C'est donc, comme souvent en matière terroriste où les auteurs trépassent, à un procès périphérique auquel nous allons assister. Un seul individu est d'ailleurs poursuivi pour complicité.
Ainsi, si les faits poursuivis sont indéniablement historiques, le procès qui va se tenir ne nous paraît précisément pas nécessairement historique dans la mesure où les auteurs principaux ne seront pas appelés à la barre. Les attentes légitimes des parties civiles vont nécessairement être déçues dans la mesure où elles vont se confronter au silence blessant des absents.
L'historicité des actes criminels ne fait donc pas nécessairement l'historicité du procès. D'ailleurs, lors du procès des attentats de Toulouse où seul le frère de Mohammed Merah était amené à comparaître – certes devant un tribunal correctionnel et non une Cour d'assises – la chambre criminelle avait estimé qu'en dépit "de l'extrême gravité des faits […], le contexte dans lequel se sont déroulés les crimes […] ne présent[ait] pas un intérêt qui justifierait que soit procédé à un enregistrement audiovisuel des débats de nature à enrichir les archives historiques de la justice"[6]. Sans doute l'absence du criminel antisémite meurtrier explique en grande partie cette solution puisque, comme le relève Nathalie Mallet-Poujol, "celui dont on pouvait espérer des explications pour tenter d'en comprendre l'itinéraire et les actes, de façon à construire une histoire, en complément de celle écrite dans le dossier judiciaire et les procès-verbaux d'interrogatoires et d'auditions"[7] n'était plus là. C'est la configuration de l'instance qui conditionne donc en grande partie le régime d'historicité affirmé dans l'autorisation ou non de captation audiovisuelle.
Concernant le procès qui s'ouvre, son caractère inédit, l'ampleur opérationnelle des audiences, les enjeux de traitement des accusés et relatifs à la place accordée aux parties civiles peuvent néanmoins amener à estimer que ce procès va constituer à la fois – au-delà d'un intrinsèque temps de justice – une agora et un espace de mémoire. Peut-être y a-t-il à cet égard précisément de l'historicité qui en justifierait la documentation pour l'Histoire et donc la qualification juridique "d'historique". Tel a été le sens de la décision de captation du magistrat autorisé. Charles Jolibois lui-même affirmait lors de la présentation de la loi de 1985 que "la notion d'intérêt historique ne doit pas, en effet, être entendue comme s'appliquant aux seules affaires judiciaires qui, par leur objet même, sont susceptibles de revêtir un intérêt historique, mais également à tous les procès susceptibles de faire date dans l'histoire de la justice".
La décision de permettre l’enregistrement d'un procès pour la "mémoire vivante de la justic »[8] revient au premier président ou vice-président de la juridiction devant lequel il se tient et peut être prise d’office ou à la requête d’une des parties ou du ministère public mais doit être formulée 8 jours avant le début de l'audience. Depuis une loi de 2019, la captation est toutefois de droit lorsqu'elle est demandée par le ministère public dans le cas des procès pour crime contre l'humanité ou actes de terrorisme. Semble présider à cette exception l'idée sous-jacente qu'il y aurait un droit de la société à en connaître, comme si la société civile se portait symboliquement elle-même partie civile.
L'article L. 221-4 du Code du patrimoine dispose que ces enregistrement intégraux (C. patr., art. L. 221-1) sont réalisés sans aucune vision dynamique (captés depuis un point fixe) qui les ramèneraient à un genre cinématographique documentaire et doivent être réalisés dans des conditions visant à ne pas porter atteinte au bon déroulement des débats ni au libre exercice des droits de la défense. Il est toutefois indéniable que la présence même d'une caméra modifie – tant chez les accusés que sur les bancs de la partie civile – le rapport à l'autre, à l'enceinte judiciaire et à la magistrature. Au nom du droit à l'information, on fait courir aux yeux de certains le risque que le regard anticipé de l'histoire vienne troubler le libre espace de parole qu'est le temps du procès. La chambre criminelle estime pourtant dans sa jurisprudence que les conditions de la captation en tant qu'elles sont déterminées par le président du tribunal qui assure la police de l'audience garantissent cette liberté et n'entachent pas la qualité du témoignage[9]. La force juridique de ce regard filmique documentaire est telle que les juges affirment que l'intérêt historique de constitution d'archives de la justice fait échec aux droits de la personnalités invoqués par la personne accusée, notamment de son droit à l'image[10].
Les configurations d'un procès-étalon
Le temps de la parole
Il y un rôle anthropologique fondamental au procès pénal, particulièrement en matière terroriste où l'espace-temps de la justice doit permettre de remettre la parole au milieu de la cité en substitution de la violence des faits et de la sidération consécutive qu'ils ont causées. La fonction d'un procès équitable est ainsi de ne pas donner le dernier mot à la violence guerrière mais bien de juger des Hommes conformément aux valeurs bafouées de la République. Puisque assurément expliquer n'est pas justifier, les accusés doivent donc disposer d'un plein droit à la défense et à l'accès à une équité de parole afin d'être en mesure de discuter les preuves retenues contre eux et d'opposer leur vision au récit de l'instruction qui a retenu des charges à leur encontre. Cette capacité à entendre la contradiction est d'ailleurs pour le président de l'association de victimes qui s'exprimait il y a peu à la radio la preuve du retour à une échelle de valeurs qui est celle dans laquelle veut s'inscrire notre société, la seule où peut se déployer légitimement la condamnation et la peine.
Un attentat constituant le parangon de l'inaction, il est absolument essentiel que les victimes se sentent acteurs du procès pour ne plus subir l'injustice, en devenant moteurs de l'émergence de la vérité judiciaire. Mais il est tentant pour l'opinion publique comme pour certaines victimes détruites dans leur Être de vouloir projeter dans la peine une visée réparatrice de leurs souffrances. Pourtant, si la sanction pénale participe indéniablement à la reconstruction des victimes, elle ne doit être pas pensée comme thérapeutique. Il y a un écueil émotionnel dans lequel ne doit pas basculer la justice criminelle. La compassion ne doit pas se substituer à un moment de justice, à une cérémonie de parole où tout le monde est en mesure de s'exprimer et où émerge une compréhension la plus juste possible des faits et des motivations des auteurs. Le procès pénal sanctionne les actes anti-sociaux mais n'est pas là, en tout cas à titre principal, pour panser les douleurs.
Le risque du silence
En somme, l’aspiration à voir rendre justice est on ne peut plus légitime, mais elle ne doit pas conduire à un déplacement des charges avec le danger que la caisse de résonance médiatique conduise à amplifier l'appétence répressive envers les accusés. Le procès criminel est en effet par nature centré sur les auteurs qui doivent répondre des actes qui leur sont reprochés. Or, ici, le regard, y compris celui de l'Histoire, ne va pouvoir se saisir que de la présence in personam d'auteurs périphériques et laissera se déployer la douleur des victimes dont on serait tenté de faire le centre des débats.
Il y a cruelle injustice lorsqu'à l'horreur des faits ne peut répondre qu'imparfaitement la Justice des hommes qui ne peut interroger que les vivants. Les parties civiles vont également légitimement redouter le silence comme système de défense qui rendrait plus difficile l'aspiration à la manifestation de vérité. L'empathie est évidente à l'endroit des victimes et la difficulté pour la défense va être d'évoquer des éléments très factuels et qui a priori n'ont pas d'intérêt mémoriel. Sans cesse les avocats vont devoir ramener le débat sur le terrain essentiel du procès et non sur celui de l'aspiration sociale à la compensation de la douleur. La technique juridique et l'objectivité froide du fait devront primer sur les subjectivités blessées, mais vont être certainement reçus comme une violence supplémentaire insupportable pour certaines parties.
En outre, le retour potentiel à une qualification de droit commun risque d'accroître l'insatisfaction, lorsqu'il est question ici encore d'une modalité constante de la banalité du mal, d'agents qui ont contribué à un crime alors qu'ils affirment avoir ignoré la fin des moyens mis à dispositions des terroristes. Le parquet s'attachera sans nul doute ici à montrer que cette "délinquance ordinaire" (trafic de voiture, d'appartement, d'armes, etc.) constitue le terreau du crime terrorisme. Peut-être encore l'accusation ira plus loin en tentant de démontrer les accointances éventuelles des accusés à un système de valeur contraire au pacte social. Mais le risque est alors grand que tous les actes matériels soient passés par ce crible avant de rejoindre la balance de Thémis, comme un mécanisme inconscient de défense psychique où le rejet face à l'horreur peut amener à penser qu'il n'y a alors rien de commun entre le corps social jugeant et ce qu'on désir réellement punir : une idéologie mortifère. Le procès des accusés qui doivent répondre de leurs actes ne doit en tout cas pas devenir le procès d'un mouvement idéologique et criminel mondial dont ils sont éventuellement les rouages facilitants mais pas nécessairement davantage.
Sens de la peine et résilience mémorielle
L'écueil de la "dangerosité" comme boussole
En matière de terrorisme, la crainte sociale de la violence – renforcée par l'émotion des disparus – commande un désir de "plus jamais ça". Mais le risque est grand là encore, au moyen de lois sécuritaires successives, de substituer à la notion de culpabilité celle de dangerosité. Dans cette perspective de crainte de répétition de la violence, on substitue à une notion juridique un concept criminologique lié au risque de reproduction d'un acte anti-social sur la base d'une échelle prédictive critiquable à bien des égards, en oubliant le primat de la culpabilité. Tout cela répond d'ailleurs à un mythe de "l'efficacité" qui domine désormais toute procédure contentieuse. On a alors tendance à juger les potentialités des actes et non les commissions de faits constitués au regard des incriminations, en prenant en compte l'idée d'un danger potentiel, à la fois dans la qualification des faits mais encore dans le quantum de la peine qui va être décidée par les magistrats. L'interrogation cardinale doit pourtant toujours être la suivante : les éléments constitutifs de l'infraction sont-ils réunis ? On juge un auteur pour des actes, on n'indemnise pas des victimes pour un dommage. Certes la dimension de réparation n'est pas négligeable, mais elle ne constitue pas le cœur du procès criminel. De même, les surcroîts de punitivité que constituent notamment les "mesures de sûreté" viennent heurter, en droit et en valeur, le principe selon lequel l'agent criminel réintègre au terme d'une peine purgée une certaine normalité de la vie de la cité.
Du trauma des victimes à la construction d'une mémoire commune
Le temps judiciaire vient finalement construire la mémoire sociale des faits de violence de masse, tant dans son effectivité répressive que par la captation éventuelle de ce temps de la justice pour les besoins de l'Histoire. Pour autant, le procès n'est pas une commémoration visant à entretenir le souvenir. Il est un temps de réception de la parole et de prononcé de sanctions qui vont permettre de clôturer une béance de violence. Il s'agit là de la seule voie idoine pour conduire à un chemin de résilience pour les victimes, mais aussi à terme permettant d'ouvrir un travail de mémoire pour la société.
Indéniablement, le terrorisme vient façonner le droit mais aussi travailler la mémoire. Ce type de procès a en perspective le destin janusien de l'histoire et de la mémoire en établissant un pont entre la violence barbare qu'il convient symboliquement de purger par la parole et l'aspiration à la projection vers un monde pacifié où les protagonistes seraient jugés et les victimes entendues et reconnues. À cet égard, et au-delà du processus indemnitaire via un fonds de garantie spécifique (le FGTI) et la consécration d'un juge dédié – le JIVAT (Juge d'indemnisation des victimes d'attentats terroristes) –, la création d'une médaille pour les victimes de ces crimes de masse, sans évidemment réduire les souffrances des victimes, vient symboliquement reconnaître la douleur subie sans les enfermer dans cette qualité. En complément du travail historique permis par de telles captations audiovisuelles de moments judiciaires, la consécration chaque 11 mars d'une journée dédiée à la reconnaissances des victimes du terrorisme tout comme le projet de mémorial sur le sujet s'affirment alors comme des signes salutaires de résistance commune au projet de fracturation de la société porté par les actes terroristes.
---
[1] Complétée par le décret n° 86-74 du 15 janvier 1986.
[2] Les Archives nationales conservent également les enregistrements sonores ou audiovisuels des procès du sang contaminé (1993), du procès Faurisson (2007), de la dictature chilienne (2010), de Pascal Simbikangwa (2014) ainsi que son procès en appel (2016), d’Octavien Ngenzi et de Tito Barahira (2016) et leur procès en appel (2019) et enfin de la catastrophe d’AZF à Toulouse (2017).
[3] Cf. PRADEL Jean, "Les techniques audiovisuelles, la justice et l'histoire", D. 1986. Chron. 113.
[4] Exposé des motifs de la loi du 11 juillet 1985.
[5] CORNU Marie, "La constitution légale d'une mémoire orale du procès : les archives audiovisuelles de la justice", Matériaux pour l'histoire de notre temps, n° 131-132, 1er septembre 2019, p. 61-64.
[6] Cass. crim., 29 sept. 2017, n° 17-5774, AJ pénal 2017. 498 obs. Aubert.
[7] MALLET-POUJOL Nathalie, "De l'intérêt à constituer des archives audiovisuelles de la justice", Légipresse, n° 355, décembre 2017, p. 2.
[8] Rapport de Charles Jolibois n° 385, Sénat, 19 juin 1985, p. 3.
[9] Cass. crim., 17 févr. 2009, n° 09.80.558.
[10] Cass. crim., 16 mars 1994, n° 94-81.062, JCP 1995. II. 22547 note J. Ravanas.
18/10/2020