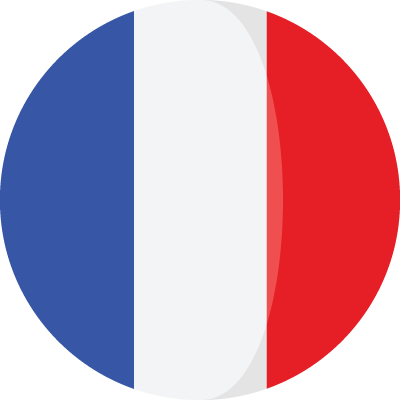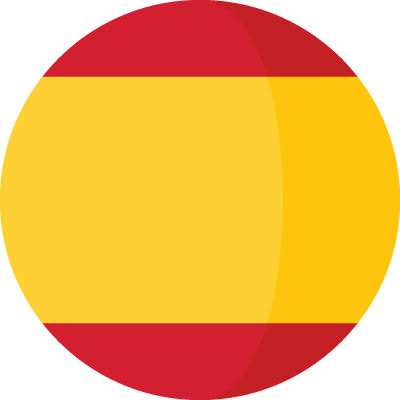[Groupe K2] Changement climatique et la mer : quels impacts sur nos territoires ? - Entretien avec Yves Henocque
06/05/2024 - 16 min. de lecture
![[Groupe K2] Changement climatique et la mer : quels impacts sur nos territoires ? - Entretien avec Yves Henocque - Cercle K2](https://cercle-k2.fr/storage/5567/conversions/Hec1-large.jpg)
Le Cercle K2 n'entend donner ni approbation ni improbation aux opinions émises dans les publications (écrites et vidéos) qui restent propres à leur auteur.
Yves Henocque est membre du bureau du Plan Bleu et président du comité Littoral et Mer de la Fondation de France.
Changement climatique et la mer : quels impacts sur nos territoires ?
Entretien réalisé par Marie Scotto, chargée de relations publiques au centre d'études stratégiques de la Marine (CESM), dans le cadre du rapport K2 "Marine et société civile".
Marie Scotto : Le GIEC met en garde depuis plusieurs années contre l’impact qu’aura le changement climatique sur les zones littorales et côtières. L’approche aujourd’hui reconnue comme la plus adéquate pour prendre ce constat en compte est la gestion intégrée des zones côtières (GIZC). Pouvez-vous expliquer ce que l’on retrouve derrière cette approche ?
Yves Henocque : C’est en 1992, avec la décisive conférence de Rio, qu’est évoqué pour la première fois dans un traité (Agenda 21) la gestion intégrée des zones côtières. Depuis, il y a eu beaucoup d’évolutions jusqu’à l’Accord de Paris de 2015 sur le changement climatique, qui pour la première fois reconnait officiellement le rôle de l’Océan et la question de l’adaptation spécifique des zones côtières.
En effet, l’interface terre-mer est un espace clé pour la vie humaine. La Gestion intégrée des zones côtières (GIZC) est devenue aussi celle de la mer selon le concept de planification des espaces maritimes (PEM). N’est-ce pas le prolongement des principes de la GIZC à l’ensemble de la Zone économique exclusive (ZEE) de chaque pays ? Si tel est l’objectif, avec l’indispensable emboîtement des échelles de gouvernance, y compris entre ZEE et haute mer (eaux internationales), il me semble que nous sommes encore loin du compte !
Le principe de gouvernance de la GIZC était que les communautés littorales participent, d’où cette forme d’intervention assez locale. C’est toujours vrai, mais dès qu’on parle de l’océan, les emboîtements d’échelles sont nécessaires. On part du local et, petit à petit, le raisonnement doit s’articuler avec les autres échelles, comme les bassins versants correspondants. On parle de ‘gouvernance polycentrique’ qui ait du sens au niveau de l’écosystème Océan. Acquérir la capacité de lier le local au global et vice-versa, car tout est interconnecté dans cet espace Océan à trois dimensions qui interagit en permanence et qui façonne le littoral où les hommes vivent. "Penser Global, Agir Local" et ensemble, c’est bien l’esprit du Sommet de la Terre de Rio de 1992.
Par exemple, c’est bien à partir des bassins versants qu’il est fondamental d’intervenir, ne serait-ce que pour limiter, éliminer et traiter les apports polluants qui finissent tous dans la mer. On dit bien que la pollution marine est à 80% d’origine terrestre, du haut du bassin versant au littoral. Cette approche concerne également la mer par rapport aux activités traditionnelles (pêche, dragages, tourisme, transport maritime…), mais doit intégrer le développement des nouvelles activités comme l’éolien en mer et les infrastructures portuaires qui l’accompagnent.
Vouloir parler de gestion de l’écosystème est assez irréaliste, on prétend intervenir mais le système fonctionne sans nous. En revanche, lorsque nos activités le fait dysfonctionner, c’est sur ces dernières qu’il faut agir, changer radicalement nos pratiques. On est très loin de connaître les facteurs qui régissent la structure et le fonctionnement de ces écosystèmes. Donc avant tout, avec la GIZC, on cherche à agir sur les pratiques de gestion, sur l’ensemble des secteurs qui interviennent et qui impactent le milieu naturel, tout en faisant vivre les hommes.
M. S. : Qu’en est-il en France ? Quelles mesures et stratégies ont été adoptées ? Quelle méthodologie a permis leur élaboration ?
Y. H. : En 2002 une Recommandation de la Commission européenne sur la GIZC a fait suite à toute une série d’expérimentations en Europe, servant à comprendre son fonctionnement, avec des analyses comparatives très poussées. La France, comme bien d’autres pays européens, s’en est nourrie.
Même si la France n’a pas de stratégie nationale de GIZC à proprement parler, elle a su très tôt prendre des décisions, y compris sur les plans juridique et institutionnel, qui relèvent fortement des principes de GIZC. Environ dix ans à peu près après la création du Conservatoire du Littoral en 1975, était promulguée en 1986 la fameuse Loi Littoral proposée par Louis Lengagne et adopté sous le ministère de Louis Le Pensec pour notamment lutter contre l’urbanisation du littoral. Ce sont des inventions juridique et institutionnelle fondamentales en termes de préservation du littoral. L’urbanisation de nos côtes serait bien plus importante aujourd’hui sans cette loi, sans le Conservatoire du Littoral qui, jusqu’à aujourd’hui, n’a cessé de racheter des terres pour les préserver des mains des promoteurs immobiliers.
Du côté bassin versant, il convient de mentionner la politique de l’eau en France, jusqu’à 1 mille au-delà du bord de mer : la préparation, via les Comités de bassin, des Schémas d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) pour les quatre grands bassins côtiers de la métropole est un exemple de gestion intégrée de l’eau et des milieux aquatiques. Le défi pour l’avenir est leur articulation opérationnelle avec les tous récents Documents stratégiques de façade (DSF) qui couvrent le milieu marin. Il reste encore beaucoup à faire pour rapprocher les mondes terrestre et maritime !
M. S. : Ces mesures doivent faire face à des exigences contradictoires de l’ensemble des usagers de la côte et du littoral (pêcheurs, plaisanciers…). Comment ces exigences sont-elles entendues et prises en compte dans la mise en place de la GIZC ?
Y. H. : Effectivement, cela revient en permanence. Les élus des communes et communautés d’agglomération du littoral disent tous que la loi Littoral permet de limiter l’urbanisation et protéger le littoral, mais il la considère en même temps comme un frein au développement territorial tel qu’ils l’entendaient jusqu’à aujourd’hui, c’est-à-dire selon des critères d’aménagement du territoire et de développement du tourisme (résidences secondaires !) qui, ils le savent, doivent changer aujourd’hui. Nous ne sommes plus à l’heure d’une urbanisation effrénée mais raisonnée dans un contexte d’adaptation aux effets du changement climatique. Aujourd’hui, aux côtés de la loi Littoral, il y a la loi zéro artificialisation net (ZAN) par exemple, mais également bien d’autres, qui forment un ensemble juridique conséquent mais pas nécessairement toujours très cohérent, ce qui est un vrai casse-tête en matière d’application pour les élus. Ces derniers sont pris en tenaille entre plus d’exigence environnementale afin de préserver les milieux, et la nécessité du développement de leur territoire pour pouvoir notamment financer ces politiques environnementales. N’oublions pas que les taxes locales, en particulier provenant des résidences secondaires et du tourisme représentent une part importante des budgets municipaux, et qu’une des règles issues de la loi est qu’il n’y a pas d'indemnisation pour l'érosion côtière en France dès lors qu'elle est prévisible et irrémédiable.
Il n’y a donc pas de recette miracle et plutôt une multitude de cas particuliers. Les principes de la GIZC restent fondamentalement valables, dans le sens où le salut ne pourra se faire que dans la concertation avec tous les acteurs territoriaux. Un changement de paradigme s’impose pour penser de manière systémique sur le court, moyen, et long terme pour briser cette approche en silo et au coup par coup.
L’espace littoral est limité, rare, et menacé. Il faut donc absolument qu’existent les instruments de concertation au sens fort du terme, c’est-à-dire de nouvelles formes de gouvernance, un nouveau contrat démocratique entre élus, entreprises, et société civile. On peut avoir autant de lois nationales que l’on veut, c’est toujours au niveau local que cela se passe ensuite. On voit ainsi des élus qui, dans leur gouvernance même, se rapprochent de la société civile, notamment à travers les associations pour mettre en œuvre des initiatives qu’ils n’auraient pu entreprendre d’eux-mêmes. Ils ont effectivement besoin d’eux car techniquement, devant tant de complexité, ils sont démunis pour intervenir, d’autant plus qu’ils disent tous que les services techniques traditionnels de l’État ont disparu. Ils ont ainsi compris qu’il va falloir changer de paradigme.
Et aujourd’hui, cette vision s’étend au-delà des plages, vers la mer, là où vont se construire les parcs éoliens en mer, le raisonnement étant que ces éoliennes vont se développer inévitablement au nom de la transition énergétique, et que dans ces conditions il importe de faire en sorte qu’ils soient aussi des leviers de développement économique et social des territoires.
M. S. : Ces stratégies, bien que liées, sont déclinées à différents échelons. Suffisamment de moyens sont-ils alloués aux échelons régionaux et locaux pour la planification du territoire côtier ?
Y. H. : La réponse est clairement non. D’une part, la décentralisation de 1982 n’a jamais été achevée et, d’autre part, il y a une immense différence entre l’échelon régional et local. Les régions ont un rôle stratégique avant tout, elles aident et financent ce qui se passe au niveau des départements et communautés d’agglomération où les moyens manquent.
Les menaces qui préoccupent le plus les élus du littoral sont la montée du niveau de la mer, l’érosion, la rareté de l’eau (notamment par rapport à la demande estivale), et les submersions qui surviennent lors des périodes de pluie intense combinées à des grandes marées. Pour faire face à ces aléas naturels qui s’accentuent avec le changement climatique, des moyens de plus en plus considérables sont nécessaires.
On est plus dans l’époque des enrochements de haut de plage (quoique cela se pratique encore beaucoup !), ou de constructions de digues… Même l’État encourage ce qu’on appelle dorénavant les solutions fondées sur la nature, sur les dynamiques naturelles : réaménager l’habitat, surélever ou revégétaliser des dunes, ouvrir les polders pour laisser entrer la mer et accepter leur maritimisation… C’est tout un ensemble de techniques menées en concertation, qui montrent qu’on peut faire autrement tout en acceptant qu’à certains endroits la côte va reculer. Cela veut dire que les élus vont devoir déplacer ou relocaliser des habitations construites trop près des côtes. Rappelez-vous, les anciens habitants du littoral ne construisaient jamais à proximité immédiate du bord de mer. Ce sont donc des problèmes fonciers, financiers, humains, de relocalisation pour lesquels les communes n’ont pas de réponse. Notons que la Stratégie nationale du trait de côte se met en place, mais l’enjeu va être la capacité de l’État central de se mettre en marche avec les élus locaux pour s’adapter aux spécificités de chaque territoire, et là, le dialogue est loin d’être fluide !
M. S. : Vous avez travaillé sur le sujet à l’international, dans l’Océan Indien et en Asie-Pacifique notamment. Alors à l’international, qu’en est-il ? De quelle manière cette approche a-t-elle été adoptée dans d’autres pays et mise en œuvre ?
Y. H. : J’ai effectivement beaucoup travaillé avec les îles du sud-ouest de l’Océan Indien où les pays de l’Asie-Pacifique. Il y a là-bas énormément de projets financés par des bailleurs de fond internationaux, dont l’Union européenne en partenariat avec les pays. Les résultats sont très inégaux, parce qu’on a beaucoup mis l’accent sur l’environnemental et beaucoup moins sur l’économique dans des pays qui sont souvent en voie de développement. A tort, le secteur privé à l’époque n’était pas concerté et donc concerné, et il l’est encore trop peu ! A mon avis, c’était trop une affaire environnementale, qui engageait certes les associations, les politiques, mais pas le secteur privé - qui était pourtant le moteur du développement de ces pays – dans les efforts de planification concertée. Tout n’est pas nul et non avenu, il y a eu certainement des choses, qui par petits bouts, ont surtout permis aux mentalités d’évoluer, à une prise de conscience progressive des problèmes qui allaient à l’encontre de la qualité des milieux et donc de la qualité de vie.
Localement mais aussi internationalement, les deux vont de paires, il y a une évolution générale des mentalités, mais tout cela va très lentement alors que les changements eux, vont très vite. Aujourd’hui, tout le monde s’accorde pour dire (pas toujours pour faire) qu’il faut inclure le secteur privé. Dans les faits, on a encore un fossé gigantesque entre les tenants de la protection de la biodiversité et les tenants du développement. Cela s’exprime très bien dans le concept de l’économie bleue auquel, pour rassurer tout le monde, on ajoute le terme de ‘durable’. Le danger du développement, parce qu’il est sous-tendu par cette logique capitaliste de profits à court terme, c’est qu’il se fait forcément au détriment de la qualité environnementale qui, elle, se joue sur le long terme.
C’est cette contradiction majeure qu’il va falloir résoudre. Il va falloir que le secteur privé commence à comprendre qu’on ne peut pas continuer comme ça, que la qualité environnementale se dégrade au détriment de tous, sans exception. Tout cela évolue, mais on avance encore trop par petites touches, avec un manque flagrant de coordination. On a les couleurs, mais on n’a pas la vision du tableau ! Les contradictions fondamentales qu’on retrouve dans les grandes réunions internationales sont criantes. Le choix des énergies renouvelables vs. les énergies fossiles ne se pose pas qu’à la COP28 mais finalement pour chacun d’entre nous : qu’est ce qui alimente ma voiture par exemple, et d’où vient cette énergie ?
M. S. : Plusieurs années après la mise en place des premières actions en la matière, peut-on déjà observer une évolution sur le territoire (des mentalités, sur l’environnement…) liée à cette nouvelle approche ?
Y. H. : J’ai parlé de toutes ces hésitations et faiblesses en termes de résultats, mais il y a une vraie évolution des mentalités. C’est grâce au changement climatique et ses conséquences locales que l’homme a commencé à se poser des questions sur ses propres activités : on est dos au mur. L’espèce humaine est comme ça, c’est quand elle est dos au mur qu’elle commence à réagir. Je pense que les mentalités évoluent énormément, de plus en plus vite, mais le problème est que les changements interviennent de manière beaucoup plus rapide.
Il faut tenir compte de ce qui est en train de se passer, à la fois ce que l’on voit et ce que l’on ne voit pas. Particulièrement pour les océans, ce milieu à trois dimensions qui reste invisible au commun des mortels. Les pêcheurs le savent et peuvent en parler (quoiqu’ils n’aiment pas trop le faire !), notamment quant à leurs observations sur l’évolution des captures et des espèces qui les composent. Ainsi, les pêcheurs bretons comme ceux de la Méditerranée se retrouvent à pêcher de plus en plus des espèces qu’on ne trouvait avant que dans le sud.
Au niveau du début de la chaine, phytoplancton et zooplancton par exemple, il est en train de se produire des changements énormes. De même pour les récifs coraliens avec le blanchiment des coraux, selon un cycle où toute espèce est remplacée par une autre tant que la qualité environnementale ne s’effondre pas pour donner lieu à des ‘zones mortes’. La question est de savoir si les espèces remplaçantes, comme, par exemple, la prolifération des méduses, sont bénéfiques pour l’homme ? Il faut bien être conscient que tous ces changements, qu’on ne voit pas nécessairement, vont aller grandissants et auront un impact très important sur l’homme. On l’a vu avec la libération des virus. Des travaux scientifiques ont montré qu’avec la fonte des glaces, de nouveaux risques sanitaires pouvaient apparaître. On prend conscience de manière plus ou moins confuse que dans et sous les glaces, il y a de la vie, y compris microscopique. Les scientifiques ont même leurs propres controverses sur tous ces sujets.
M. S. : Vous êtes spécialiste des écosystèmes marins. Au-delà de la gestion intégrée des zones côtières, quel constat portez-vous sur les évolutions de ces écosystèmes depuis que vous les étudiez ?
Y. H. : Je n’ai pas une vision noire. Je crois beaucoup en la résilience de la nature. Elle est beaucoup plus ancienne que nous. Elle a des milliards d’années. Elle a su faire face à des cataclysmes fantastiques : les fameuses météorites qui sont tombées sur la terre, l’extinction des dinosaures, le changement radical du climat... A chaque fois la nature a trouvé des réponses, mais toujours sur le long terme et souvent dans des conditions qui auraient été invivables pour l’Homo sapiens d’aujourd’hui. Avec les insectes, l’homme a certainement montré qu’il avait des capacités d’adaptation fantastiques, mais on est aujourd’hui face à des évolutions très rapides, jamais connues auparavant.
Je ne suis pas trop inquiet pour notre planète. On aura toujours des écosystèmes qui fonctionneront d’une manière ou d’une autre, mais par rapport aux services qu’ils nous rendent, notamment la nourriture et les supports de vie (par exemple l’oxygène), cela peut vite devenir invivable pour nous. Le monde continuera à exister, il se sera adapté, mais il est possible que pour nous cela devienne invivable. Ça n’a rien d’extraordinaire, cela est déjà arrivé par le passé. L’homme n’était pas là, mais cela a été invivable pour les organismes présents, même s’ils se sont régénérés ou, d’une manière ou d’une autre, ont fait place à de nouvelles espèces par la suite. Les dinosaures ont disparu, mais il y a eu autre chose derrière. Je vois ça comme une sorte de cycle.
Mais la question est finalement : est-ce qu’on va réussir à faire en sorte, par rapport à nos activités, de mettre en place un autre mode de gouvernance, à réussir à maintenir ce monde vivable pour nous ? Sachant qu’en 2050 on sera 9 milliards d’individus, la pression démographique de l’espèce humaine ne va cesser d’augmenter. L’homme, quoiqu’en pensent certains, n’échappera pas aux lois de la nature : à un moment donné, comme cela est survenu par le passé, il y aura nécessairement des phénomènes de régulation : des virus, des cataclysmes, sans parler de nos capacités d’autodestruction avec la guerre… L’autre alternative est celle où l’homme va détruire le propre monde dans lequel il vit et disparaitra avec lui.
Concernant les écosystèmes marins, il y a des zones aujourd’hui, « les hot spots » de biodiversité, où les écosystèmes vont encore bien. Le problème est que même si on a des zones où les écosystèmes sont relativement sains, l’écosystème global ne commence à montrer des dysfonctionnements du fait, par exemple, des changements de parcours des grands courants marins comme le Gulf Stream. A un moment ou à un autre, cela va inévitablement se répercuter sur des écosystèmes qui vont encore plutôt bien. Un exemple : on croyait que dans les grands fonds, les écosystèmes à la très abondante biomasse des sources hydrothermales resteraient intacts de tout impact. En fait, on se rend maintenant compte que le changement climatique, ne serait-ce qu’en termes de température, a des effets jusque dans les grandes profondeurs où vivent ces écosystèmes. C’est la même chose pour le plastique : le plastique produit par l’homme se retrouve sous forme de microplastiques ingérés par les organismes vivants dans des fonds allant jusqu’à 5-6000m et plus. Cela montre bien que ce monde marin est totalement interconnecté et que c’est l’ensemble qu’il faut considérer.
Cela pose aussi la question des fameux 30% de protection de la biodiversité marine à travers les aires marines protégées. Si on protège certaines zones, même en protection forte, mais qu’à côté de celles-ci, on est dans un milieu complètement ou de plus en plus pollué, alors cela ne sert à rien. Ce n’est pas suffisant. On peut protéger ces zones, mais dans un système interconnecté et à trois dimensions comme le système ‘mer’, on ne peut pas raisonner comme s’il y avait une cloison étanche avec le reste. Il faut également se préoccuper du reste.
On revient à cette notion de GIZC, qui implique que c’est 100% de ce système qu’il faut réussir à gérer d’une manière ou d’une autre. Et pour commencer à le gérer et comprendre ce qui se passe, il faut en étudier l’évolution, donc faire de l’observation. On a aujourd’hui un réseau d’observation mondial qui commence à être significatif au niveau des mers et de l’océan global. Ce qu’il nous manque c’est ce qui se passe au fond. On est dans un système à 3 dimensions : la surface, la colonne d’eau, et le fond. Plus on s’éloigne de la terre, plus cela devient compliqué. Il se passe énormément de choses dans cette colonne d’eau. C’est aussi un habitat. Il faut vraiment arriver à comprendre, par rapport à nos activités, quels seront les impacts sur la colonne d’eau et le fond. Je fais plus particulièrement allusion à cette menace de l’exploitation à venir des minerais des grands fonds et de ce qui va advenir aux nuages de métaux lourds qui vont se répandre dans toute la colonne d’eau avec l’aide des courants. La courantologie des océans, c’est aussi une question majeure, avec le Gulf Stream qui régule le climat sur nos côtes et commence à être dévié par le réchauffement climatique. Demain, on peut avoir des impacts globaux comme celui-ci qui auront des conséquences locales très importantes sur les écosystèmes.
On est et on vit dans l’incertitude. Dire aujourd’hui que tel écosystème va bien ou non, en est-on bien sûr par rapport à ce qu’il a été il y a des centaines ou milliers d’années auparavant ?! Restons humbles. Vu la résilience éprouvée du système, je ne suis pas de ceux qui disent que tout va mal, mais il est temps de se préoccuper de la connectivité du système. On ne réglera pas les problèmes de la nature, de la structure et du fonctionnement des écosystèmes, mais on réglera le problème du bon fonctionnement de ceux-ci, en gérant les activités qui les impactent.
06/05/2024