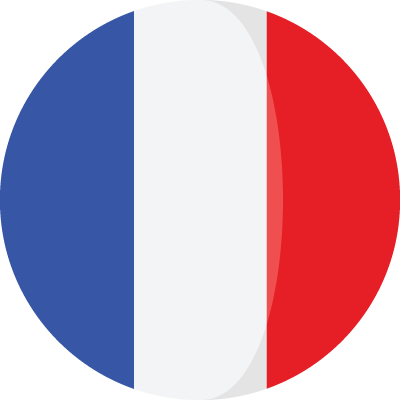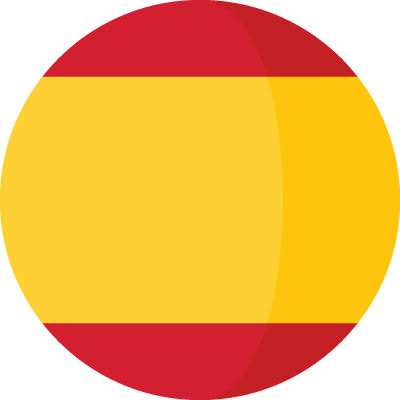Le Cercle K2 n'entend donner ni approbation ni improbation aux opinions émises dans les publications (écrites et vidéos) qui restent propres à leur auteur.
Francis Beau est Docteur en Sciences de l'information et de la Communication & Chercheur indépendant.
---
un seul chef, les meilleurs "aux manettes", la puissance du peuple "sous le capot", la Raison, grande Cause publique, pour seule "transcendance" portée par l’intérêt général
Pour mieux cerner la notion moderne de démocratie, on peut s’intéresser aux trois bons régimes politiques ou « gouvernements purs » dont Aristote nous a décrit les « corruptions »[1] possibles. On observe ainsi que les déviances qu’il dénonce sont en réalité contenues dans le mot même désignant le régime, au moins pour les deux premiers d’entre eux. La monarchie[2], tout d’abord, qui correspond au commandement d’un seul, dérive ainsi tout naturellement vers la tyrannie car le monarque, seul aux commandes, détient alors un pouvoir qu’il mettra en priorité, tout naturellement et assez inévitablement, au service de ses intérêts particuliers. L’aristocratie[3], ensuite, qui correspond au pouvoir des meilleurs, c’est-à-dire les mieux dotés par la nature, dérive aussi tout naturellement vers l’oligarchie (l’exercice du pouvoir par quelques-uns), car la tentation est trop grande pour les aristocrates de détourner ce pouvoir au profit de leur propre groupe. Quant au troisième bon régime, c’est celui de la politeía (πολιτεία, « la Cité ou l’État »), que l’on traduit souvent à la suite des auteurs latins par « république »[4], et dont la dérive serait une démocratie synonyme de démagogie. Il en va donc autrement de ce troisième « gouvernement pur » dont la déviance dénoncée par Aristote n’est pas véritablement portée par le sens du mot « république », pas plus qu’elle ne l’est par le sens moderne du mot « démocratie » dont la dérive démagogique souvent pointée du doigt mérite néanmoins que l’on s’intéresse de près à son usage républicain.
La démocratie[5], étymologiquement, le pouvoir ou la puissance au peuple, peut en effet selon Aristote être entendue au sens de « démagogie »[6], comme une déviance possible de la république. Pour que le peuple puisse exercer le pouvoir, il lui faut toute la puissance que lui confère sa masse exprimée par une majorité dont la conduite ne peut en effet se passer de séduction pour « attirer » (agôgos) librement, sans faire appel à la contrainte. La république (ou la démocratie au sens noble du terme qui reste à préciser dans le contexte républicain), peut ainsi se transformer en démagogie lorsque le peuple se laisse séduire par les promesses électorales de ses représentants. La majorité ainsi élue est alors susceptible, comme l’observe Aristote, de commander une conduite « déraisonnable » des affaires publiques. Elle se montre en effet peu disposée à prendre les décisions nécessaires au bon fonctionnement de la « chose publique », car elle s’appuie plus sur l’affect que sur la raison synonyme de cause ou de motif, qui traduit la faculté d’exprimer une relation de cause à effet donnant tout son sens à l’action politique comme à n’importe quelle activité intellectuelle ou consciente visant à entraîner ou à convaincre.
Fort du constat des déviances possibles de ces trois « bons régimes », Aristote préconise une combinaison équilibrée de la politeía (la république) et de l’aristocratie. Aujourd’hui, je crois en effet que pour s’exprimer pleinement, la démocratie entendue au sens moderne du terme, plus vertueux car donnant au peuple la place qui lui revient de droit, doit être à tout prix débarrassée de cette déviance démagogique. Perçue en son temps par Aristote, cette dérive est en particulier abondamment rencontrée de nos jours, avec l’extraordinaire envolée de la puissance des média associée à l’avènement des réseaux sociaux. Pour s’en préserver, la démocratie doit pouvoir s’exercer au sein d’une République qui ferait la synthèse des deux autres « bons régimes » monarchique et aristocratique en évitant leurs déviances respectives tyrannique ou oligarchique. C’est d’ailleurs ce qu’a tenté de faire la démocratie américaine en alliant démocratie (Representatives), aristocratie (Senate) et monarchie (President, Commander in Chief), se distinguant ainsi de la démocratie grecque, pour se calquer plutôt sur la République romaine[7]. C’est également l’esprit de notre Vème République voulue par le général de Gaulle, qui repose sur un Président chef des armées (un monarque), un Sénat (une aristocratie) et une Chambre des Députés (les représentants du Peuple). Dans ces deux exemples pourtant, la dimension républicaine de l’autorité accordée au peuple mérite à mon sens d’être approfondie.
Il faut donc avant tout penser la République telle qu’Aristote nous le propose en recommandant une « combinaison équilibrée » de la démocratie avec l’aristocratie, comme un moyen d’utiliser la puissance du peuple (démocratie) en y attelant la compétence des meilleurs (aristocratie), tout en évitant la corruption oligarchique de l’aristocratie ainsi que la déviance démagogique de la démocratie. Afin de contrer la dérive oligarchique, l’ensemble doit être impérativement placé sous l’autorité suprême d’un véritable chef d’État disposant d’une souveraineté pleine et entière, suffisamment stable pour éviter l’écueil démagogique, mais néanmoins soumise à l’intérêt général pour éviter la perversion tyrannique de la monarchie. La République, en effet, c’est cette « Chose publique », res publica, que l’étymologie du mot res, la « chose » rattache à la notion de « cause », sens qui lui était donné dans un latin populaire de la fin de l’empire romain. Devenant publique, elle est cette Cause souveraine élevée au rang de
« Valeur » sacrée, garante de l’intérêt général[8].
Pour naviguer en toute sécurité dans les eaux agitées de la scène internationale et se maintenir à l’intérieur dans les eaux calmes du havre de paix que seul un État souverain est en mesure d’assurer, le vaisseau républicain doit être propulsé par des moteurs disposant de toute la puissance (kratos) de son peuple (dêmos) que lui procure sa masse ou le nombre, soit la « démocratie ». Disposant ainsi de la source d’énergie démocratique, il doit ensuite être conduit (agôgos) par un équipage recruté parmi les meilleurs (aristos)[9] et commandé par un seul homme (mónos), un commandant, un chef (arkhós), soit un « monarque », seul maître à bord après la transcendance absolue de cette « Chose » publique, la République, élevée au rang de grande « Cause » sacrée au service de l’intérêt général, donnant tout son sens à l’action politique.
Deux questions clés viennent alors immédiatement à l’esprit, celle fondamentale, du choix d’un chef, dans un cadre républicain excluant tout recours à l’hérédité et à une transcendance de nature divine, et celle du recrutement et de la formation des meilleurs, qui s’y rattache. La réponse à ces deux questions est à rechercher selon moi dans deux domaines : celui du lien étroit entre éthique et politique dont on va voir qu’Aristote nous suggère l’approfondissement, ainsi que celui de la relation entre nombre et unité ou entre collectif et individu, au regard de l’ordre républicain.
Chez Aristote en effet, éthique et politique sont étroitement liées, l’éthique s’appliquant à l'individu et la politique à la Cité. S’agissant de la nation organisée en État souverain (équivalent moderne de la Cité antique), considérée comme une personne morale une et indivisible, soit un individu libre et responsable, éthique et politique se trouvent dès lors réunies dans une seule et même discipline que l’on pourrait nommer « éthique politique ». On préfèrera néanmoins éviter d’utiliser cette expression qui désigne souvent, « en confondant éthique et morale, l’introduction, l’adoption ou la recherche d’une certaine morale en politique, impliquant ainsi un rapprochement entre morale et politique »[10]. En octroyant aux responsables politiques un droit à définir ce qui est bien et ce qui est mal, ce rapprochement conduirait en effet inéluctablement à une politisation de l’espace privé qui marque bien souvent le début de toutes les dérives totalitaires.
L’éthique en effet, cet « ensemble réfléchi et hiérarchisé de nos désirs fait de connaissances et de choix »[11], est à l’individu ce que la politique doit être au collectif : une conscience aiguë de l’impérieuse nécessité de compter avec l’autre, soit le souci de l’intérêt général élevé au rang de valeur suprême. Compter avec les autres, accepter leurs différences et leurs défauts, chercher à les comprendre sans pour autant nécessairement les approuver en particulier lorsque leurs idées semblent incompatibles avec l’intérêt général, c’est en effet la base incontournable de tout échange, de toute relation ou de toute négociation à l’échelle individuelle, familiale, associative ou professionnelle, qui est celle de l’éthique, comme à l’échelle collective, nationale ou internationale, qui est celle de la politique.
Le souci de l’intérêt général, cette grande « Cause publique », c’est bien la transcendance absolue à laquelle doit être soumis le monarque républicain, ainsi que tous les rouages républicains de l’action politique. C’est une Cause qui doit diriger l’action en lui fixant son but, soit une finalité, point de fuite de toute activité intellectuelle ou consciente qui lui donne tout son sens en s’appuyant sur la Raison ou le discours qui la structure, soit le logos grec. Contrairement à ce que pourrait laisser croire l’idée de rationalité dérivée du latin ratio, du calcul s’appliquant au numérique, la raison serait plutôt ce qui relève d’une relation de cause à effet, s’appliquant au domaine analogique de la pensée. La raison ou la pensée qui la porte, est donc indissociable de cette notion de cause associée à l’idée d’analogie que Thomas d’Aquin, à la suite d’Aristote, assimile à une identité de relation, inspirée de l’égalité de proportion mathématique. L’analogie, selon lui, permet ainsi de formuler par inférence, un jugement sur les objets qui s’offrent à la connaissance, pour établir un savoir.
Or, en démocratie, on a vu que la majorité élue exerçait pour le peuple toute la puissance que lui procurait sa masse, soit une quantité ou un nombre. Le problème est que ce nombre se trouve malheureusement trop souvent, privé du sens que seule l’unité est en mesure de lui procurer. Sans cette unité portée par l’universalité du verbe (logos), et que la quête permanente de l’intérêt général conditionne, le pouvoir se vide en effet de tout sens. Il perd ainsi la tête et s’engage, comme le souligne Aristote, dans une conduite « déraisonnable » des affaires publiques. Sans ce lien fondamental que seule la Raison peut tisser entre le nombre et l’unité, la démocratie, soit le pouvoir du collectif sur l’individu, se trouve amputée des deux jambes sur lesquelles repose son fragile équilibre, l’autorité de l’État et la souveraineté du peuple. « Autorité et souveraineté sont en effet aussi indispensables l’une que l’autre, tant pour le traitement du collectif que pour la préservation de l’individu, qui sont les deux conditions premières de cette délicate alliance consubstantielle à la démocratie, entre confiance collective et responsabilité individuelle »[12].
Dans notre « société de l’information » encore en pleine gestation, il faut à tout prix éviter ce mouvement de balancier mortifère « entre totalitarisme déshumanisant, individualisme désocialisant et communautarisme destructeur » dont l’histoire récente nous a donné maints exemples, et que je dénonçais dans une tribune précédente[13]. Les discours scientifiques sur le thème de la société de l’information, le logos ou la Raison qui les porte, relèvent d’une sorte d’anthropologie politique à la fois prospective et historique : ils doivent accompagner « l’homme à venir » dans la Cité du futur, et permettre en même temps d’inscrire les bouleversements attendus de la révolution informatique en cours, dans la lignée des grandes mutations culturelles et politiques du passé liées à l’invention de l’écriture puis de l’imprimerie. Bien que l’expression se soit désormais banalisée en s’invitant dans le langage courant, ce concept de « société de l’information » est en effet encore très loin de refléter l’immense variété du champ des possibles en matière d’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication, et de leurs répercussions sur les évolutions de nos sociétés hyperconnectées. Ces dernières sont en particulier soumises à un véritable séisme, dont l’épicentre a pris le nom de cyberespace pour caractériser ce nouvel espace de développement rendu possible par l’interconnexion mondiale des ordinateurs en réseau. Cette utilisation très technologique du mot cybernétique, qui a fait la fortune du préfixe cyber, ne doit pas néanmoins détourner notre attention du facteur humain, que nous suggère pourtant fortement l’étymologie[14]. L’humain doit impérativement jouer un rôle majeur, dans l’avènement de cette nouvelle société de l’information.
La République ou « Cause publique » doit ainsi être portée en tête de cette véritable révolution cognitive, qui impose la mise en œuvre de systèmes d’information affranchis du carcan des technologies informatiques, sans toutefois se priver de leur puissant soutien. Conçus comme de véritables mémoires collectives, ces systèmes peuvent prendre pour modèle notre mémoire individuelle afin d’assurer un
« dialogue fluide entre des intelligences artificielles qui se nourrissent de données massives pour leur apporter de la consistance par le calcul, et des intelligences humaines qui perçoivent ces données avec discernement pour concevoir de la connaissance et produire les savoirs individuels utiles à l’action collective ». Ce dialogue est « celui qu’il faut assurer en société entre le nombre (objet public) dont se nourrit l’échange, et l’unité (personne publique) qui l’anime ». L’action publique doit pouvoir « vivre de ce dialogue permanent et l’animer, grâce à de véritables systèmes d’information et de communication fondés, bien entendu sur ces technologies numériques qui transforment en profondeur nos sociétés modernes, mais aussi et surtout sur les humanités (les sciences humaines) qui, comme la pensée et la langue qui la porte, sont analogiques »[15].
Cette grande « Cause publique » qui forge le sens de l’État, doit pouvoir s’appuyer, dans une démarche à la fois scientifique et politique, sur une intelligence collective capable d’élaborer une véritable pensée commune grâce aux connaissances acquises avec la tenue d’une documentation scientifique organisée en mémoire collective. À l’heure où l’intelligence artificielle nous propose le remplacement du verbe (le logos) et du savoir-faire (la praxis), par le logiciel et la technologie, il semble important de se poser la question du sens. Cette question est en effet au cœur de toute stratégie de maîtrise de l’information. C’est le besoin impérieux d’y répondre face à l’invasion massive des données disponibles, qui légitime l’adoption d’un mode de classification et d’un langage documentaire associé susceptible d’organiser une documentation partagée.
La conscience politique qu’une documentation scientifique permet de façonner, en dotant la Politique de cette intelligence collective, sans laquelle toute « science » politique « ne serait que ruine de l’âme », doit reposer sur la mise en œuvre d’un langage de raison susceptible de donner un sens commun à l’action publique. Ce sens commun devenant sens de l’État peut s’appuyer dès lors, sur le fonctionnement analogique d’un langage documentaire univoque à usage universel, appliqué à l’organisation d’une pensée collégiale. Le document est en effet à la mémoire collective, ce que le verbe est à la mémoire individuelle : un instrument de transmission de sens. Sous la forme électronique qu’il revêt désormais la plupart du temps à l’heure des réseaux numériques, le document demeure l’interface incontournable entre la donnée, qui est numérique ou de nature à être numérisée, et l’information accessible à la pensée humaine exprimée par la langue sous forme d’idées, qui sont par essence analogiques. C’est bien sur l’organisation d’un langage documentaire partagé par tous, en s’inspirant des processus d’élaboration analogique de la pensée dans notre mémoire, que peut reposer la méthode de travail en commun indispensable à une pratique collective de la science politique.
Au-delà du traitement des données que l’informatique, les systèmes de gestion des bases de données et l’intelligence artificielle réalisent de mieux en mieux, ce qui fait l'essence même d'un véritable système d'information à vocation politique, c’est sa capacité à organiser une pratique collective de l'exploitation de ces données. Il doit permettre aux représentants du peuple, soit un nombre dont l’unité se concrétise autour d'une fonction républicaine au service de l’intérêt général, d'exploiter les données de masse générées par le collectif, pour donner du sens à l’action individuelle de chacun. Aux automatismes que les technologies informatiques permettent actuellement d'apporter en traitant ces données massives, il faut impérativement désormais ajouter une couche autant technologique que méthodologique, permettant un traitement intelligent des documents. C'est ce que les professionnels de la sécurité nomment renseignement de documentation, discipline que les services pratiquent de longue date, mais dont l’organisation peine tant à profiter pleinement des bouleversements technologiques en cours. Il s'agit pourtant, en réalité assez simplement, de permettre la pratique collective d'une mémoire dont le document et l’énoncé qu’il porte sont respectivement le principal instrument et la matière première, comme la langue et la pensée qu’elle porte sont le principal instrument et la matière première de nos mémoires individuelles.
Le mode de fonctionnement de cette mémoire collective (ou système d’information), doit donc reposer sur l’adoption d’un langage documentaire naturel conçu à l’image de la langue, rationnel et normalisé à l’échelle de la collectivité, dont l’organisation peut s’inspirer des processus d’élaboration analogique de la pensée dans la mémoire. J’ai montré dans un travail de thèse sur l’exploitation du renseignement[16] que ces processus pouvaient s’appuyer sur une grammaire organisant la transmission du sens en réponse aux besoins d’une collectivité : la structure sémantique encadrant cette grammaire s’inspire des grands systèmes de classification élaborés dans le passé, pour assurer la pertinence de l’information au regard des besoins du collectif. Le langage s’organise ainsi à partir d’une planification collective de l’activité documentaire du groupe au moyen d’une grammaire du sens que l’on dira
« générative » au sens de Chomsky, car elle permet une catégorisation et une indexation analogiques des contenus dans une mémoire partagée, dont on peut souligner le caractère évolutif à l’infini[17]. Cette structure s’inspire en effet de celle de la langue dans notre mémoire, dont on peut considérer qu’elle se réalise à partir d’une planification mentale de notre activité verbale réalisée par la grammaire. On peut en observer l’aspect à la fois sémantique porté par une catégorisation/indexation analogique des concepts, et génératif qui permet une évolution infinie des catégories/index[18], donc du discours et de la pensée qu’il guide, en même temps qu’il permet sa communication.
Une pensée politique peut dès lors être élaborée collectivement, tout en demeurant, à l’image de notre pensée ordinaire, « essentiellement pratique et orientée vers l’action ». La « grille conceptuelle[19] à travers laquelle elle perçoit les objets » de la réalité reste en effet, « déterminée par la situation qui nous met en relation avec eux et par notre intention envers eux ». Comme notre pensée ordinaire, « en regard de la complexité illimitée de ces objets, cette pensée » collective « est simple »[20]. Elle procède d’une démarche fonctionnant à l’inverse de la démarche scientifique parfois ardue, en ne recherchant pas comme cette dernière, la cause qui détermine l’effet observé pour l’expliquer, mais bien plutôt l’effet désiré en relation avec la « Cause », qui détermine l’action à entreprendre en lui donnant sens, renouant ainsi avec la racine grecque du mot cybernétique. Elle ne s’oppose pas à la démarche scientifique, mais la complète : pour décider avant d’agir, il faut d’abord connaître la situation à laquelle l’action va s’affronter en expliquant l’enchaînement de relations causales qui l’ont engendré, mais il faut aussi anticiper cette action en cherchant à comprendre les conditions de sa réalisation, en saisir ensemble les différentes facettes, soit embrasser par la pensée tous ses effets possibles.
Donner du sens à l’action, c’est faire intervenir une volonté. L’homme politique est un homme d’action. L’homme d’État, c’est celui qui recherche l’effet déterminé par cette grande « Cause publique » qui fait la République (Res publica), élevée au rang de Valeur suprême au service de l’intérêt général. C’est là tout l’enjeu de travaux de recherche universitaire qui pourraient être menés par des praticiens disposant d’une longue expérience de l’exploitation de l’information ou du renseignement. C’est cet enjeu si essentiel dans notre monde en pleine recomposition géopolitique, qui a motivé mes dernières publications[21] sur « le nombre et l’unité dans l’ordre républicain » [22] et sur leurs implications pour la « société de l’information » émergente[23]. Afin de légitimer une approche des systèmes d’information empruntant plus aux sciences humaines qu’aux sciences de l’ingénieur, j’y souligne l’importance des principes d’une méthode opérationnelle de recherche et de partage de l’information décrite dans ma thèse[24]. Son instrument principal n’est pas le support numérique gestionnaire de données massives, ni l’intelligence artificielle pourvoyeuse d’informations nouvelles, mais le document électronique recueil de connaissances et de savoirs humains. L’exploitation de l’information y est envisagée comme un sport d’équipe, dans un système de classification à six facettes fondé sur une grammaire impliquant le lieu et le temps, à l’image des cinq sens complétés par l’intuition qui fédère l’ensemble.
L’enjeu est d’améliorer la pratique du système par une communauté organisée autour d’une fonction commune qui donne sens à son jeu collectif. À l’heure des technologies numériques et du web sémantique, j’ai donc fait le choix délibéré de faire appel à une théorie de l’information, ancrée dans les humanités de la pensée, de la langue et de la grammaire qui l’organise, plutôt que dans l’ingénierie du calcul et des algorithmes qui le programment. Je souhaite affirmer ainsi la nécessité d’une distinction claire entre logique et algorithmique, entre sciences humaines et sciences de l’ingénieur, entre l’humain et l’automate ou entre théorie de l’information et théorie de la communication. Une telle démarcation n’est possible qu’à condition de se donner les moyens d’une interdisciplinarité forte, dont on peut noter au passage, que les méthodes de partage dynamique de l’information documentaire proposées, peuvent être l’instrument. Dans ce contexte de « révolution culturelle et cognitive » décrit par Michel Serres[25], dont l’électronique et le numérique ne sont que des marqueurs technologiques à effet sur l’ensemble du spectre scientifique, il semble indispensable que les sciences humaines investissent sans réserve l’hypermédiatisation de l’information qui en résulte, afin de permettre la conception de systèmes d’information adaptés à la pratique scientifique d’une intelligence collective à usage politique.
La sagesse scientifique d’une telle conscience collective qui serait éminemment politique et dont j’essaye de cerner les grands principes en précisant les concepts associés[26], s’avère en effet, crise après crise, toujours plus utile. Elle devrait permettre en particulier d’éviter cette dérive démagogique qui corrompt la république en négligeant l’unité au profit du nombre ou en confondant la dimension éthique de la politique avec une sorte de morale politique plus démagogique que véritablement éthique. Une telle conscience politique permettrait en outre de parer les déviances totalitaires tyrannique ou oligarchique attachées aux modèles monarchique ou aristocratiques, en évitant la politisation de l’espace privé caractéristique de toutes les dérives totalitaires, que cette confusion entre éthique et morale ne manquerait pas d’engendrer en laissant à la politique le soin de distinguer le bien du mal.
Redonner toute sa place à l’individu dans la relation qu’il entretient avec le collectif, à l’unité dans sa relation avec le nombre, ou à la pensée analogique dans sa relation avec le calcul numérique, permettrait en particulier d’éviter le recours systématique en politique à « un principe de précaution par essence ascientifique car infalsifiable ou irréfutable ». Poussé aux limites d’une logique absurde consistant « à maximiser les calculs de risque afin de justifier une intervention massive qui, après coup, en réduira l’impact », ce dévoiement politique d’une science limitée aux chiffres décorrélés de toute unité raisonnable conduit inévitablement à « en faire trop pour annuler la possibilité même de penser qu’on peut faire autrement »[27].
Repenser cet « ensemble réfléchi et hiérarchisé de nos désirs collectifs, fait de connaissances et de choix » caractérisant l’éthique ou la politique, en l’associant « à une conscience aigüe de l’impérieuse nécessité de compter avec l’autre, dans le souci de l’intérêt général », permettrait également de donner du sens à l’action politique en lui assignant une éthique responsable soucieuse de l’intérêt général, sans avoir nécessairement recours à la séduction démagogique des masses. Poussé aux extrêmes d’une conduite déraisonnable consistant à opposer le camp du bien au camp du mal, ce dévoiement de la morale au profit d’une politique confisquée au service d’un seul ou de quelques-uns conduit inévitablement à insuffler la peur d’un ennemi phantasmé pour mieux contrôler la masse.
Ce type de dérive est parfaitement illustré par ce propos tenu par Hermann Goëring dans sa cellule au soir du 18 avril 1946 : « qu’il ait voix au chapitre ou non, le peuple peut toujours être mis aux ordres des dirigeants ». Cette remarque aussi réaliste que glaçante, quand on sait les horreurs commises par le régime nazi, image ainsi parfaitement la déviance tyrannique ou oligarchique de la démocratie. « C’est facile », ajoutait le criminel de guerre en développant son idée : « Tout ce que vous avez à faire est de lui dire qu’il est attaqué, et dénoncer les pacifistes pour leur manque de patriotisme qui met le pays en danger », exprimant ainsi ce recours à l’opposition du camp du bien contre le camp du mal pour mettre en œuvre une politique de la peur destinée à s’assurer la docilité du peuple, « ça marche de la même manière dans tous les pays »[28].
Toute ressemblance avec des faits plus récents et des personnes encore aux affaires serait bien évidemment purement fortuite, à moins qu’en y réfléchissant bien on réalise qu’elle ne pourrait pas être que le fruit d’une pure coïncidence, mais plutôt celui d’une corruption majeure de nos régimes politiques, telle que Aristote en observait le risque en son temps. De telles déviances tyranniques ou oligarchiques, comme démagogiques, donnent toute la mesure de l’enjeu de la démocratie en république à l’heure de cette révolution cognitive générée par les nouvelles technologies de l’information et de la communication. L’exemple du traitement de la crise sanitaire en 2020 est à ce titre révélateur. Les autorités de santé sur lesquelles la classe politique s’est défaussée de responsabilités semblant la dépasser, ne disposaient que de données numériques dénuées du sens que seule une intelligence collective délivrant une pensée analogique fondée sur une connaissance rigoureusement documentée aurait pu apporter à la Politique.
Nous avons été soumis à de « hautes autorités » devenues folles de technologie et de science mal maitrisée réduite aux algorithmes et aux études statistiques, là où nous aurions dû nous comporter comme des hommes libres n’ayant d’autre maître que la Raison élevée au rang de transcendance régnant sur l’intérêt général. Alors que jadis on acceptait de sacrifier des vies pour sauver nos libertés ou la souveraineté du pays, aujourd’hui, on accepte de sacrifier nos libertés et la vie du pays en sabordant son économie pour sauver des vies. Avec l’avènement d’une véritable « société de l’information » [29], seule la Raison érigée en grande Cause publique, comme une sorte de transcendance visant l’intérêt général, permettrait de redonner tout son sens à une action politique susceptible de réhabiliter une démocratie plus vertueuse en république.
---
[1] Politique, Livre III.
[2] Du grec monarkhia composé de mónos, « seul » et de arkhós, « dirigeant, chef, souverain » (parfois traduit par « celui qui gouverne »), « celui qui commande », qui détient l’autorité, dérivé de arkhein, « commander ».
[3] Du grec aristokrateia, « gouvernement des meilleurs », composé de aristos, « le meilleur », et de kratos, « pouvoir, puissance», dérivé de kratein, « exercer le pouvoir », « maîtriser ».
[4] Du latin res publica qui signifie « chose publique » et désigne souvent l’intérêt général, le gouvernement, la politique ou enfin la Cité ou l’État (en grec politeía, cf. Cicéron dans De la République).
[5] Du grec dêmokratia, composé de dêmos, « peuple », et kratos, « pouvoir, puissance ».
[6] Du grec dêmagôgos, composé de dêmos, « peuple », et agôgos, « qui guide, qui attire », soit lorsqu’il est un chef politique, « celui qui conduit, qui attire ou qui séduit le peuple ».
[7] Voir à ce sujet (Alain Joxe, Démocratie et globalisation, Revue du MAUSS, 2005/1 n°25, pp. 43-54) : « Après la guerre de Sécession, la définition de la démocratie américaine se distingue enfin de la démocratie grecque : elle conserve la structure aristocratique du sénat, et l’éloge de la démocratie américaine ressemble étrangement à celui que Polybe faisait de la Constitution romaine, comme collage d’une démocratie (l’assemblée des comices), d’une aristocratie (le sénat) et d’une royauté (les consuls puis l’empereur, président et commandant en chef) ».
[8] Si on s’interroge sur le périmètre qu’il faut donner à la notion d’intérêt général, en dépassant le cadre désormais trop étriqué de l’État-nation, qui reste malgré tout le seul encore adapté à l’exercice de l’autorité et de la souveraineté, malgré une globalisation du monde aussi inexorable qu’impétueuse, on peut utilement méditer cette pensée de Montesquieu : « Si je savais quelque chose qui me fût utile et qui fût préjudiciable à ma famille, je la rejetterais de mon esprit. Si je savais quelque chose d'utile à ma famille et qui ne le fût pas à ma patrie, je chercherais à l'oublier. Si je savais quelque chose utile à ma patrie et qui fût préjudiciable à l'Europe, ou bien qui fût utile à l'Europe et préjudiciable au genre humain, je la regarderais comme un crime » (Pensées, n° 741).
[9] Pour continuer à s’appuyer sur des racines grecques, on pourrait tenter ici le néologisme « aristagogie » combinaison de aristos et de agôgos (la conduite aux meilleurs), à l’image de la notion de démagogie, combinaison de dêmos et de agôgos (la conduite au peuple), qui est assimilée à la démocratie, combinaison de dêmos et de kratos (le pouvoir au peuple), envisagée par Aristote comme une déviance du régime républicain.
[10] "Ne pas subir" : la confusion entre sujet individuel et objet collectif, l’exemple de la crise sanitaire, tribune K2, 21/03/2022.
[11] Cf. André Comte-Sponville, Dictionnaire philosophique, PUF, 2001, entrée « Éthique ».
[12] La relation entre collectif et individu dans une société de l’information en gestation, tribune K2, 22/09/2021.
[13] Le nombre et l'unité, dans l'ordre républicain, tribune K2, 06/04/2021.
[14] Cybernétique : du grec kubernêtikê, « art de gouverner », technique de fonctionnement des systèmes fondée sur le principe de rétroaction de l’effet sur la cause pour obtenir un résultat constamment adapté au but désiré.
[15] Le nombre et l'unité, dans l'ordre républicain, tribune K2, 06/04/2021.
[16] Le renseignement au prisme des sciences de l'information, Thèse de doctorat, UPHF-DeVisu, 2019.
[17] Noam Chomsky, Le Langage et la pensée, Petite bibliothèque Payot, 1967, 2006.
[18] Faire « un usage infini de moyens finis » (Noam Chomsky, ibid.).
[19] Cf. Le renseignement au prisme des sciences de l'information, ibid., pp. 273 et suivantes (§ 3. Le concept de grille conceptuelle).
[20] Michel Volle, Le rapport entre la pensée et ses objets, volle.com, 09/12/2017.
[21] L’ensemble de mes réflexions sur ce sujet a été synthétisée dans un petit « glossaire insolite de l’infocom » accessible à partir de mon blog francis-beau.blogspot.com, onglet « Terminologie », rubrique « glossaire », Information scientifique et intelligence collective, Unblog.fr, 01/08/2023.
[22] Le nombre et l'unité, dans l'ordre républicain, op. cit..
[23] La relation entre collectif et individu dans une société de l’information en gestation, op. cit..
[24] Le renseignement au prisme des sciences de l'information, ibid..
[25] Michel Serres. Les nouvelles technologies : révolution culturelle et cognitive. Interstices, 2007.
[26] Information scientifique et intelligence collective, ibid..
[27] De l’Intelligence Artificielle à l’Humanité Artificielle : la gouvernance du calcul plutôt que le gouvernement de la raison, Tribune K2, 05/12/2020.
[28] Hermann Goëring, propos recueilli par Gustave Mark Gilbert Gilbert (Nuremberg Diary, Da Capo Press, 22/08/1995). Ce psychologue américain recueillant des témoignages de dirigeants nazis en marge du procès de Nuremberg décrit ainsi la discussion qu'il a eu avec lui : (Goëring) « Naturally, the common people don't want war; neither in Russia nor in England nor in America, nor for that matter in Germany. That is understood. But, after all, it is the leaders of the country who determine the policy and it is always a simple matter to drag the people along, whether it is a democracy or a fascist dictatorship or a Parliament or a Communist dictatorship ». (Gilbert) « There is one difference(...) In a democracy the people have some say in the matter through their elected representatives, and in the United States only Congress can declare war ». (Goëring) « Oh, that is all well and good, but, voice or no voice, the people can always be brought to the bidding of the leaders. That is easy. All you have to do is tell them they are being attacked and denounce the pacifists for lack of patriotism and exposing the country to danger. It works the same way in any country ».
[29] Cf. Information scientifique et intelligence collective, op. cit., p. 21, entrée « de la SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION ».
16/09/2023