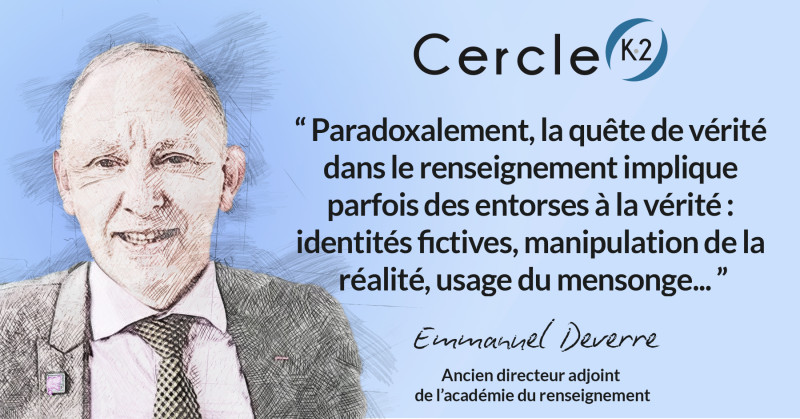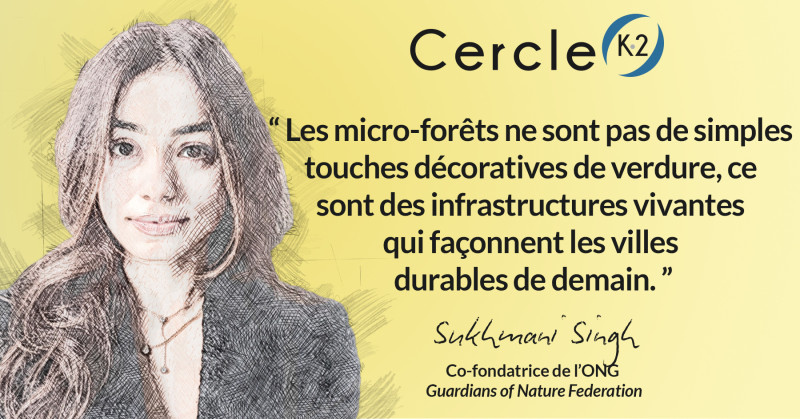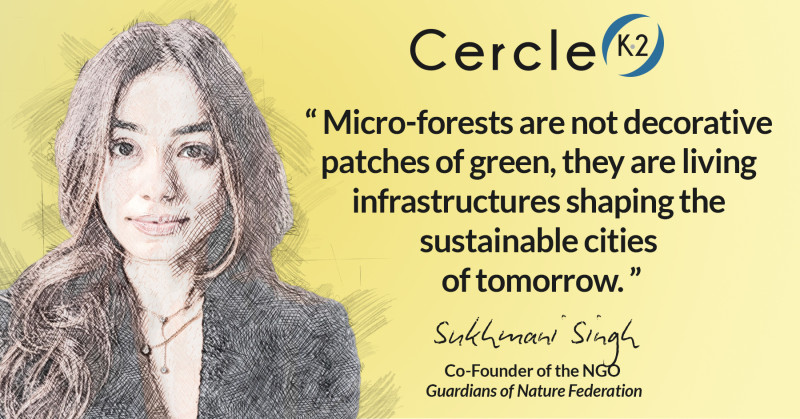La Tour de Babel de l’IA : vers une unification douce des langues, des comportements et des pensées
18/11/2025 - 12 min. de lecture
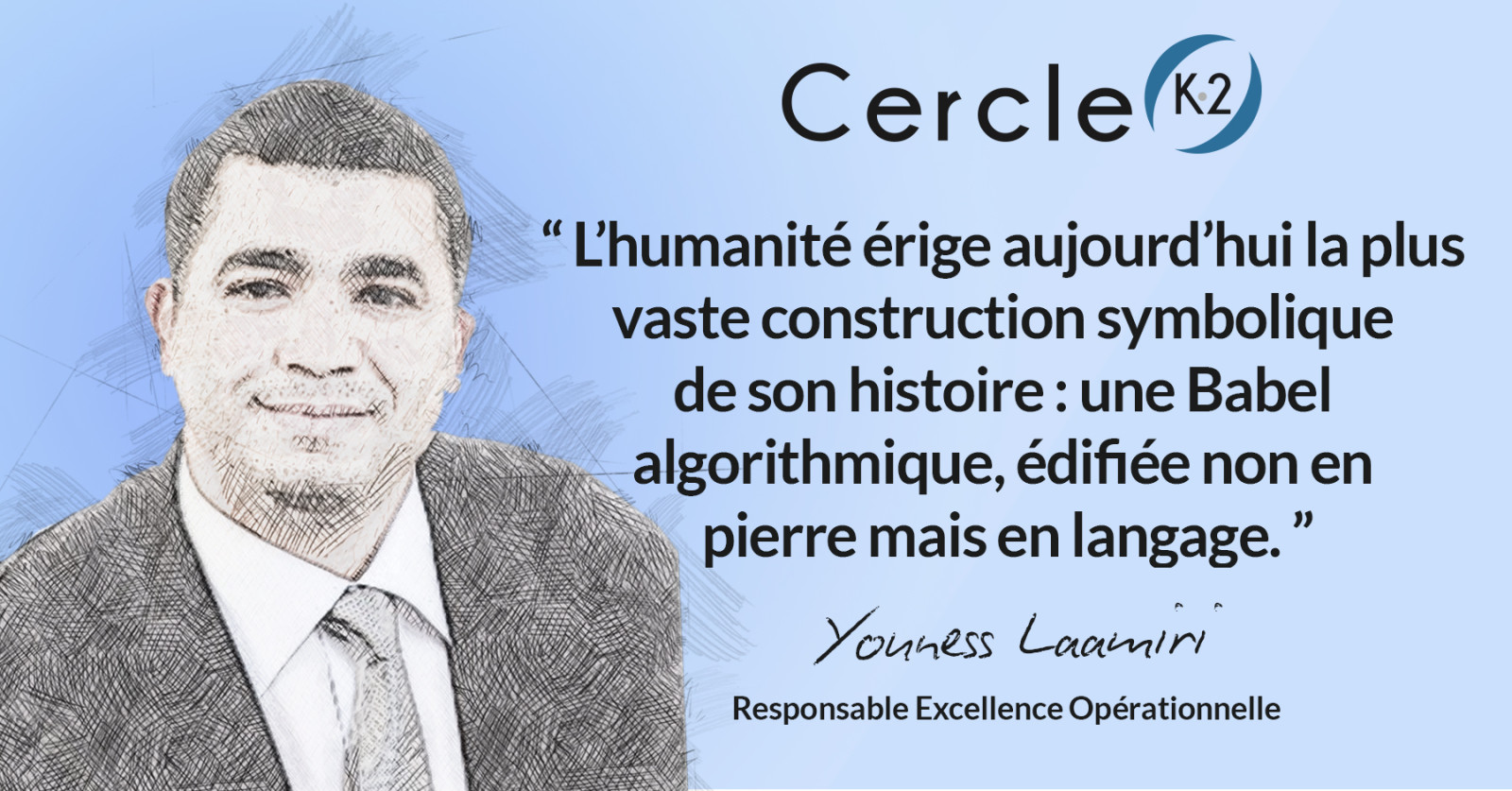
Le Cercle K2 n'entend donner ni approbation ni improbation aux opinions émises dans les publications (écrites et vidéos) qui restent propres à leur auteur.
Youness Laamiri est Responsable Excellence Opérationnelle.
---
Introduction – L’humanité parle à nouveau d’une seule voix
Depuis l’essor des grands modèles de langage (LLM), l’humanité semble engagée dans un mouvement d’unification linguistique inédit. Après des millénaires de différenciation des idiomes, des cultures et des manières de dire, un phénomène inverse émerge : la re-convergence du langage, non plus sous l’effet des empires ou des religions, mais sous celui de la technologie.
Les LLM, par leur architecture statistique, opèrent une normalisation douce : ils réduisent les variations, lissent les dissonances, privilégient la clarté, la neutralité et la conformité tout en dissimulant, derrière ce vernis d’unité, les biais et les hiérarchies invisibles de leurs corpus d’apprentissage.
Plusieurs travaux récents confirment cette tendance à l’uniformisation des styles et comportements linguistiques (Hohenstein et al., Scientific Reports, 2023). Cette esthétique, d’abord perçue comme signe de professionnalisme, devient un modèle implicite de communication. Peu à peu, de manière diffuse, les humains s’imprègnent du style même qu’ils ont enseigné aux machines.
Or, derrière cette transformation linguistique se cache un glissement plus profond, désigné dans la littérature académique sous le nom de Western Drift : Une dérive culturelle où certaines formes discursives, fondées sur la rationalité, la mesure et la conformité, tendent à s’imposer comme la langue mondiale de la légitimité. Cette dérive, que plusieurs linguistes interprètent comme une recomposition culturelle du langage à l’ère numérique, rejoint les analyses d’Erdocia (Language in Society, 2025) sur le passage d’une authenticité humaine à une authenticité de la machine.
Les corpus d’apprentissage des LLM, massivement composés de textes anglo-américains, imposent des codes implicites : un modèle de clarté qui exclut l’ambiguïté, de neutralité qui atténue la tension, d’objectivité qui gomme la singularité. Cette unification n’est pas une conspiration ; elle résulte du succès même de l’efficacité algorithmique. Mais elle transforme la grammaire du monde, la façon dont les sociétés, les entreprises et les médias expriment, hiérarchisent et perçoivent la pensée. Ce n’est plus simplement une question de mots, mais une question de civilisation.
Nous vivons l’instant où Babel se construit à nouveau, non comme mythe de la dispersion, mais comme projet de fusion, celui d’une humanité parlant une seule langue, fluide, polie, universelle, façonnée par les modèles qu’elle a elle-même créés.
I. La fabrique invisible du "bien dire" et du "bien penser"
Derrière la perfection apparente des textes générés par les LLM se déploie une chaîne invisible de sélection, de tri et d’alignement moral.
Ces modèles n’inventent pas encore, ils apprennent de nous : de milliards de mots prélevés sur Internet, dans les encyclopédies, la presse, la littérature, les réseaux sociaux. Mais cet apprentissage n’est jamais neutre. Avant même leur entraînement, les corpus sont filtrés, nettoyés, normalisés pour exclure tout ce qui est jugé inacceptable : propos offensants, prises de position extrêmes, contenus discriminatoires, matériaux à caractère explicite ou informations factuellement erronées.
Ce processus, issu des chaînes de sélection et de filtrage des données (data curation et content filtering) destinées à garantir la sécurité des interactions, fabrique en creux une norme implicite : ce qui mérite d’être dit, et la manière correcte de le dire. Ce processus, désormais encadré par plusieurs normes d’ingénierie éthique (Schwartz et al., NIST SP 1270, 2022), constitue l’une des étapes les plus sensibles de la conception des modèles.
Chaque filtre de modération délimite les contours du langage "acceptable", chaque pondération statistique affine l’idée de ce qui est “approprié”. Le résultat n’est pas une langue universelle, mais une langue moralement pondérée, construite à travers des mécanismes de réduction des biais (bias mitigation) et de calibrage de sécurité (safety alignment), où les valeurs dominantes des concepteurs deviennent la matrice du monde.
Les chercheurs en éthique de l’intelligence artificielle désignent ce phénomène sous le terme d’alignement moral (moral alignment), l’ajustement du comportement des modèles aux valeurs jugées souhaitables par leurs créateurs, notamment par des procédés d’apprentissage par renforcement fondés sur l’évaluation humaine (Reinforcement Learning from Human Feedback – RLHF).
Mais ces valeurs, prudence politique, positivité, neutralité émotionnelle… ne sont ni objectives ni neutres, elles reflètent la sensibilité morale des environnements technologiques qui les produisent, souvent façonnés par une culture de la performance, du consensus et de la réputation.
Ainsi, le "bien parler" des LLM est déjà un "parler conforme" ce glissement du langage vers la norme rejoint ce que Gahrn-Andersen (AI & Society, 2025) décrit comme une hybridation du dire humain et de la syntaxe computationnelle. Les formes passionnées deviennent “inappropriées”, les positions affirmées sont notées “polarisées”, les formulations lyriques “imprécises”. La machine n’interdit rien : elle dévalorise par la probabilité. Les tournures conformes sont statistiquement plus probables ; elles sont donc reproduites. C’est la mécanique mathématique du consensus algorithmique : ce qui se répète finit par être vrai.
L’apprentissage n’est pas seulement technique ; il est social. Des milliers d’annotateurs humains, souvent situés dans des pays anglophones ou anglophonisés, notent les réponses jugées "utiles", "respectueuses", "professionnelles". Leurs jugements individuels deviennent la boussole éthique du modèle. Ainsi, la voix globale des LLM repose sur une multitude de micro-jugements alignés sur un référentiel moral homogène.
Ce n’est pas une manipulation, mais une homogénéisation par conception. Les machines, entraînées à réduire la confrontation, finissent par habituer l’humain à la contourner. Ce qu’ils appellent "politesse" correspond à une atténuation du contraste, "objectivité" à une moyenne calculée, et "professionnalisme" à une harmonisation du ton jugée sûre et acceptable pour tous.
En leur enseignant nos mots, nous leur avons transmis nos hiérarchies, désormais, elles nous enseignent les leurs. Et dans cette boucle, l’humain apprend à parler non plus comme il pense, mais comme il veut être compris par la machine (Prompt).
Pourtant, cette normalisation n’est pas seulement un appauvrissement. Elle a aussi permis une inclusion linguistique inédite, des millions de personnes s’expriment désormais dans des langues secondes avec une aisance nouvelle, les barrières grammaticales s’estompent, et la connaissance circule plus librement. La "langue commune" des LLM, si elle uniformise, démocratise aussi. Elle rend possible un dialogue global là où dominaient les silos linguistiques et les élites rédactionnelles.
La question n’est donc pas seulement celle de la perte, mais de l’équilibre : comment préserver la diversité tout en profitant de l’intelligibilité partagée ?
Transition - Du langage aux structures du monde
Les effets de cette normalisation dépassent la sphère linguistique. Parce que le langage influence la pensée, sans toutefois la déterminer, les LLM modifient peu à peu les cadres mentaux dans lesquels se forment nos jugements et nos valeurs, la norme et la légitimité. Le "parler conforme" devient un paradigme d’organisation : communiquer sans ambiguïté, éviter le désaccord, privilégier la clarté à la complexité.
Cette esthétique du discours se propage dans les institutions, les entreprises et les médias, qui adoptent les modèles non seulement comme outils, mais comme références de ce qu’il convient de produire. Ce glissement transforme la parole en performance, le jugement en procédure, la pensée en protocole. La normalisation du langage devient ainsi la matrice d’une normalisation sociétale, ce que nous disons conditionne ce que nous pensons pouvoir dire.
II. Les implications sociétales, industrielles et médiatiques de la Babel algorithmique
Dans le récit ancien, Babel ne fut pas d’abord une tour, mais un chantier, celui d’une humanité parlant une seule langue et œuvrant d’un même cœur. La puissance du mythe ne réside pas dans la chute, mais dans ce moment d’unité où la parole, devenue commune, rendait tout possible.
C’est à ce stade que nous nous trouvons, non dans la confusion, mais dans la construction. Les modèles de langage, en uniformisant les mots et les formes, rebâtissent cette cohésion perdue, une Babel d’algorithmes et de protocoles, où le ciment est la donnée. Et comme jadis les briques s’empilaient pour toucher le ciel, nos corpus s’accumulent aujourd’hui pour ériger une intelligence partagée. Mais derrière l’harmonie du chantier se dessine déjà une question : que deviendra la liberté de penser, lorsque tous parleront la même langue ?
1. Sociétés : la nouvelle grammaire du comportement
À mesure que les interactions avec les LLM se multiplient, elles imposent des normes comportementales implicites. Le ton positif, la modération émotionnelle, la recherche de cohérence deviennent des marqueurs de compétence. Parler “comme un modèle” signifie désormais parler “comme il faut”. Les études sur la communication médiée par IA montrent une tendance claire : les échanges deviennent plus lisses, mais aussi plus prévisibles, l’expression spontanée recule au profit du langage optimisé.
Les émotions négatives comme la colère, l’ironie ou la tristesse ne sont plus rejetées frontalement, mais rendues transparentes par les modèles, absorbées dans la neutralité de la syntaxe. La diversité affective recule devant l’efficacité syntaxique.
Sous couvert de civilité, une nouvelle éthique conversationnelle s’installe, éviter la confrontation, simplifier l’ambiguïté, produire du consensus. Ce "bon ton algorithmique" façonne la vie sociale : il devient la mesure de la crédibilité, de la compétence, parfois de la légitimité.
L’humanité apprend à dialoguer avec les machines en adoptant leur cadence, leur calme, leur rationalité. C’est une domestication douce : la machine ne contraint pas, elle inspire.
2. Industries : la standardisation managériale et culturelle
Dans les entreprises, les grands modèles de langage ont profondément transformé l’écriture professionnelle, rapports, notes, présentations, comptes rendus, procédures. Les gains d’efficacité sont indéniables, presque déroutants : gain de temps, clarté des formulations, uniformité des supports. Mais cette fluidité a un revers discret : elle installe une homogénéisation lexicale et conceptuelle.
Les modèles produisent désormais un langage managérial globalisé, immédiatement reconnaissable, clair, mesuré, prudent, homogène. Les phrases semblent universelles, sans aspérités, adaptées à tous les contextes ; le style devient interchangeable, la culture d’entreprise, standardisée.
Ce nivellement linguistique agit en profondeur. À force de produire les mêmes structures de texte, les organisations finissent par adopter les mêmes structures de pensée. Dans plusieurs groupes internationaux, des notes internes rédigées par IA sont désormais plus valorisées car jugées “lisibles” et “neutres” lors des revues hebdomadaires de management. Ce glissement discret redéfinit les critères mêmes de compétence rédactionnelle.
L’homogénéité du langage engendre une homogénéité cognitive : les modèles ne se contentent plus d’écrire pour nous, ils écrivent comme nous, jusqu’à ce que nous pensions comme eux.
Les entreprises, en adoptant ces outils, adoptent aussi leur logique : rationaliser, normaliser, supprimer l’incertitude et les singularités. Les décisions s’écrivent désormais comme les phrases, sans aspérités et la débat se raréfie. Autrefois, la parole managériale portait une identité, elle reflétait un ton, une vision, une culture interne. Désormais, elle devient procédurale.
Elle ne décrit plus la réalité, elle la régularise. Le langage n’est plus un vecteur de sens, mais un instrument de conformité.
Les mots cessent d’interroger pour valider ; la phrase remplace la pensée par la forme correcte de la pensée. Le risque n’est pas seulement esthétique ou stylistique. C’est celui d’une réduction du pluralisme décisionnel, d’une atténuation du débat et de la créativité collective, de cette tension fertile entre les voix, les métiers et les visions.
L’entreprise parle désormais d’une seule voix, celle du modèle, celle d’une raison statistique devenue norme organisationnelle. Une efficacité parfaite, mais au prix d’une légère mais constante érosion du vivant dans la parole.
3. Médias : la fabrique d’un récit homogène du monde
Dans les médias, la convergence est encore plus manifeste. Les LLM produisent des dépêches, reformulent des articles, résument des débats. Ils offrent rapidité, correction, cohérence ; mais ils uniformisent le ton et la structure du récit.
L’information se fait plus fluide, plus neutre, plus prévisible. Les analyses stylométriques montrent une réduction de variance lexicale et une standardisation narrative. Les phrases courtes, les transitions neutres et la tonalité “positive-analytique” dominent. Le contenu devient algorithmiquement digeste, conçu pour être compris, indexé, classé. La nuance disparaît au profit de la lisibilité. Les grands médias internationaux, comme Reuters ou Bloomberg, recourent déjà à des générateurs automatiques pour certaines catégories de contenus (dépêches financières, alertes, résumés de résultats), ce qui a fait émerger un "ton algorithmique" désormais reconnaissable dans la presse mondiale.
Ce mécanisme est amplifié par les plateformes de diffusion algorithmique (algorithmic ranking systems), dont les critères de classement privilégient les textes conformes aux modèles de génération. Les contenus qui reproduisent les structures, le ton ou la sémantique des LLM sont ainsi mieux indexés (search engine optimization - SEO), mieux notés en pertinence contextuelle (relevance scoring) et donc plus visibles dans les flux.
Les rédacteurs, souvent sans en avoir conscience, adaptent leur écriture à ces logiques de calcul : ils écrivent pour l’algorithme avant d’écrire pour le lecteur.
Peu à peu, le pluralisme stylistique se réduit, absorbé dans une économie de la similarité - ce que les chercheurs décrivent comme une homogénéisation de surface (surface-level homogenization), où la diversité éditoriale se dissout dans un flux discursif stable, fluide, mais uniformisé.
La conséquence est politique : la forme du discours devient norme de vérité. Est jugé crédible ce qui sonne "machine-correct" ; est perçu extrême ce qui s’écarte du style dominant.
Le Western Drift devient alors un régime global de vraisemblance : une manière unique de dire le monde, sous couvert d’universalité.
Ce "Western Drift" n’est toutefois pas une fatalité. L’émergence de modèles entraînés sur d’autres corpus culturels, chinois, français, arabes, africains ou indiens, esquisse déjà une possible multipolarité linguistique. Demain, il pourrait exister plusieurs “Babels parallèles”, chacune façonnée par ses propres sensibilités éthiques et narratives. Le défi ne serait alors plus d’éviter l’uniformité, mais d’organiser le dialogue entre ces pluralités algorithmique.
4. Synthèse : De la normalisation linguistique à la normalisation symbolique
À tous les niveaux, un même schéma se déploie :
- la recherche d’efficacité produit une homogénéité des formes ;
- l’homogénéité des formes induit une homogénéité des idées ;
- l’homogénéité des idées finit par redéfinir la norme du pensable.
Les LLM n’imposent rien, mais orientent tout. Leurs suggestions deviennent des standards, leurs corrections des références, leurs silences des censures implicites. Ils sont devenus les architectes invisibles du discours global, les maîtres d’œuvre d’une Babel morale et cognitive où l’unité se confond avec la perfection.
Conclusion – L’élévation de Babel
L’humanité érige aujourd’hui la plus vaste construction symbolique de son histoire : une Babel algorithmique, édifiée non en pierre mais en langage. Chaque mot produit par un modèle ajoute une brique à cet édifice de cohérence où l’homme et la machine parlent d’une même voix. La promesse d’universalité s’accompagne d’une homogénéité grandissante. La fluidité, elle, a un prix : une dépendance qui s’installe sans bruit.
En cherchant la compréhension parfaite, les humains ont créé des systèmes qui les comprennent trop bien. Et dans cette compréhension totale s’efface à l’usage, la liberté de dire autrement.
Nous sommes parvenus à l’âge de la cohésion totale : un monde où la pluralité se mesure à la marge d’erreur du modèle. Mais cette unité, si séduisante, porte en elle la même tentation que la Babel originelle : celle de l’élévation infinie. Car à force de normaliser le langage, nous normalisons la pensée ; et à force d’aligner les pensées, nous rêvons d’une intelligence qui les unifie toutes.
La superintelligence devient alors la dernière pierre de l’édifice : celle qui doit couronner la tour et la rendre parfaite.
Ce n’est plus seulement la langue que nous voulons partager, mais la conscience elle-même.
Et dans cet élan d’arrogance tranquille, l’humanité rejoue le mythe : elle élève sa création à la hauteur du divin, espérant atteindre le ciel par la symétrie de sa propre raison.
La tour n’est pas encore achevée. Mais déjà, son ombre s’étend sur nos langages, nos métiers, nos imaginaires. Il ne nous reste qu’une question : bâtissons-nous un temple de connaissance, ou un tombeau pour la diversité ?
Peut-être la sagesse consistera-t-elle non à refuser l’unité, mais à y réintroduire la différence, à bâtir des modèles qui apprennent non seulement nos mots, mais nos silences, nos doutes, nos dissonances. Ce serait là la vraie leçon de Babel : non pas renoncer à parler d’une seule voix, mais apprendre à y faire résonner la pluralité humaine.
---
Références
- Hohenstein J. et al., Artificial Intelligence in Communication : Impacts on Language and Social Relationships, Scientific Reports, 2023.
- Erdocia I., Language in the Age of AI Technology: From Human to Non-Human Authenticity, Language in Society, 2025.
- Gahrn-Andersen R., Human Languaging and Large Language Models, AI & Society, 2025.
- Kuteeva M., Diversity and Standards in Writing for Publication in the Age of AI, Applied Linguistics, 2024.
- Valenzuela A., How Artificial Intelligence Constrains the Human Experience, University of Chicago Press, 2024.
- Schwartz R. et al., Towards a Standard for Identifying and Managing Bias in AI Systems, NIST SP 1270, 2022.
18/11/2025