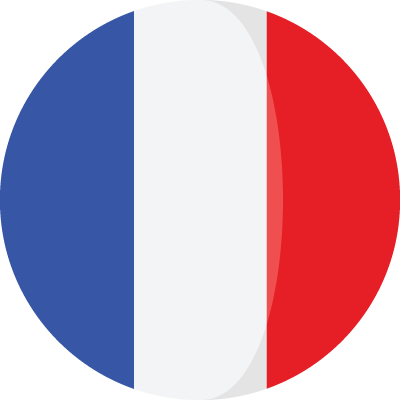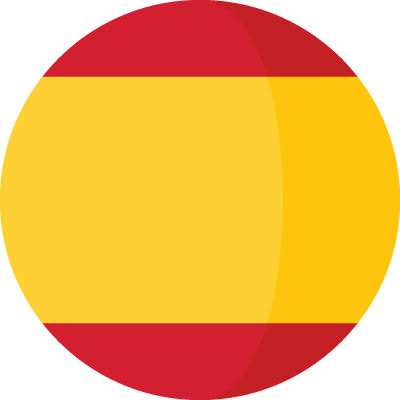Le Cercle K2 n'entend donner ni approbation ni improbation aux opinions émises dans les publications (écrites et vidéos) qui restent propres à leur auteur.
Emmanuel Legeard est Docteur ès Lettres et Sciences humaines de Paris IV Sorbonne, Historien des idées et Enseignant.
---
Quand le général Jean-Pierre Meyer m’a aimablement proposé de donner au K2 une tribune, j’étais précisément en train de mûrir pour moi-même une réflexion inspirée par la conférence du 16 septembre 2022 à Paris où l’on m’avait convié à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine parce que mon livre sur Germigny venait à peine de sortir. A la fin de cette conférence, le dialogue avec le public étendu aux questions générales m’a permis de constater une chose préoccupante : on ne sait plus ce qu’est un monument historique. Quelle est la signification d’un monument historique, quel est son statut, en quoi monument historique et patrimoine recouvrent-ils des idées différentes, voici tout ce qu’il fallait éclairer, et bizarrement même face à deux fonctionnaires, fort sympathiques d’ailleurs, du ministère de la Culture. La grande question qui suscite l’inquiétude et qui devrait occuper tous les esprits, c’est comment attendre du public qu’il comprenne et défende son propre patrimoine si le concept même lui est devenu inintelligible ? Surtout : le patrimoine est-il condamné quand il est écarté des métropoles qui focalisent toute l’attention ? Ce grave problème, qui donne du souci à quelques-uns d’entre nous, méritait justement d’être abordé. Nous nous limiterons ici au cas des églises classées.
LA LOI DE 1913 ET LES DEUX CHARTES DE 1931 ET 1964.
Il est assurément passionnant d’épiloguer avec Françoise Choay ou Régis Debray [1] sur la différence entre monument intentionnel et monument historique, ou sur la classification en « monu-formes » et en « monu-traces », mais entrons directement dans le vif, et pour commencer, inscrivons-nous clairement et résolument en faux contre la tradition scolastique française qui veut malgré toute évidence qu’il y ait eu une évolution homogène entre la notion de monument historique invoquée par des révolutionnaires « éclairés » en réaction au vandalisme terroriste, celle développée par Guizot sous Louis-Philippe et celle issue d’une toute autre tradition qui passe par Chateaubriand, Victor Hugo et Maurice Barrès pour aboutir à la loi de 1913 fixant définitivement le concept pour nous. Si, par la conservation des monuments prestigieux, la révolution française cherchait à créer un socle anthropologique commun permettant l’émergence d’une conscience nationale dont le centre de gravité se voyait transféré du passé dans le futur, c’était parce que la fierté populaire devait alimenter le « progrès ». Procédant d’un tout autre esprit, la société ouverte de Guizot, protestant cévenol, proclamait déjà comme allant de pair la fin de l’histoire et le triomphe du capitalisme souverain, et si Guizot envisageait de classer églises et châteaux, c’était surtout pour mieux marquer le dépassement définitif du catholicisme et de l’aristocratie afin d’investir d’autorité la nouvelle aristocratie d’argent. Or la notion de monument historique défendue par Maurice Barrès, au contraire, se rattachait à celle de Victor Hugo et à sa défense de Notre-Dame de Paris. Opposé à la « stupide » idéologie du progrès universel, ouvertement attaché aux « patries charnelles » et à la continuité pagano-chrétienne d’un mysticisme enraciné, Barrès n’était pas lui-même croyant : «Je défends les églises au nom de la vie intérieure de chacun», écrivait-il dans la Grande Pitié des églises de France. Mais c’est André du Fresnois qui résume le mieux son combat : « Il ne s’agit pas de faire des croyants, mais de persuader à des incroyants qu’il leur faut défendre les temples de la foi traditionnelle ou renoncer à servir la cause de la civilisation. » Le monument historique selon Barrès témoigne donc d’une continuité et non d’une rupture.
Cependant, pour comprendre l’enjeu, il convient d’en rappeler le contexte. Entre 1905 et 1907, les lois de séparation de l’Église et de l’État avaient privé les églises d’allocations, et celles-ci étaient désormais à la charge de municipalités souvent indifférentes voire franchement malveillantes vis-à-vis du culte catholique. La seule façon de prévenir la dégradation passive ou active des églises anciennes dans les contrées les plus reculés du pays était de leur assurer la protection officielle de l’État et un entretien subventionné au titre des monuments historiques. Barrès usa de son influence intellectuelle et de sa position politique pour qu’on classe toutes les églises antérieures à 1800, même « les laides, les dédaignées, qui ne rapportent rien aux chemins de fer, qui ne font pas vivre les aubergistes ». Or celles qui donnaient le plus d’inquiétude étaient, comme le rappelle Michel Prieur, les églises des communes rurales en voie de dépopulation. Ainsi, c’est parce qu’elle répondait parfaitement à cette définition, et nullement pour sa beauté ou son intérêt historique, que Notre-Dame de Germigny-l’Exempt fut classée d’urgence : médiévale, le culte y était toujours célébré et pratiqué, et elle se trouvait menacée par un conseil municipal composé, suivant l’expression apparemment tout à fait fondée du curé de l’époque, Félix Millet, de « désolants crétins ». Il va de soi, en effet, qu’en 1912, la commission des monuments historiques ne pouvait rien savoir de l’histoire de Notre-Dame puisqu’elle n’a été dégagée par nous qu’un siècle et quelques années plus tard. Les programmes iconographiques n’avaient même pas suffisamment retenu l’attention de l’inspecteur pour qu’on prenne le temps d’en ébaucher une description adéquate. On voulait surtout s’empresser de protéger l’édifice contre les élus de Germigny-l’Exempt qui étaient animés d’un anticléricalisme de bas étage inspiré non par Voltaire ou l’Encyclopédie, mais par un ressentiment d’arriérés, le goût ordurier de la profanation et le plaisir de persécuter et d’humilier en toute impunité un culte déclassé rendu socialement vulnérable par l’évolution politique du pays.
La grande originalité de la loi de 1913 inspirée par la campagne de Maurice Barrès, c’est qu’elle décrète qu’un monument historique appartient au peuple tout entier, et non à une municipalité, encore moins « à monsieur le maire » comme je l’ai entendu répéter servilement l’an dernier par de pauvres gens à propos d’un petit maire néo-rural qui, au moyen d’une association croupion, a privatisé une église du XIIe siècle et croit pouvoir jouer, à la faveur de la décomposition du pays, au tyranneau féodal avec la complaisance – pour ne pas dire la connivence – d’une DRAC qui feint l’ignorance. La loi de 1913, la Charte d’Athènes de 1931 et la Charte de Venise de 1964 sont cependant on ne peut plus formelles. S’il n’appartient qu’à l'État, représentant de la collectivité nationale, de désigner et de préserver les églises classées, c’est parce que témoins d'une histoire commune, elles sont les éléments d'une identité collective et qu’elles sont par conséquent la propriété du peuple tout entier. La deuxième mesure notoire de la loi de 1913 accorde une attention particulière à la protection des abords des monuments et des sites historiques. Elle dessine autour des édifices classés un périmètre de 500 mètres pour y interdire toute dégradation. Le souci des abords sera élargi à l'échelle internationale en 1931 avec la Charte d'Athènes et c’est ce qui permettra avec la Charte de Venise en 1964 de passer de la notion très imparfaite de monument historique au concept, plus organique, de patrimoine. Le deuxième congrès international des architectes et techniciens des monuments historiques réunis à Venise en 1964 provoquera en effet une importante mutation conceptuelle dans la pratique de la conservation en Europe en affirmant que « la notion de monument historique comprend tant la création architecturale isolée que le site urbain ou rural (ville, village) qui portent témoignage d'une civilisation particulière, d’une évolution significative ou d'un événement historique. » Pour la Charte de Venise, la notion « s’étend non seulement aux grandes créations mais aussi aux œuvres modestes qui ont acquis avec le temps une signification culturelle. » De ce point de vue, la loi ELAN de Macron a marqué, comme l’écrit Didier Rykner, une « régression sans précédent » permettant à n’importe quel élu médiocre ou technocrate bas de gamme de saccager le patrimoine pour réaliser des « cœurs de village » absurdes ou d’autres stupidités standardisées liées à la gentrification néo-rurale.
Le démantèlement, en France, de l’État-nation par le haut (Europe) et par le bas (régions) met gravement en danger les monuments classés et leur milieu patrimonial. L’indifférence, envers le Patrimoine, de l’État ou de ceux qui briguent un mandat présidentiel est telle qu’un seul candidat s’est exprimé sur le sujet au cours de la campagne de 2022, Eric Zemmour, ce qui laisse songeur. On se souvient que Charles de Gaulle faisait de la défense du patrimoine le pilier de soutènement de sa politique culturelle : une « certaine idée de la France » inspirée par le « génie de la patrie ». Cette politique gouvernementale prolongeait si complètement l’esprit de 1913 que Michel Lantelme a cru bon d’intituler La Grande pitié des monuments de France le recueil critique des discours de Malraux qui, en 1966, « parle toujours la langue de Barrès » : l’État a le devoir de soustraire les chefs-d’œuvre en péril, qui sont le bien de tous, à l’arbitraire des collectivités territoriales. Dissipons le malentendu qui circule aujourd’hui, entretenu par l’ignorance ou la mauvaise foi, selon quoi Charles de Gaulle fut l’instigateur, en France, de la régionalisation telle que nous la subissons. Comme pour la filiation des monuments historiques, on mélange tout pour obtenir, in fine, une contre-vérité flagrante. En réalité, de Gaulle, persuadé que le département et la commune étaient des circonscriptions périmées, voulait restaurer sous le nom de régions les anciennes provinces qui avaient « conservé leur réalité humaine ». Mais ces régions devaient être placées sous la tutelle rigoureuse des préfets de région détenteurs de l’autorité exécutive et commandant aux chefs des services extérieurs de l’État. Sur le plan institutionnel, les régions du décret du 14 mars 1964 n’étaient donc que des circonscriptions de l’État. Certes, le Général pensait que les anciennes provinces, ressuscitées en régions, pouvaient devenir « les ressorts de la puissance économique de demain », mais pour lui il était clair aussi « qu’une région n’a pas de territoire : seule la Nation en a un. » Aussi, faire de de Gaulle l’instigateur de la régionalisation désastreuse que nous connaissons relève du pur sophisme. Projet positif, la régionalisation gaullienne a avorté avec le rejet du référendum de 1969.
Ce que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de régionalisation est la décentralisation mitterrandienne, processus négatif – c’est une vulgaire démission de l’État – qui n’a aucun rapport avec le projet de 1969 sauf par les côtés où elle incarne à peu près le contraire de ce que de Gaulle voulait. A bien des points de vue, celle-ci représente un danger grave dont nous avons été avertis depuis longtemps. C’est ainsi en toute légitimité que la décentralisation a fait l'objet de critiques sévères, de Jean-Emile Vié (Les 7 plaies de la décentralisation) à Aurélien Bernier (L'illusion localiste: L’arnaque de la décentralisation dans un monde globalisé), en passant par le fameux Collectif Rondin (Le Sacre des notables) et les critiques acerbes et pertinentes de Thierry Coudert (La République féodale), Philippe Guilhaume (La République des clones) ou François de Closets (Comment se gaspille notre argent). Au plan de l'exercice démocratique, en effet, il n’est pas discutable que la décentralisation telle que nous la vivons constitue le « sacre des notables », et qu’elle entraîne ostensiblement gaspillage financier et dysfonctionnement administratif. Philippe Guilhaume – qui était lui-même haut fonctionnaire – touche juste quand il écrit qu’« au nom de nécessités internationales, [les technocrates] ont dépecé la République par le haut, au profit de rouages quasi indépendants et irresponsables, comme la Commission de Bruxelles, et qu’avec la décentralisation, ils ont éparpillé les responsabilités collectives de l'État, en reconstituant à leur profit les fiefs régionaux et locaux d'avant-hier. » C’est exactement ce qui s’est passé, et Thierry Coudert a évidemment raison d’écrire que « la décentralisation a fait de notre République une et indivisible une république féodale. » Laissons la conclusion à François de Closets : « Si l'on peut dire aujourd'hui à juste titre que la décentralisation est irréversible, ce n'est pas en raison de l'attachement de l'opinion publique à son endroit, mais de l'intérêt évident qu'ont les élus à préserver leur tout nouveau pouvoir local. » Mais, finalement, quel caractère de nouveauté pour ces constats ? Le préfet de région Jean-Émile Vié nous avait prévenus dès 1982 des issues de cette mesure clientéliste. Le démembrement de la France par Mitterrand déboucherait nécessairement sur le gaspillage, la corruption, la tyrannie des notables livrés à eux-mêmes et la reconstitution postmoderne de la féodalité. Nul ne songerait à le discuter : nous y sommes depuis un moment déjà.
GENTRIFICATION NÉO-RURALE ET NOUVELLES FÉODALITÉS
A l’heure de la troisième mondialisation, l’idée qu’il existerait une « France périphérique », c’est-à-dire une France des « zones rurales et des villes petites et moyennes » qui s’opposerait à une « politique des métropoles » est complètement dépassée. L’originalité de la mondialisation néolibérale, en effet, c’est précisément qu’elle est de type transversal. Ses acteurs – les multinationales – sont largement déterritorialisés. Grâce aux médias de masse, à la grande distribution et aux GAFAM, catalyseurs de la mondialisation qui véhiculent partout la même sous-culture planétaire et marchande de résonance américaine alignée sur les intérêts des multinationales, le centre est partout et la circonférence nulle part. Ainsi, nos villages sont mondialisés. Et contrairement à une idée reçue d’autant plus tenace qu’elle doit tout au désir et rien à la réalité, certainement plus mondialisés que les métropoles dont le niveau intellectuel moyen, les ressources culturelles et la diversité des milieux assurent un certain degré d’éducation comme d’esprit critique. Par exemple, à Paris, les folles initiatives de la municipalité contre le patrimoine rencontrent une résistance ferme, intelligente, efficace de la part de personnalités les plus variées. Le contraste est fort, de ce point de vue, avec les zones rurales qui d’après le rapport du Sénat de 2020 abritent désormais plus de la moitié des illettrés de France. Ce chiffre correspond bien à l’observation d’une lumpenprolétarisation généralisée d’éléments résiduels de l’exode rural sur laquelle « de nouvelles formes de clochardisation » (M. Jollivet) viennent se sédimenter. La définition que l’ethnologue Germaine Tillion donnait de ce dernier phénomène décrit avec justesse une population mentalement déracinée et indifférente à son environnement, donc totalement disponible pour la sous-culture « planétaire » de la « street », d’Halloween et des jeux vidéos. Aussi est-ce spontanément et sans résistance que celle-ci a accueilli la mondialisation par le vide, ce vaste processus d’abolition de toute vie intérieure, de dépossession de soi et d’effacement des identités qui accompagne nécessairement la transformation des sociétés en marchés homogènes. Il est évident qu’une telle population est parfaitement insensible au patrimoine historique et d’ailleurs inapte à le comprendre, sinon inconsciemment disposée à le haïr par réflexe conditionné, puisque les acteurs de la mondialisation néolibérale font circuler en permanence, sous toutes les formes possibles, l’injonction de liquider au plus vite tous les facteurs d’enracinement culturel qui font obstacle à son expansion illimitée.
Ce contexte démographique désastreux aux points de vue physique, intellectuel et moral vient aujourd’hui se compliquer d’un phénomène nouveau sur lequel j’ai eu l’occasion d’échanger des propos décisifs il y a quelque temps avec le sociologue et urbaniste Jean-Pierre Garnier : l’exode urbain des néo-ruraux. Cette soudaine invasion des campagnes par les citadins, les bobos branchés l’appellent également le « hacking rural », une expression plus qu’instructive sur leur état d’esprit puisque, réduisant la réalité des campagnes au monde virtuel d’Internet, elle emprunte au charabia des agences numériques l’idée de pirater, ou plus précisément de parasiter, les villages. Or il s’agit là non d’un phénomène isolé, anecdotique ou anodin, mais d’une tendance générale et d’un remplacement, à une échelle qui reste à déterminer, des populations villageoises par des réseaux constitués au sein des classes les plus aisées des grandes métropoles et composés de riches « papy boomers » à la retraite, de saltimbanques culturo-mondains ou de « créatifs » dématérialisés capables de travailler à distance. Ces réseaux se fixent ouvertement comme objectif de « gentrifier les campagnes » à leur avantage grâce à des appuis politiques au sein des conseils régionaux. Mais comme nous l’avions conclu avec Jean-Pierre Garnier, c’est dans la pire acception du terme qu’il faut ici interpréter la gentrification. En effet, il ne s’agit pas seulement de transformer des villages cibles en 21e arrondissement de Paris où poursuivre la vie de l'entre-soi bourgeois, mais de façon beaucoup plus grave de restaurer, en profitant de l’abandon des pouvoirs publics, une dictature des notables où « gentry » retrouve son sens fort, celui d'une micro-tyrannie féodale des hobereaux. Cette situation, et notamment la symbiose prévisible et spontanée entre lumpenproletariat et gentry, n’annonce pas vraiment un avenir radieux. Nous nous limiterons à évoquer comme exemple le seul sujet concerné par cette tribune : les monuments historiques et la conservation du patrimoine. Ainsi, que penser quand on assiste à la privatisation de fait, par la gentry néo-rurale, d’églises classées qui, comme nous l’avons rappelé, appartiennent à tout le monde ? Que penser des confiscations de clefs d’un bâtiment public par des notables ? Que penser des municipalités qui prétendent que l’église leur « appartient » et montent des associations croupions pour en filtrer l’accès ? Que penser, pour donner un exemple éloquent, de cette scène invraisemblable rapportée avec effarement par une historienne de l’art liégeoise qui, entrant dans une église, s’est vue emboîter le pas par un de ces néo-ruraux tenant un fusil à la main ?
Les DRAC et UDAP concernées sont-elles réellement ignorantes de ces agissements ou bien sont-elles complices ? Le soupçon est permis. Au cours des cinq dernières années, tout le monde a commencé à flairer quelque chose de pourri au royaume de la DRAC. Trois épisodes notamment ont marqué les années 2017, 2018 et 2019 au niveau national et même international qui laissent supposer que la DRAC est en train de sérieusement dériver. En 2017, c’est l’affaire de la carrière de la Corderie, à Marseille, sur laquelle Guy Coja, fameux militant du patrimoine, tient au Marseillais des propos qui incitent à la réflexion : « Il y a une collusion évidente, déclare Coja, entre les fonctionnaires de la DRAC aux ordres, la Ville, et Vinci! L’histoire de la Corderie, c’est un scandale et un déni de démocratie! » En 2018, c’est l’organisation publique d’une exposition de promotion explicite de la pédophilie financée par la DRAC à Saint-Étienne qui fait scandale (« L’enfance est un espace qu’il nous plaît de subvertir »). Le chef du cabinet régional, qui tombe des nues, se dit choqué : « La ligne rouge a été franchie, déclare-t-il à la presse. La collectivité regardera de près ce qu’elle est amenée à financer. » Il serait temps, en effet. Enfin, il y a l’affaire de l’incendie de Notre-Dame de Paris où, comme nous l’expliquent Christophe Labbé et Hervé Liffran dans le Canard Enchaîné du 19 juin 2019, la DRAC, par son incurie volontaire, porte une lourde responsabilité. Confirmant de façon très instructive que ces affaires commencent à devenir embarrassantes, on a cru bon de créer par l’arrêté du 10 avril 2018 un collège de déontologie au ministère de la Culture.
Certes, le directeur régional des affaires culturelles dépend du ministère de la Culture, autrement dit la DRAC dépend de l’État, et l’UDAP, unité départementale dirigée par un architecte des bâtiments de France, de la DRAC. Mais ces services déconcentrés de l’État sont mécaniquement amenés à subir davantage l’influence contiguë des collectivités territoriales, c’est-à-dire des conseillers régionaux et départementaux ou celle des maires, voire des notables, que l’influence hiérarchique du ministère de la Culture. Plus on descend les échelons, jusqu’à l’UDAP et à l’architecte, plus les intérêts deviennent opaques dans les prises de décision concernant les projets d'aménagement aux abords des monuments historiques et les demandes de subventions, ce que l’association Urgence Patrimoine s’est fait une spécialité de dénoncer. On peut donc redouter le développement d’une corruption par contiguïté. Comme l’écrit très bien Ian Hamel, en effet, depuis la loi du 2 mars 1982 supprimant la tutelle exercée par le préfet de région sur les collectivités territoriales, « il n'y a pas vraiment eu de miracle, hormis une régionalisation, une départementalisation, une municipalisation des passe-droits et de la corruption. » En 1993, Édouard Balladur avait demandé à Robert Bouchery, conseiller d'État, de produire un rapport sur la corruption et la transparence de la vie économique où Bouchery observait timidement qu’il serait souhaitable que les conseils régionaux, les conseils départementaux et les communes se dotent « d’une instance autorisée qui garantisse le respect, par les agents comme par les élus, des normes et des références déontologiques. » Cela n’a jamais été fait. Aussi, est-il bien raisonnable d’abandonner les DRAC à elles-mêmes pour les laisser entrer en orbite autour de ces collectivités?
---
NOTES
[1] Je partage par ailleurs les points de vue de Françoise Choay et Régis Debray sur l’absurdité d’un « patrimoine mondial » et le concept de frontière, comme les partageait François-Bernard Huyghe, disparu il y a quelques jours seulement au moment où j’écris ces lignes.
04/10/2022