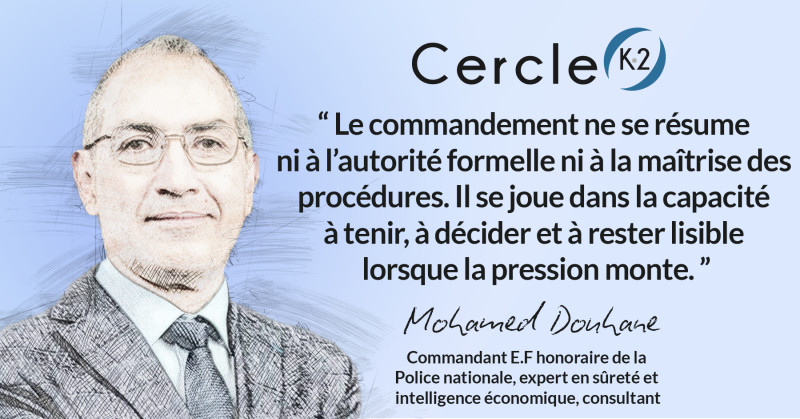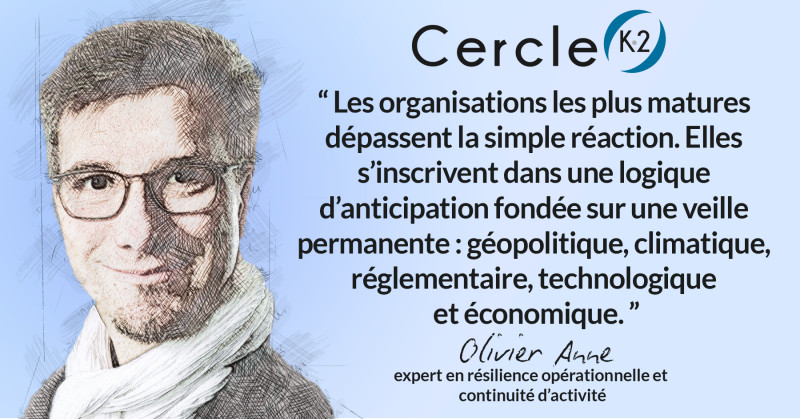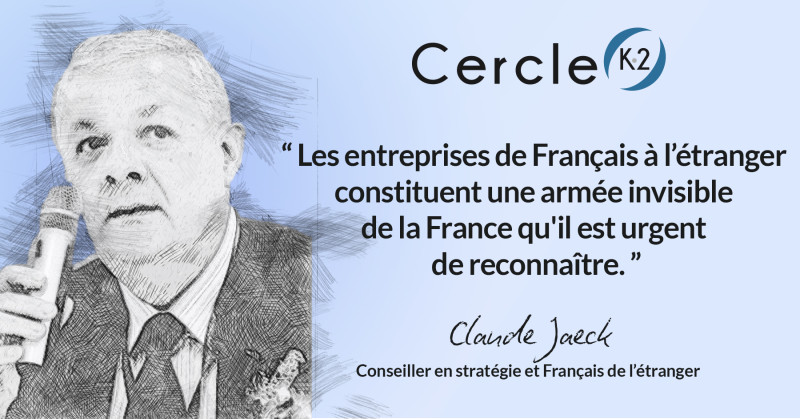IA et robotique chinoises : disruption sociétale majeure en vue ?
01/10/2025 - 6 min. de lecture
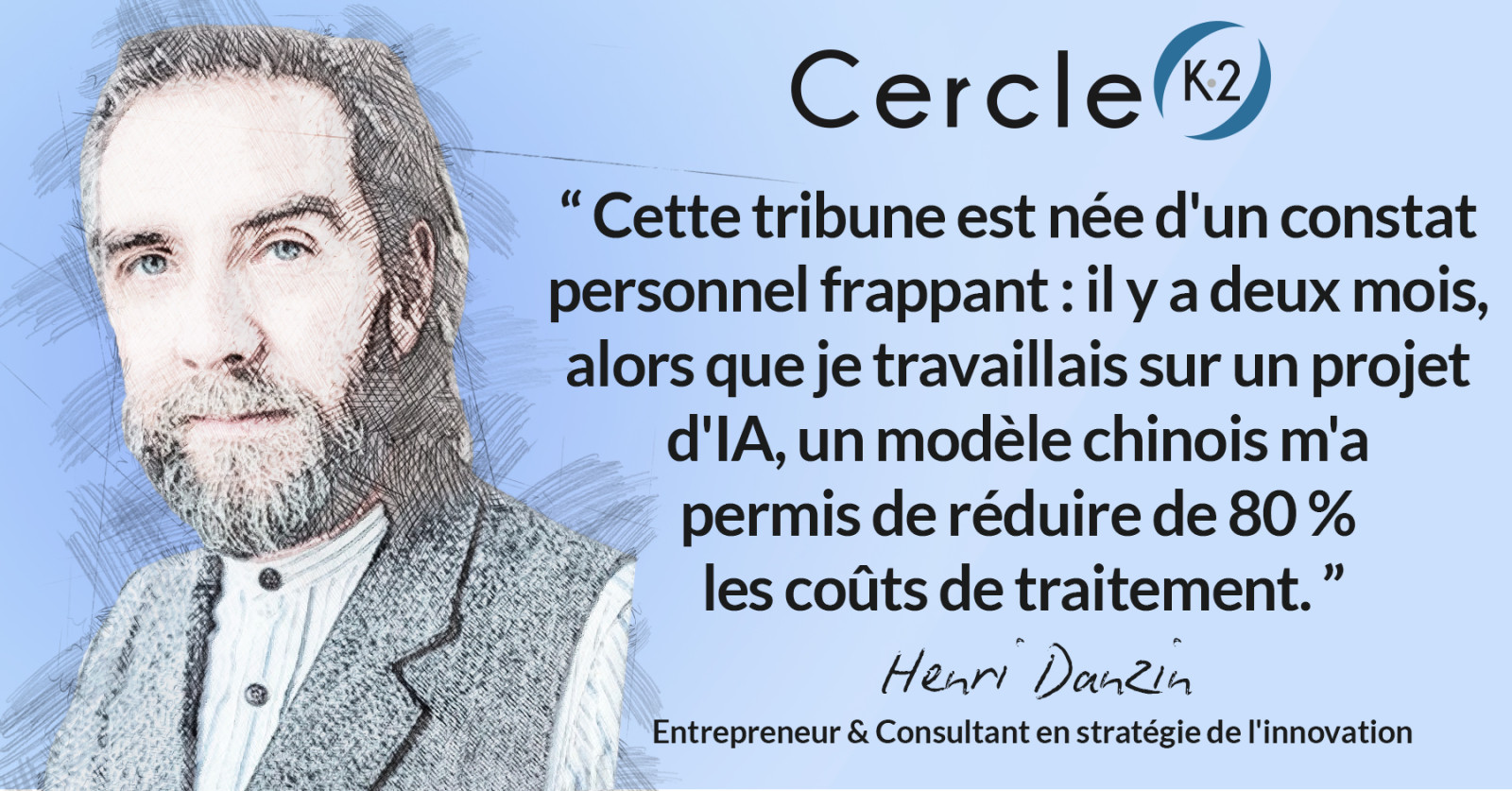
Cercle K2对所有发布观点既不赞同也不反对,所有观点态度仅属于作者个人。
Henri Danzin est Entrepreneur & Consultant en stratégie de l'innovation.
---
Cette tribune est née d'un constat personnel frappant : il y a deux mois, alors que je travaillais sur un projet d'IA, un modèle chinois m'a permis de réduire de 80 % les coûts de traitement, tout en offrant des performances équivalentes aux solutions américaines. Au même moment, le robot R1 chinois, vendu 6 000 euros, apparaissait, rivalisant avec les technologies occidentales pour quatre fois moins cher... Simple coïncidence ?
---
Nous assistons à l'émergence d'une révolution silencieuse qui pourrait redéfinir l'équilibre géopolitique du XXIe siècle. La Chine applique à l'intelligence artificielle sa stratégie éprouvée de « cost killing » qui lui a permis de dominer les secteurs de l'acier, du photovoltaïque, de l'électronique et aujourd'hui de la voiture électrique. Mais cette fois, l'enjeu dépasse le numérique : en associant une IA à faible coût à une robotique de pointe, Pékin pourrait transformer le monde physique lui-même.
Le constat est sans appel : qu'il s'agisse d'IA ou de robotique, la Chine rivalise désormais à armes égales avec l'Occident en performance, mais pas en prix - rapport de un à vingt. Cette parité technique à coût dérisoire transforme l'avantage concurrentiel chinois en véritable arme de disruption massive contre l'industrie européenne.
Du smartphone à l'IA : la méthode chinoise perfectionnée
Depuis le début des années 2000, Pékin a perfectionné un modèle de développement implacable en trois phases : d'abord copier et maîtriser les technologies occidentales par l'ingénierie inverse, puis accepter des pertes temporaires pour gagner des parts de marché à prix cassé, enfin améliorer rapidement la qualité et innover pour éliminer définitivement l'avantage occidental.
L'intelligence artificielle est l'application la plus sophistiquée de cette méthode, à laquelle s'ajoute une dimension inédite : l'open source comme arme de conquête. En rendant leurs modèles librement accessibles, les entreprises chinoises créent une dépendance mondiale à leur écosystème technologique. DeepSeek distribue ses modèles sous licence MIT et Qwen multiplie les versions ouvertes, avec plus de 300 millions de téléchargements. Cette générosité apparente cache une stratégie de colonisation technologique subtile, mais redoutable.
Il est difficile d'estimer les montants actuellement investis par l'État chinois, qui n'hésite pas à mobiliser des ressources considérables pour financer cette stratégie de dumping technologique. Les gouvernements provinciaux complètent cet effort par des subventions massives. Shenzhen, par exemple, a lancé un fonds de 10 milliards de yuans (1,2 Md€) pour l'intelligence artificielle et la robotique en février 2025.
Quand la performance rattrape le prix
L'efficacité redoutable de cette stratégie neutralise le principal argument occidental : la supériorité qualitative. En treize mois, l'écart de performance entre les meilleurs modèles chinois et américains est passé de 9,26 % à 1,70 %, selon les données vérifiées du Stanford AI Index 2025.
Cette convergence bouleverse l'économie du secteur. Une entreprise utilisant 100 millions de mots par mois paierait 9 000 dollars avec OpenAI, mais seulement 2 000 dollars avec DeepSeek, ce qui représente une économie de 78 %. À performance équivalente, cette différence est décisive.
Les innovations techniques chinoises expliquent en partie ces gains d'efficacité remarquables. Les architectures de type « Mixture of Experts » développées par DeepSeek permettent d'activer seulement 37 milliards de paramètres sur les 671 milliards que compte le modèle, réduisant ainsi les besoins de calcul par cinq.
Cependant, les comparaisons des coûts d'entraînement nécessitent des précisions importantes. Le chiffre de 5,57 millions de dollars pour DeepSeek ne représente en effet que le coût de l'entraînement final, hors investissements en infrastructure (estimés à plus de 1,3 milliard de dollars), recherche et développement, et tentatives infructueuses. Malgré ces nuances, l'efficacité chinoise reste remarquable par rapport aux coûts occidentaux équivalents.
L'IA prend corps : la robotique domestique comme arme décisive
La véritable révolution se joue dans le domaine de la robotique, où l'IA rencontre le monde physique. Cette convergence entre l'IA à faible coût et la robotique abordable constitue le cœur de la menace chinoise. Lorsqu'un algorithme intelligent pilote un corps mécanique à bas prix, toute l'économie industrielle est menacée.
Le robot humanoïde R1 d'Unitree coûte 5 900 dollars, alors que le futur Optimus d'Elon Musk devrait coûter plus de 30 000 dollars. BYD prévoit de commercialiser son robot BoYa à 10 000 dollars d'ici décembre 2025. Les entreprises chinoises ne vendent plus de la puissance de calcul, mais des travailleurs artificiels complets à des prix défiant toute concurrence.
L'avantage manufacturier chinois se révèle décisif. UBTech produit 90 à 95 % des composants de ses robots en interne, avec des fournisseurs situés à moins de dix minutes. Cette intégration verticale permet une optimisation impossible pour les concurrents occidentaux, qui dépendent de chaînes d'approvisionnement fragmentées.
La province du Guangdong abrite plus de 160 000 entreprises de robotique, créant un écosystème qui permet de réduire les coûts.
Les chiffres de la domination chinoise sont éloquents : leur part du marché mondial de la robotique est passée de 29 % à 47 % entre 2015 et 2023, tandis que les marques étrangères chutaient de 70 % à 53 %. Plus significatif encore, la Chine représente désormais 51 % des installations robotiques mondiales, avec 276 288 robots industriels installés en 2023, démontrant ainsi que cette révolution robotique chinoise transforme déjà l'automatisation à l'échelle mondiale.
De l'algorithme au travailleur artificiel
Imaginez un robot humanoïde à 6 000 euros qui travaille 24 heures sur 24, sans congés, sans assurance maladie ni formation syndicale. Ses seuls coûts de « possession » sont l'électricité et une maintenance régulière. En trois ans, il a amorti son coût d'acquisition. Puis, il continue de travailler gratuitement pendant des années.
Cette équation économique bouleverse tous les secteurs. Dans la restauration, un robot-serveur remplace trois employés à temps partiel. Dans le secteur de la logistique, il manipule les colis sans se fatiguer ni se blesser. Dans le secteur du nettoyage industriel, il nettoie les bureaux pendant que les employés sont en pause. Dans le secteur de l'aide à la personne, il assiste les personnes âgées pour une fraction du coût d'un auxiliaire de vie.
Mais ce robot ne se contente pas d'exécuter des tâches répétitives : doté d'une intelligence artificielle, il apprend, s'adapte et communique. Il comprend les instructions vocales, se déplace dans des environnements complexes et reconnaît les situations d'urgence. Cette « intelligence » embarquée transforme un automate en véritable assistant polyvalent.
Pour les petites entreprises européennes, peu robotisées jusqu'ici faute de moyens ou d'espaces adaptés, confrontées aux hausses salariales, aux difficultés de recrutement et aux contraintes réglementaires, l'équation change radicalement : pourquoi employer un humain à 2 000 euros mensuels quand un robot équivalent revient à quelques centaines d'euros par mois sur cinq ans, sans réaménagement lourd ni formation technique complexe ? Cette arithmétique implacable annoncerait une substitution massive du travail humain, dépassant largement le périmètre de l'IA pure qui bouleverse déjà les métiers du tertiaire. Cette fois, c'est le travail physique lui-même qui serait menacé.
Au-delà des enjeux économiques, cette dépendance matérielle soulève des questions cruciales de souveraineté. Car contrairement aux modèles d'IA distribués en open source, les robots restent des objets physiques propriétaires. Des millions de machines chinoises dans nos entreprises, nos entrepôts, nos foyers : qui contrôle leurs composants critiques ? Leurs mises à jour firmware ? Leurs capteurs et caméras ? Cette colonisation robotique offrirait à Pékin un réseau de surveillance physique sans précédent au cœur même de nos économies, transformant chaque robot en potentiel espion industriel et domestique.
Une révolution qui prendrait l'Europe de court
À l'instar de la Ford T à son époque, une technologie accessible financièrement, simple d’usage et efficace peut bouleverser une société en quelques années. La révolution chinoise du « cost killing » dépasse le numérique grâce à sa double stratégie : convergence de l'intelligence artificielle et de la robotique, et conquête par l'open source. Face au duopole technologique sino-américain qui se dessine — la Chine distribuant gratuitement ses modèles les plus performants et les États-Unis maintenant leur avance propriétaire —, l'Europe et la France se trouvent dans une situation critique.
Cette transformation révèle surtout l'accélération stupéfiante de l'IA ces trois dernières années. Alors que GPT-3 était une prouesse technologique réservée à quelques géants en 2021, des modèles équivalents apparaissent aujourd'hui chaque trimestre, souvent en open source. Cette compression temporelle change la donne : l'avantage technologique occidental s'évapore désormais en quelques mois plutôt qu'en décennies. Lorsque les développeurs européens adoptent massivement ces modèles chinois gratuits ou les solutions américaines propriétaires, ils contribuent malgré eux à la domination du duopole sino-américain sur l'écosystème technologique mondial.
Une chose est certaine : si la Chine réussit son pari d'accélérer massivement le déploiement d'une robotique équipée d'une intelligence artificielle, peu coûteuse, suffisamment fiable et maintenable pour entrer dans la vie quotidienne de la population (livraisons, services à la personne, etc.), cela créerait des bouleversements sociétaux et économiques majeurs pour lesquels la France et la plupart des pays de sa zone n'ont pas anticipé les réponses politiques. Et si nos dirigeants tentaient a posteriori de normer et de légiférer pour en retarder l'adoption, ils ne feraient qu'accentuer le décalage entre nos pays et ceux qui les adopteront massivement.
Roy Amara observait que « nous avons tendance à surestimer l'effet d'une technologie à court terme et à sous-estimer son effet à long terme ». Si l'on admet que l'IA actuelle découle directement de l'émergence du Web dans les années 1990, qui a généré cette masse colossale de données numériques — le « pétrole » de l'intelligence artificielle —, alors nous assistons peut-être à la matérialisation de l'un de ces « effets à long terme » de la révolution numérique. Un effet qui, longtemps cantonné à la science-fiction, est désormais à nos portes.
---
01/10/2025