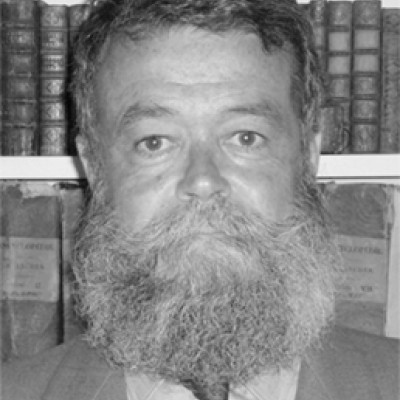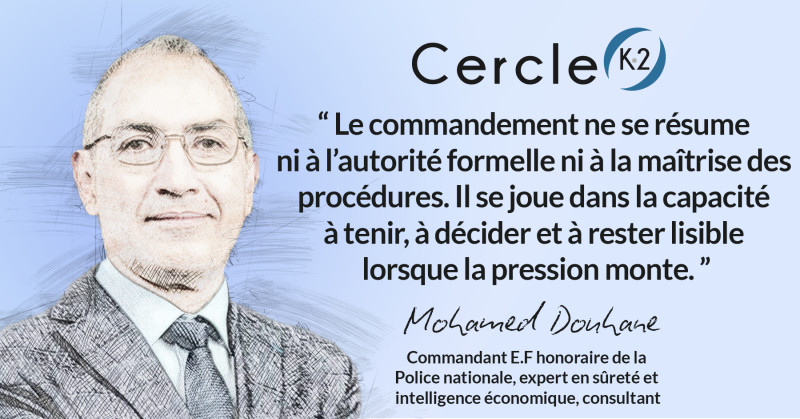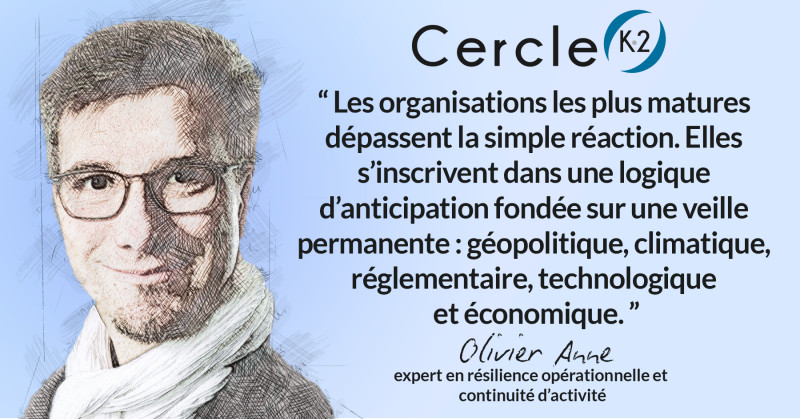De la démocratie à la République : une question d’autorité
20/02/2025 - 22 min. de lecture
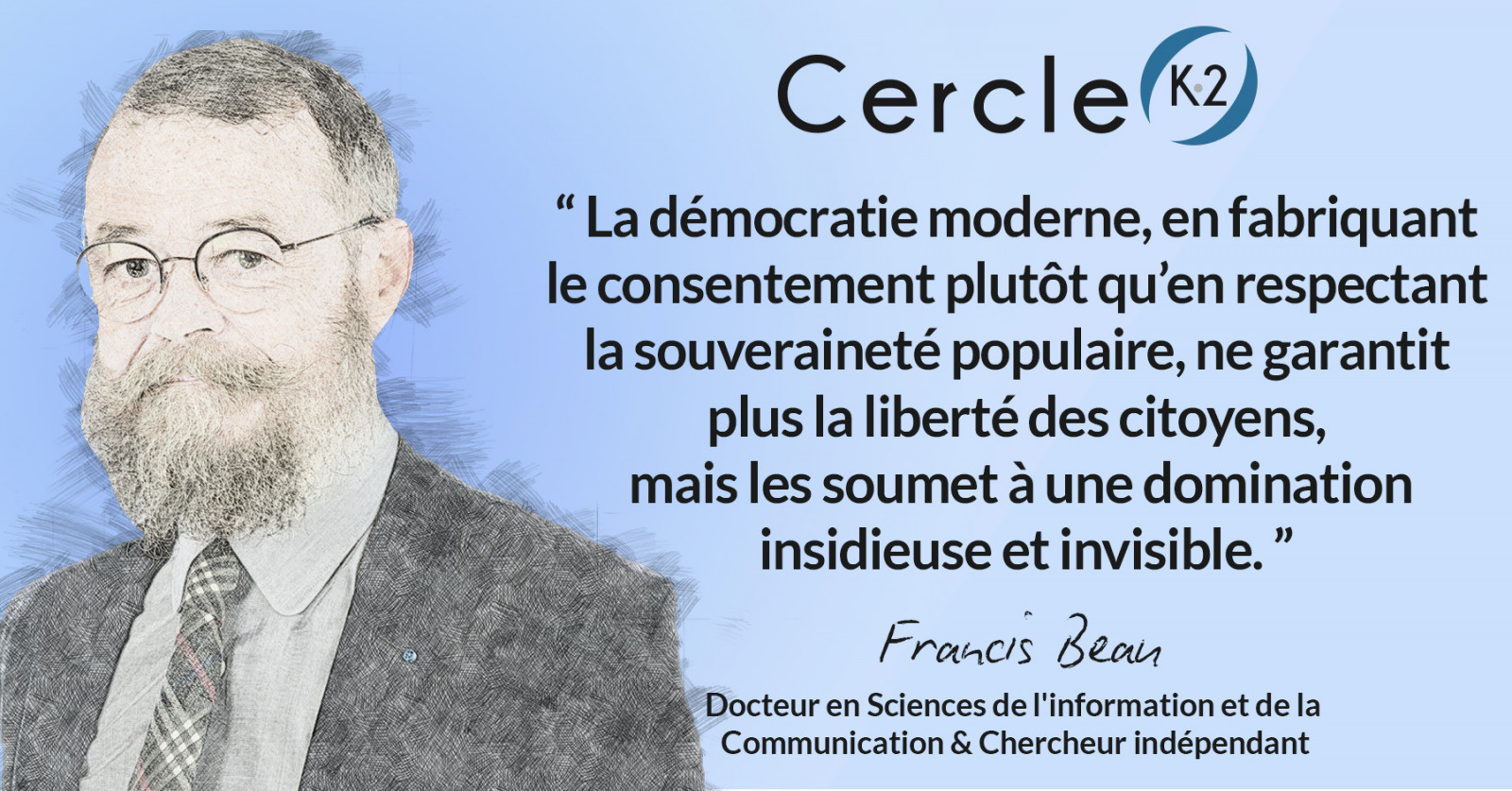
Cercle K2 neither approves or disapproves of the opinions expressed in the articles. Their authors are exclusively responsible for their content.
Francis Beau est Docteur en Sciences de l'information et de la Communication & Chercheur indépendant.
---
La fabrique du consentement
Contrairement aux régimes autoritaires, si l’on en croit Edward Bernays[1], la démocratie ne contraint pas, du moins… en apparence ! C’est pourquoi la démocratie offre, selon lui, un cadre idéal à la propagande. Le cœur du problème est, en effet, dans ce "du moins…en apparence" ! Auteur d’un ouvrage qui a fait référence au début du siècle dernier en matière de "relations publiques" ou de manipulation de l’opinion[2], et dont on dit que Goebbels s’est largement inspiré pour la propagande nazie, Bernays postule l'existence d'un "inconscient collectif" et justifie ainsi le recours à une domination des masses jugées irrationnelles, en s'appuyant sur leurs désirs les plus primaires et leur instinct grégaire. Tout l'art du propagandiste consiste, selon lui, à diriger les désirs du consommateur ou de l'électeur de telle sorte qu’il puisse croire librement acquis son "désir fabriqué". La soumission parfaite est ainsi invisible et indolore. Sans cette "fabrique du consentement", estime-t-il encore, la démocratie sombrerait dans le chaos.
Éviter le plongeon démocratique dans le chaos
Je crois, pour ma part, tout au contraire, que c’est cette "fabrique du consentement", la "communication" (la com) ou les public relations, noms politiquement corrects de la propagande moderne, qui précipite la démocratie dans le chaos. La com, c’est l’art du démagogue[3] que dénonçait déjà Aristote en son temps, en l’associant à la démocratie[4] dont il serait l’aboutissement naturel. Quand le régime a recours à la séduction (agôgos) pour diriger malgré lui ce peuple (dêmos) à qui le pouvoir ou la puissance (kratos) a pourtant été donnée, il se corrompt et risque ainsi d’adopter une conduite "déraisonnable" des affaires publiques. Le peuple, en effet, ne peut plus adhérer par la raison, car il est empêché de choisir ses représentants en toute connaissance de cause, et en est réduit à suivre un guide perverti s’adressant à son inconscient collectif.
Le parti unique
À force de "fabriquer" du consentement, les propagandistes politiques à qui la démocratie/démagogie semble en effet convenir, contribuent à façonner cet « extrême-centre » que certains commentateurs politiques dénoncent. C’est en réalité la fabrique de cet "en même temps" systématique, ni de droite, ni de gauche, mais entre les deux, qui exclut toute alternative claire et suffisamment tranchée pour donner au peuple la possibilité de choisir ses représentants en toute connaissance de cause. Tout débat contradictoire tranché avec l’autre camp (celui qui ne consent pas) devient suspect, tout affrontement bipartisan suffisamment marquant est condamné, toute majorité claire s’avère ainsi improbable et pire, toute décision stratégique courageuse indispensable à l’action en politique devient impossible. La recherche perpétuelle du consentement pousse inévitablement le peuple à l’impuissance et ses représentants à l’inaction. La nature ayant horreur du vide, le pouvoir ainsi vidé de son sens, risque alors de tomber comme un fruit mûr entre les mains de manipulateurs mieux avisés, mais pour le coup moins soucieux de la souveraineté populaire.
Loin de se définir par un objectif de modération, cet "extrême centre" relève donc en réalité d’une idéologie totalitaire. Au prétexte de maîtriser les passions et de faire prévaloir la modération sur les extrêmes, cette idéologie tend en effet à monopoliser le pouvoir en empêchant toute possibilité d’alternance. Toute opposition au parti unique du consentement fabriqué est alors poussée vers les extrêmes. Toute politique de droite est rejetée vers une extrême droite accusée de sympathie envers des régimes dits "autoritaires", tandis que toute politique de gauche est rejetée vers une extrême gauche aux tendances totalitaires souvent sournoises et parfois revendiquées. C’est bien cette perpétuelle "fabrique du consentement" qui précipite nos démocraties "dans le chaos" en créant de toutes pièces un extrême-centre, sorte de parti refuge regroupant les modérés des deux camps dans un même moule faisant office de parti unique du "en même temps"[5].
La question du régime politique
La question qui se pose à ce stade de la réflexion, est de savoir comment éviter cette dérive des affaires publiques portée par la démocratie, qui en ferait, comme le craignait Aristote, un synonyme de démagogie. Quel meilleur régime[6] politique[7] peut-on préconiser pour éviter une telle déroute de la démocratie ? Je propose pour cela de prêter attention au sens profond des mots et en particulier à leur étymologie qui pèse d’un poids important sur l’inconscient collectif que l’usage linguistique commun contribue à façonner. Étymologiquement, la démocratie, on l’a vu, c’est le pouvoir donné au peuple. Quel que soit le sens donné au grec ancien krátos dont nous vient le suffixe "-cratie", allant de "pouvoir" à "gouvernement", en passant par "puissance", "force souveraine", "domination", ou encore "autorité" (on y reviendra), l’idée principale exprimée est celle de la force. L’exercice de la force auquel s’assimile la notion de puissance, garantie de souveraineté, voire source de domination, ne semble pourtant pas être ce qui prévaut dans l’acception moderne du terme « démocratie » qui, on l’a vu, ne fait pas appel à la contrainte, "du moins … en apparence" !
Si la démocratie moderne est à ce point associée à la manipulation de l’opinion publique, au risque de sombrer dans le chaos en son absence, c’est bien que la dérive annoncée par Aristote s’est imposée au XXe siècle de notre ère en occident. Certes, la démocratie n’emploie pas la force, tout au moins pas de manière systématique, pour contraindre les corps, mais elle utilise la com pour contraindre les esprits. Même si l’usage du mot "démocratie" s’est très largement imposé dans le discours politique moderne, il serait donc sans doute plus sage de penser à un autre terme, moins connoté par l’idée de recours à la force, pour désigner le bon régime à préconiser en ce début de troisième millénaire.
Le modèle gréco-romain
Si le modèle de la démocratie grecque, qui donne le pouvoir au peuple, avec le risque que celui-ci lui soit repris par un régime dévoyé, n’est pas le bon, quel modèle choisir alors pour gouverner nos sociétés modernes mondialisées de plus en plus complexes ? Leur périmètre s’est transformé au cours des siècles à partir des cités, qui se sont élargies aux royaumes ou aux nations, et parfois aux empires, mais le modèle doit pouvoir s’adapter aux moeurs du troisième millénaire comme il s’est adapté à celles de l’antiquité et des siècles qui ont suivi. Pour passer de la Cité au Royaume puis à l’Empire, les Romains ont choisi la République[8], en conservant la structure aristocratique[9] du sénat, puis en y accolant l’organisation démocratique des comices, et en se dotant d’un commandement (consuls puis empereurs[10]) chargé d’exercer l’autorité indispensable à l’action politique, en assumant le rôle de pouvoir suprême. C’est aussi ce qu’a voulu beaucoup plus tard la Constitution des États-Unis d’Amérique, en alliant démocratie (Representatives), aristocratie (Senate) et monarchie (President, Commander in Chief), ou encore le général de Gaulle avec notre Ve République qui repose sur l’autorité incontestable d’un Président (le monarque), chef des armées, un Sénat (l’aristocratie) et une Chambre des Députés (les représentants du Peuple ou la démocratie en action).
La question de l’autorité
Dans chacun de ces exemples, on voit bien que ce qui distingue le régime républicain de la démocratie grecque, c’est le rôle essentiel dévolu à l’exercice de l’autorité. À force pourtant, de gommer toute idée de contrainte en idéalisant avec Edward Bernays cette "fabrique du consentement" à laquelle la démocratie semble offrir un "cadre idéal", c’est l’idée même d’autorité que l’on diabolise. Pourtant, comme l’avaient bien vu les Romains, et bien d’autres après eux, l’exercice de l’autorité pour diriger la nation est une nécessité impérieuse dont aucun régime politique ne peut véritablement s’affranchir.
L’autorité, ce "pouvoir de commander" selon l’Académie, c’est en réalité le droit de commander allié à l’art de se faire obéir du souverain ou du chef et au devoir d’obéir de ses sujets ou de ses subordonnés. Le Grand dictionnaire de la philosophie la définit comme la "faculté pour une personne physique ou morale d’être l’auteur de ses propres actes"[11]. Cette dernière définition, quoique bien trop générale pour nous être utile en pratique, est intéressante néanmoins à noter, car elle indique que l’autorité est indissociable de la notion de responsabilité. S’agissant de l’État, soit une personne morale, l’autorité réside dans sa capacité à s’imposer en toute responsabilité dans le jeu collectif. Dans un monde parfait, cette capacité devrait pouvoir s’exprimer de manière naturelle, en excluant toute forme de force, non seulement physique, mais également mentale. Même si le monde n’est pas toujours parfait, nul doute que l’autorité n’est pas seulement une question de force.
Face à "l'ordre égalitaire de la persuasion", se tient "l’ordre autoritaire", qui est toujours "hiérarchique", nous dit Hannah Arendt qui précise sa vision de l’autorité en revenant sur l’étymologie du mot. Celui-ci, nous dit-elle, vient du latin auctoritas, dérivant du verbe augere, "augmenter". Ce qui fonde l’autorité de ceux qui commandent, c’est une sorte de transcendance, une valeur sacrée en provenance du passé, qu’il convient d’entretenir en la sublimant ou en perpétuant son évidence, soit en élevant sans cesse sa pertinence. Ce qui fait l’autorité de l’État, c’est une hiérarchie reconnue par tous comme légitime.
S’il faut bien parler ici de consentement, ce n’est pas de celui que nous « fabrique » Bernays et ses adeptes, mais bien du consentement à une hiérarchie, consentement qui est au cœur de l’organisation de la Cité. Le mot "hiérarchie" nous vient du grec ecclésiastique hierarkhia, composé de hieros, "sacré" et de arkhós "dirigeant, chef, souverain, celui qui gouverne, qui détient l’autorité ou qui commande", dérivé de arkhein, "commander". "En vérité, l'unité, la cohésion, la discipline intérieure (…) doivent être des choses sacrées", nous disait de Gaulle dans son discours de Bayeux, à propos du gouvernement de la France. La hiérarchie, c’est au sens propre, une organisation du commandement fondé sur un ordre de subordination dont le caractère sacré sur lequel il nous faudra revenir, ne doit pas nous échapper.
Autorité et souveraineté populaire
Dans les régimes républicains évoqués plus haut, ou tout au moins dans leur principe, la répartition des pouvoirs est indubitablement aristocratique[12], mais l’autorité exercée par l’État sous la responsabilité de son chef, par délégation du peuple souverain, demeure assurément démocratique. Si le peuple est bien souverain (arkhós), il n’exerce pas lui-même le pouvoir (krátos), qu’il délègue à l’État (la politeía chez Platon, que Cicéron traduit par Republica). Le bon modèle est donc bien celui de la République, qui ne met pas en avant le pouvoir (krátos) et sa répartition, mais s’appuie sur l’idée de souveraineté (arkhós), indissociable du concept d’autorité et de ses différents modes d’exercice. Ces derniers sont associés à la notion de responsabilité et à celle de hiérarchie dont on a vu que l’étymologie nous rappelle le caractère sacré qu’elle revêtait à l’origine.
Étymologiquement, on l’a vu également, la république c’est la « chose publique », res publica en latin. Le préfixe res signifie la "chose", puis dans un latin populaire de la fin de l’empire romain, la "cause". Devenant publique, cette cause concerne le peuple et relève de l’État. Dès lors que le peuple est reconnu comme souverain, il s’agit de cette grande Cause garante de l’intérêt général, dont on retrouve le caractère sacré évoqué plus haut et qui prend corps dans la personne du chef de l’État, le monarque[13], dépositaire de l’autorité publique qui procède de la souveraineté populaire.
Autorité et république
Le concept d’autorité est bien au cœur de toute réflexion sur l’idée démocratique de souveraineté populaire. Avant donc de s’interroger sur la nature démocratique de tel ou tel régime, c’est à la nature même de la souveraineté et à la manière dont elle peut être exercée par le peuple, qu’il faut s’intéresser. En République, le peuple souverain (arkhós), est seul (mónos) dépositaire de l’autorité publique dont il délègue la responsabilité à un "monarque" siégeant au sommet d’une hiérarchie "aristocratique" répartissant les instruments du pouvoir (krátos) entre les mains des meilleurs (aristos), au service d’une grande cause publique (res publica), la Cause du peuple (dêmos), entièrement consacrée au respect de l’intérêt général. C’est la raison pour laquelle on parle souvent de "monarchie républicaine" à propos de notre cinquième République, dont la nature est indéniablement monarchique avant d’être à proprement parler démocratique.
L’ordre autoritaire de la hiérarchie plutôt que l’ordre égalitaire de la persuasion
Malgré son aspect monarchique et ses à-côtés aristocratiques, qui semblent quelque peu détonner au regard de nos conceptions modernes de la démocratie héritées de la Révolution française, ce type de République semble bien être ainsi le régime politique le plus apte à affronter le "grand chambardement géostratégique"[14] caractéristique de ce début de troisième millénaire, et ses impacts sur la pratique démocratique à l’échelle de la planète. Le pouvoir (krátos), dont l’exercice procède du peuple (dêmos) y est proprement démocratique. Sa mise en œuvre s’effectue néanmoins selon un ordre sacré (hieros) organisant le gouvernement (arkhós) et la hiérarchie (hierarkhia) des pouvoirs publics. L’autorité publique dont le souverain est le dépositaire suprême, y est assurée par cette organisation hiérarchique très aristocratique, qui attribue aux meilleurs (aristos), à chaque niveau du fonctionnement de l’État, la part de pouvoir (krátos) nécessaire à l’exercice du commandement, qui leur revient.
Frontières entre sacré et profane, et entre spirituel et temporel
Comment concilier dès lors ce caractère sacré de la hiérarchie indispensable à l’exercice de l’autorité, avec le caractère nécessairement profane des valeurs républicaines, dans le cadre particulier de notre laïcité bien française qui exige une neutralité rigoureuse de la part des institutions à l’égard de la religion ? La laïcité en France, résulte d’une lente émancipation du pouvoir temporel, pour affranchir la politique de la primauté historique du pouvoir spirituel de l’Église. Depuis le début du siècle dernier, elle implique, une séparation rigoureuse entre les Églises et l’État et donc une stricte neutralité de l’État à l’égard des religions. En réalité, cette séparation des Églises et de l’État oppose le pouvoir temporel de l’État ordonnant la vie des citoyens dans la cité, à un pouvoir spirituel des Églises entendant ordonner la vie des hommes en société.
Le régime républicain du troisième millénaire que nous appelons de nos vœux, permettrait de substituer à cette distinction des pouvoirs opposant le citoyen dans la cité à la société des hommes, une séparation nouvelle en matière d’autorité qui distinguerait l’ordre citoyen relevant de l’État, des valeurs humaines (ou sociales) relevant des Églises. Plutôt que d’opposer spirituel et temporel en les appliquant à l’exercice du pouvoir (krátos), on peut envisager d’en appliquer l’usage à l’exercice de l’autorité, ce droit de commander allié à l’art de se faire obéir du souverain ou au devoir d’obéir de ses sujets. Le pouvoir doit en effet rester, sans aucune ambiguïté, une prérogative des institutions temporelles, mais l’autorité peut aussi bien relever du temporel pour ce qui concerne le « droit de commander » associé au "devoir d’obéir" (le Droit), que de l’esprit rationnel ou de la raison, pour maîtriser "l’art de se faire obéir" (le don de sagesse ou de science), et du "spirituel"[15] moral ou religieux pour ce qui concerne le "devoir d’obéir" (le Droit canon par exemple pour le catholicisme).
Séparation du sacré ecclésiastique et de la raison républicaine
Il ne s’agit pas alors de consacrer (au sens premier du terme : "rendre sacré ou digne d’admiration et de respect") un pouvoir, en lui donnant une quelconque aura religieuse, mais bien plutôt d’accorder à sa répartition une valeur spirituelle exclusivement consacrée à la raison au service de l’intérêt général, et intimement lié à l’exercice de l’autorité. Bien qu’indéniablement profane, la raison consacrée à la quête permanente de l’intérêt général, mérite ou exige, non pas l’adoration réservée au sacré d’essence divine ou religieuse, mais un respect inconditionnel. C’est la haute valeur de cette répartition des pouvoirs dans le souci de l’intérêt général, dont procède l’exercice légitime de l’autorité, qui donne à la hiérarchie républicaine ce fameux caractère sacré que la raison suffit à insuffler jusqu’à en incarner une sorte d’avatar temporel. Sans cette "sacralisation" de la Raison, et de la répartition des pouvoirs qui en résulte, comme de l’autorité qui en émane, "l’ordre autoritaire" de la hiérarchie républicaine cède le pas à "l'ordre égalitaire" de la persuasion démagogique, et la démocratie sombre dans le chaos.
En donnant à croire qu’elle accorde le pouvoir au peuple, pour mieux le lui reprendre en catimini par la séduction ou la "manipulation de l’opinion", cette démocratie (dêmos kratos) ainsi réduite à la démagogie (dêmos agôgos), s’adresse en effet aux profondeurs inconscientes de l’esprit plutôt qu’à la raison. Elle quitte alors le champ du pouvoir temporel pour s’aventurer sur le terrain du spirituel en ignorant la raison (logos), dont il est nécessaire pourtant de faire valoir le caractère "sacré". Dans les institutions de la République, le logos, parole, raison ou sagesse profane, mérite en effet le plus grand respect, qu’il convient d’ériger à la hauteur de celui qu’inspire le sacré religieux. La Raison me semble ainsi être la seule Valeur digne de se revendiquer républicaine. Je crois en effet profondément, mais ce n’est là qu’une hypothèse n’engageant que moi et méritant sans aucun doute d’être débattue et surtout approfondie, que toutes les autres valeurs morales, aussi hautes soient-elles, ne doivent pas relever du pouvoir temporel de l’État dans la République, mais bien d’un pouvoir spirituel qui gagnerait sans aucun doute à demeurer en dehors du champ d’action de l’État et ne devrait en aucun cas s’immiscer dans l’exercice du pouvoir républicain.
Laïcité et sacralisation de la hiérarchie républicaine
Garantir l’ordre républicain dans le respect du Droit élaboré et imposé par une hiérarchie de la raison, ce n’est pas imposer la domination du pouvoir temporel sur le spirituel, mais garantir leur indépendance mutuelle, en établissant une distinction claire et incontestable entre les deux. Pour être véritablement républicain, le régime doit s’attacher à confier au pouvoir temporel l’ordre autoritaire d’une hiérarchie de la Raison garante de l’ordre public, et laisser au pouvoir spirituel la hiérarchie des Valeurs humaines garantes de l’harmonie sociale que celles-ci soient profanes ou religieuses. La laïcité, c’est la séparation des Églises et de l’État. Mais cette séparation n’implique pas que le second doive s’imposer aux premières, jusqu’à en effacer toute autorité. Ce n’est pas l’État qui doit imposer quoi que ce soit aux Églises, mais bien la République, cette grande Cause publique dont le caractère sacré peut se manifester et pendre toute sa valeur dans le respect de l’intérêt général, qui doit imposer une séparation claire entre les valeurs humaines (ou sociales) à la recherche du Bien commun, dont la responsabilité revient aux Églises, et l’ordre citoyen dans le souci de l’intérêt général, dont la responsabilité revient à l’État chargé d’en assurer le respect.
On peut s’interroger ici, sur le périmètre qu’il faut donner à cette grande Cause incarnée par la recherche permanente de l’intérêt général, en dépassant le cadre désormais trop étriqué de l’État-nation, qui reste malgré tout le seul encore adapté à l’exercice de l’autorité et de la souveraineté, malgré une globalisation impétueuse assez inexorable bien que de plus en plus questionnée. La réponse est peut-être à rechercher chez Montesquieu. "Si je savais quelque chose qui me fût utile et qui fût préjudiciable à ma famille, je la rejetterais de mon esprit ; si je savais quelque chose d'utile à ma famille et qui ne le fût pas à ma patrie, je chercherais à l'oublier ; si je savais quelque chose utile à ma patrie et qui fût préjudiciable à l'Europe, ou bien qui fût utile à l'Europe et préjudiciable au genre humain, je la regarderais comme un crime" (Pensées, n° 741). C’est là, me semble-t-il une première approche de cette hiérarchie des valeurs relevant de la raison républicaine, dont la loi par nature contraignante, doit pouvoir s’inspirer pour régler la vie de la cité et le comportement civique des hommes, sans pour autant se préoccuper de la vie en société et de leur comportement social.
Le mouvement anti-autoritaire de nos démocraties modernes
La révolte anti-autoritaire de mai 68 en France, qui a débouché sur un nouveau conformisme à la fois plus radical et plus insidieux que le précédent, a marqué une étape significative dans la pratique de la propagande politique telle que l’avait élaborée Edward Bernays en Amérique dans les années 20 du même siècle. Goebbels en a ensuite magistralement appliqué les principes en Allemagne dans les années 30 pour promouvoir le national-socialisme, et a ainsi rendu possible la prise du pouvoir par le parti nazi dans ce "cadre idéal à la propagande" offert par la démocratie. La conversion rapide en régime autoritaire de ce pouvoir pourtant acquis démocratiquement par la "fabrique du consentement" et l’utilisation habile du "conformisme des masses", aurait pourtant dû inciter nos révolutionnaires de mai 68 à la prudence quand ils clamaient qu’"il est interdit d’interdire". "Du moins en apparence" auraient-ils pu ajouter s’ils avaient lu Bernays avec attention et réalisé à quel point Goebbels s’en était très largement inspiré. Ceux qui les manipulaient, en tout cas, l’avaient bien lu et s’en sont également largement inspiré, sur le mode plus soft d’une dictature masquée de la pensée unique destinée à pallier la disparition de l’autorité, qui s’est peu à peu imposée, et semble désormais bien installée.
Après la défaite allemande, la traduction en justice des plus hauts responsables du régime nazi devant un tribunal international, a marqué un premier tournant dans l’évolution des conflits entre grandes puissances. Quoi que l’on puisse craindre des visées impérialistes actuelles du président russe, les verdicts prononcés au procès de Nuremberg, qui resteront dans l’Histoire comme les premières condamnations pour crime contre l'humanité, semblent néanmoins avoir donné un léger coup de frein à toute tentation d’expansion impérialiste sur le mode de la conquête guerrière. Plus de quarante ans de guerre froide ont en outre, par la suite, profondément modifié les perspectives d’une aventure militaire associée à une dérive totalitaire à caractère fasciste de la part d’un pays doté de l’arme nucléaire.
Mais malgré ces évolutions historiques, la tentation totalitaire n’a cependant pas disparu, et la fabrique du consentement se cherche, et se trouve peut-être de nouvelles voies encore plus insidieuses que le XXe siècle n’avait sans doute pas soupçonnées. Le chaos dans lequel la fabrique du consentement précipite la démocratie en diabolisant l’autorité au point de l’éradiquer du fonctionnement de la cité comme de la société, crée un vide de pouvoir. La nature ayant horreur du vide, ce pouvoir est désormais à prendre par qui en a la volonté et les moyens. Puisque le droit de la Force brute semble disparaître peu à peu, la force du Droit peut désormais s’imposer, mais le risque est grand alors, de tomber dans l’excès inverse qui consisterait à aller jusqu’à ce que le règne de la loi vienne empiéter sur la souveraineté populaire. C’est malheureusement cet empiètement insidieux qui semble se profiler aujourd’hui à l’horizon du développement de nos démocraties occidentales. Le règne incontesté de la loi semble prendre de plus en plus le pas sur la souveraineté populaire, favorisant ainsi la mise en œuvre d’un gouvernement des juges.
Le gouvernement des juges, dernière dérive de la démocratie
Pour Raymond Aron, la démocratie peut se définir comme un "régime qui tend à maintenir simultanément les libertés individuelles, la souveraineté populaire et le règne de la loi"[16]. Au vu des dérives actuelles de la démocratie, il apparaît utile d’examiner d’un œil critique cette formulation qui fait du "règne de la loi" un des piliers du régime. S’il est d’usage de dire que la loi doit régner, c’est en réalité le peuple souverain qui règne en dictant la loi. Ce raccourci de langage, qui peut sembler bien anodin, se révèle néanmoins source de confusion en gommant la primauté d’un autre pilier, celui de la "souveraineté populaire", qui est à mon sens fondamental. Le "règne de la loi", c'est une formule utilisée en droit, pour désigner l’obligation faite aux gouvernants et aux agents de l’État de se soumettre aux règles de droit posées par la Constitution et d’observer le principe de légalité impliquant que les actes de l'administration et ceux du législateur soient conformes au Droit. C'est donc l'idée toute simple qu'en démocratie le juge chargé de faire appliquer la loi se situe au sommet de la hiérarchie (hierarkhia) des pouvoirs, cette chaîne de commandement (arkhós) sacrée (hieros) distribuant le pouvoir au sein de l'État. Cette idée est, je crois, à l'origine d’une dérive de la démocratie couramment désignée par l'expression "gouvernement des juges" (kritarchie, kritocratie ou dikastocratie) dénonçant un certain activisme judiciaire tendant à décréter une totale autonomie du juge par rapport à l’autorité politique.
La souveraineté de la loi, expression de la volonté du peuple, doit-elle primer sur la souveraineté du peuple ? Autrement dit, la souveraineté populaire doit-elle s’exprimer par la voix du juge et de la loi qu’il applique en l’interprétant, ou bien par la voix de la représentation populaire et de la loi qu’elle fait pour que le juge l’applique ? La question mérite d’être posée, car la réponse me semble être dans son énonciation, même si celle-ci mérite d’être précisée. La souveraineté de la loi est en réalité une formulation tronquée de la souveraineté populaire dont la loi n’est qu’un rouage intermédiaire. Même s’il est reconnu au juge qui l’applique, une liberté d’interprétation qui fait de lui bien plus qu’un simple rouage mécanique, celui-ci demeure néanmoins indéniablement un intermédiaire dans l’exercice de la souveraineté populaire.
Décréter le règne de la loi et la primauté des juges qui ont le pouvoir de la faire appliquer, sur les représentants du peuple qui la dictent, c’est soumettre « la souveraineté nationale » qui "appartient au peuple"[17], au pouvoir des juges qui s’en attribuent l’exercice sans en être responsables devant le peuple. Cela reviendrait, me semble-t-il à violer l’article 3 de notre Constitution stipulant expressément qu’« aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice »[18].
---
[1] Publicitaire américain considéré parfois comme le père de la propagande politique et de l’industrie des "relations publiques".
[2] Edward Bernays, Propaganda : Comment manipuler l'opinion en démocratie, 1928.
[3] Du grec dêmagôgos, démagogue, composé de dêmos, "peuple", et agôgos, "qui guide, qui attire", soit "celui qui conduit le peuple par la séduction".
[4] Du grec dêmokratia, composé de dêmos, "peuple", et krátos, "pouvoir, puissance, force souveraine, domination".
[5] Toute ressemblance avec des faits ou des entités politiques existantes n’est certainement pas fortuite ni le fruit d'une quelconque coïncidence !
[6] Du latin regere "diriger".
[7] Voir aussi FB, De la démocratie en République, Tribune K2 du 16/09/2023, ou à partir de son préambule du (09/08/2023) sur mon blog.
[8] Du latin res publica, littéralement, la "chose publique", traduction latine du grec politeía, la "Cité" ou l'"État" chez Platon, que Cicéron utilise dans le titre de son traité sur la politique De Republica.
[9] Du grec, aristokratikos, et aristocratie, aristokrateia, "gouvernement des meilleurs", composé de aristos, "le meilleur", et de kratos, "pouvoir".
[10] Du latin imperator, "chef, général, empereur", dérivé de imperare, "commander" qui a donné imperium, "pouvoir suprême, empire".
[11] Michel Blay (sous la direction de), Grand dictionnaire de la philosophie, ("Autorité", Laurent Gerbier), Larousse 2003.
[12] Pour conjurer la menace bien improbable d’un retour du monde révolu de l'Ancien Régime, on pourrait utiliser ici le néologisme « méritocratie ». Il serait, certes, plus républicainement correct, mais je préfère la notion d’excellence qui évoque bien l’idée de mettre "les meilleurs aux commandes" (aristokrateia), à celle de mérite qui peut être parfois assimilée à l’idée de prix de consolation.
[13] Du grec monarkhos, composé de de mónos, "seul" et de arkhós, "dirigeant, chef, souverain, celui qui gouverne, qui détient l’autorité ou qui commande", dérivé de arkhein, "commander".
[14] FB, Dissuasion et démocratie au XXIème siècle : l’enjeu improbable de la souveraineté européenne, Tribune K2, déc. 2024
[15] Le "spirituel" est ici utilisé dans son sens "relatif à la vie de l’esprit, en particulier dans ses rapports avec une réalité transcendante" (Dictionnaire de l’Académie française, 9ème édition).
[16] Raymond Aron, L’Homme contre les tyrans, New York, Éditions de la Maison française, 1944.
[17] Constitution de la République française, art. 3 : "La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice…".
[18] Ibid.
20/02/2025