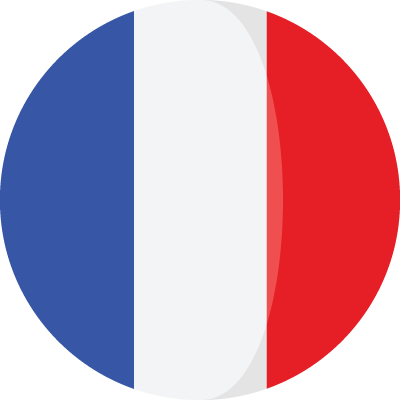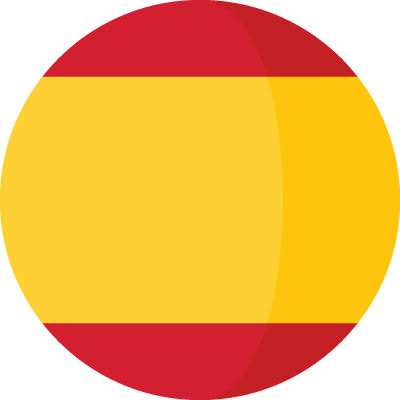[Groupe K2] L'industrie navale française et les perspectives européennes
07/05/2024 - 34 min. de lecture
![[Groupe K2] L'industrie navale française et les perspectives européennes - Cercle K2](https://cercle-k2.fr/storage/5579/conversions/Alain-Bovis-large.jpg)
Cercle K2 neither approves or disapproves of the opinions expressed in the articles. Their authors are exclusively responsible for their content.
Alain Bovis est ingénieur général de l'Armement et président de l'Académie de marine.
L'industrie navale française et les perspectives européennes [1]
La construction de grands navires, par la taille, la complexité et la spécificité des techniques mises en œuvre, a longtemps été considérée comme l’illustration de la capacité industrielle d’un pays. Depuis le milieu du 20e siècle et jusqu’à aujourd’hui, l’une des premières priorités industrielles des pays ravagés par le conflit mondial comme, ultérieurement, des pays dits émergents fut de reconstituer ou de bâtir une industrie de construction navale. Par ailleurs, comme l’ont démontré de façon récurrente de nombreux historiens, de Mahan à Océanides, mais comme le prouve aussi l’actualité en mer de Chine, la force militaire navale a joué et joue encore un rôle majeur dans l’affirmation et l’exercice de puissance des nations.
Richelieu crée, en France, une marine militaire, distincte des flottes commerciales, avec des navires conçus pour le combat. Il établit des bases permanentes en des positions stratégiques pour entretenir les escadres à l’abri des assauts de la mer et de l’ennemi. Colbert organisera les arsenaux en les dotant de chantiers, de main d’œuvre spécialisée et de circuits d’approvisionnement en bois, chanvre et canons. C’est encore le pouvoir royal qui, au 18e siècle, organise la formation scientifique des constructeurs et les dote d’un statut, standardise les règles de construction.
Cependant, à toute époque, le coût de la construction, de l’entretien et des réparations, du renouvellement ou de la reconstruction d’une flotte était considérable, et nécessitait une politique très volontariste fondée sur des choix budgétaires forts et continus sur de longues périodes : “Pour avoir une Marine, il faut la vouloir beaucoup, et surtout la vouloir longtemps”, affirmait le prince de Joinville. Ainsi, les efforts remarquables, qualitatifs comme quantitatifs, engagés en France par les politiques de Colbert et Seigneray, des Choiseul puis du second Empire, n’ont pas survécu aux renversements de priorités, voire à l’hésitation ou à la confusion stratégique qui leurs succédèrent. À l’inverse, depuis le milieu du 17e siècle, l’Angleterre s’est attachée sans interruption à s’assurer une domination commerciale basée sur la supériorité de sa puissance militaire maritime, elle-même dotée du financement nécessaire pour rester toujours la première. L’énoncé de la doctrine des deux puissances à la charnière du 20e siècle a consacré cette stratégie nationale. On a ainsi pu parler d’État “navalo-fiscal”, pour insister sur l’idée que la force navale permettait de soutenir le commerce qui, à son tour, nourrissait une fiscalité qui donnait à l’Angleterre les moyens de ses ambitions.
Les chantiers de constructions militaires sont donc le résultat d’une volonté politique : leur création et leur implantation, leur développement et leur activité dépendent essentiellement de décisions gouvernementales.
De l'arsenal à l'entreprise, une lente évolution
Le modèle de l’arsenal repose sur l’entretien d’infrastructures lourdes (bassins, cales, quais d’armement, ateliers), de savoir-faire techniques, d’une chaîne d’approvisionnement fiable et d’une quantité de main d’œuvre insensibles aux aléas économiques. Cela permet la transmission de compétences sur le long terme, la conduite de programmes à longs cycles et une montée en puissance rapide en cas de mobilisation, mais a pour conséquences, en temps normal, d’entretenir une sous-activité endémique et une faible productivité. En France, depuis Colbert, il est soumis à des règles d’administration publique détachées des impératifs industriels et opérationnels. Ainsi, émargeant directement au budget de l’État, il en suit les règles et les pratiques, notamment le principe de l’annuité. Alors que l’arsenal est fondé sur la stabilité des moyens, son financement suit les fluctuations annuelles du budget qui lui est affecté.
Au début du 20e siècle, entre l’ordre de mise en chantier et l’entrée en service, on construit en France un cuirassé en 5 ans, là où l’Allemagne le construit en 3 ans. À la même période, l’arsenal de Portsmouth en Angleterre construit un dreadnought en 24 mois. Les raisons spécifiques de cette faible efficacité ont été analysées à l’époque : des annuités de dépenses autorisées limitant le rythme des travaux, une priorité donnée au travail manufacturier des arsenaux, afin de les occuper, sur l’approvisionnement de composants à long délai (machines, artillerie), la centralisation des achats soumis à une bureaucratie tatillonne qui ignore les besoins des chantiers, l’incapacité matérielle et procédurale à fournir les plans de définition avant la mise en chantier, les nombreuses et profondes modifications décidées tout au long de la construction par l’intervention incessante des Conseils et Directions, des ministres et du Parlement, des amiraux.
Malgré de nombreuses réformes d’organisation et de procédure, la plupart des obstacles identifiés en 1908 étaient encore en place dans les années 1990. Ainsi, si le compte de commerce des constructions navales, créé en 1968, a autorisé le report de crédits d’une année sur l’autre, l’exécution des travaux restait tributaire d’autorisations d’engagement étalées et délivrées avec parcimonie par le ministère des Finances. Les approvisionnements étaient soumis au Code des Marchés Publics, ensemble de règles interdisant la structuration d’une supply chain stable et collaborative, et, dans la pratique quotidienne, peu compatibles avec une activité industrielle réactive. Malgré les efforts de la DGA pour formaliser le processus de conduite des programmes, une organisation confuse, et parfois lacunaire, entre maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre, entre administration centrale et directions locales limitait la responsabilité des acteurs au respect de l’orthodoxie procédurière. Enfin, les investissements, la recherche, la gestion complexe par corps des ressources humaines, suivaient des logiques budgétaires propres sans réelle corrélation avec une stratégie globale d’entreprise. Culturellement, pour l’ensemble des acteurs, la réalisation du budget et la qualité technique prévalaient sur les délais de réalisation et, par conséquent, sur le coût.
La question du statut d’entreprise des arsenaux de la Marine s’est posée dès 1946, lorsque le ministre communiste de l’Armement, Charles Tillon, propose leur transformation en société nationale, afin de faire participer les arsenaux[2] à la reconstruction de la flotte de commerce. Cette transformation devait "substituer les méthodes de l’industrie privée, du commerce, aux méthodes de gestion défectueuses et périmées des établissements d’État”[3]. Cette réforme, soutenue par la CGT, fut rejetée par l’Assemblée nationale.
En 1963, le ministre des Armées, Pierre Messmer, fait mettre à l’étude la transformation en sociétés nationales des établissements industriels de la Délégation ministérielle pour l’armement (DMA, devenue DGA) créée deux ans plus tôt. Cette réflexion aboutit en 1971 à la transformation des poudreries en Société Nationale des Poudres et Explosifs (SNPE) et à la création du GIAT (Groupement des Industries d’Armement Terrestre) qui sera transformé en 1990 en société nationale : GIAT-Industries. Les établissements de constructions navales restent à l’écart de ces évolutions.
La décennie 1980 a été pour la Direction Technique des Constructions Navales (DTCN) une période de “surchauffe” avec la réalisation de nombreux programmes (SNA, frégates ASM et AA, chasseurs de mines, bâtiments hydrographiques, mise en chantier du porte-avions Charles de Gaulle, études et développement des SNLE de seconde génération, conception des frégates Lafayette, ...). Cette activité a conduit à augmenter les effectifs statutaires, et à étendre l’infrastructure, comme au chantier Laubeuf de Cherbourg, tout en développant dans l’urgence et sans vision stratégique l’utilisation en masse des personnels externes en assistance technique et le recours à la sous-traitance. La fin des années 80 voit se développer la sous-activité sectorielle alors que subsiste un volume important de sous- traitance et d’assistance technique. Des rapports pointent l’inadaptation de l’organisation et fustigent les expédients et les dérèglements qu’elle induit, notamment vis-à-vis de l’usage du Compte de Commerce ou du Code des Marchés Publics.
En 1991, vingt ans après la création du GIAT au sein de la Direction Technique des Armements Terrestres, la Direction des Constructions Navales propose et commence à mettre en œuvre une séparation entre activités industrielles et activités de maîtrise d’ouvrage. Cette séparation, préalable indispensable à toute évolution du statut des activités industrielles, conduit à la création de nouvelles interfaces internes et d’organisations miroirs. Elle s’effectue pourtant dans un contexte de réduction des effectifs, s’accélérant dans la deuxième moitié de la décennie, par mesures d’âge et départs volontaires, accroissant encore l’inadaptation des compétences aux emplois.
En 1995, un groupe de travail réuni autour du Délégué Général pour l’Armement à la demande du ministre, Charles Millon, établit un diagnostic sans complaisance sur la situation de la DCN. Mais il considère, au vu notamment des difficultés rencontrées par GIAT Industries, que la partie industrielle est encore insuffisamment préparée pour un changement de statut profond et immédiat, notamment du point de vue :
- des effectifs, trop importants par rapport aux commandes prévisibles ;
- de la gestion comptable et de l’identification des coûts ;
- de la maîtrise et de la qualité de ses processus ;
- des modes de management.
Une étape intermédiaire est ainsi décidée en 1997 avec la sortie de la DCN de la dépendance hiérarchique de la DGA et la mise en place d’une contractualisation, un plan drastique de réduction des effectifs soutenu par les dispositifs d’accompagnement FORMOB[4], la mise en place d’un nouveau système de gestion compatible avec le Plan Comptable Général des entreprises, le renforcement de la démarche de certification ISO 9000. Ces évolutions sont conduites dans un climat social tendu, et, paradoxalement, avec la volonté d’un retour à la stricte orthodoxie administrative, notamment dans le domaine des achats[5]... Les établissements, dans lesquels la production des programmes en cours doit malgré tout se poursuivre, approcheront la paralysie à la fin des années 90.
Face à ces difficultés qui font craindre l’impossibilité de former une société viable, un plan d’évolution est préparé par le nouveau ministre de la Défense, Alain Richard, et par la direction du Trésor. Ce plan prévoit la création d’une société d’ingénierie et de maîtrise d’œuvre, partiellement détenue par l’État et dotée de différentes filiales par activités, elles-mêmes ouvertes à d’autres actionnaires industriels. Deux éléments prennent progressivement corps : la société SSDN (Société de Systèmes de Défense Navals, devenue par la suite Armaris SA), co-entreprise de maîtrise d’œuvre d’ensemble détenue par l’État et par Thalès, et la SEP (Société Énergie-Propulsion) entre l’État et Areva devant recueillir l’Établissement d’Indret de la DCN et la société Technicatome. En parallèle, la DCN est transformée en Service à Compétence Nationale DCN, entité administrative autonome susceptible de servir à terme de structure d’accueil pour les actifs ne pouvant être intégrés dans le plan de transformation.
Cependant, en 2001, devant l’urgence – et les nécessités sociales –, le gouvernement se résout à une transformation de la totalité de DCN qui devient société anonyme au 1er juin 2003. La co-entreprise Armaris est néanmoins créée en août 2002, dédiée au commerce et à la maîtrise d’œuvre des programmes d’exportation (par apport partiel de DCN International), afin de créer un partenariat structurant entre la nouvelle société à capitaux publics et la société Thalès.
Tirant les leçons des difficultés rencontrées par GIAT-Industries, l’État s’est donné le temps et les moyens d’assurer un démarrage de la nouvelle société DCNS SA dans de bonnes conditions tant sociales que financières. Dans une situation bilancielle totalement assainie, un effectif limité à moins de 12 000 salariés (contre plus de 22 000 en 1995), la nouvelle société se verra dotée rapidement de commandes structurantes et dégagera un résultat positif dès les premiers exercices. Le changement de statut est parachevé en 2007 par l’absorption de la filiale Armaris, le projet de SEP ayant été abandonné, en contrepartie de la cession de 25% (portés à 35% en 2011) du capital de DCN, devenue à cette occasion DCNS, à Thales SA.
Naval Group est aujourd’hui une entreprise industrielle capable de concevoir et construire toute la gamme de navires militaires. Trente-troisième au classement mondial des entreprises de défense, elle est le premier constructeur naval militaire de l’Union Européenne. Avec un modèle équilibré entre constructions neuves et maintenance, navires de surface et sous-marins, elle bénéficie d’un budget de R&T représentant de l’ordre de 4% de son chiffre d’affaires (hors développements des programmes), dont une part importante consacrée à des projets collaboratifs.
Industrie nationale, la construction de navires de guerre s’est organisée depuis des siècles autour d’infrastructures, bassins de radoub et quais d’armement, situés dans des lieux choisis pour leurs caractéristiques hydrologiques et leur défense naturelle. Les arsenaux ont été pendant des siècles les moteurs d’activité des régions d’implantation, tandis que s’organisait une chaîne d’approvisionnement (bois, chanvre, puis acier, appareils propulsifs, appareils auxiliaires, armement, senseurs) essentiellement nationale. Au fil du temps, les établissements industriels de construction, à présent séparés physiquement des bases navales, se sont spécialisés : sous-marins à Cherbourg, frégates et bâtiments de petits et moyen tonnage à Lorient, tandis que la construction de grands bâtiments, porte-aéronefs et logistiques, autrefois à Brest est désormais attribuée au Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire. Les petits bâtiments, patrouilleurs, bâtiments de service public, chasseurs de mines sont confiés à divers chantiers privés et à une filiale spécialisée de Naval Group et du chantier Piriou, Kership. La spécialisation donne une meilleure productivité à l’outil industriel, mais rend plus critique la continuité de charge des installations et des personnels, pouvant donner lieu à des transferts de charge ou des “prêts” de personnels entre établissements. La chaîne d’approvisionnement s’est diversifiée, avec parfois le risque de prise de contrôle étrangère sur certains systèmes critiques (turbines à vapeur et diesels de sous-marins, par exemple).
Une industrie comme les autres ?
Les effets du changement de statut s’observèrent très rapidement sur l’activité de maintien en condition opérationnelle de la flotte par l’augmentation significative de la disponibilité des navires, la nouvelle société adoptant rapidement des pratiques industrielles beaucoup plus réactives en termes d’achats comme de mobilisation des ressources humaines. Si donc l’objectif du changement de statut était d’améliorer la productivité, mesurable sur cette activité récurrente, l’objectif a été rapidement atteint.
La France a ainsi abandonné, plusieurs années après ses voisins européens, le modèle d’arsenal pour donner à ses constructions navales un statut d’industrie de droit commun. Cette industrie conserve cependant des traits très spécifiques qui expliquent, entre autres, l’impossibilité de construire une industrie navale européenne intégrée, à l’exemple de l’aéronautique civile, des missiles, ou, dans une certaine mesure, de l’électronique de défense.
Le marché des constructions navales militaires est un non-marché, au sens où il est constitué d’une part de besoins nationaux touchant à la souveraineté, d’autre part de commandes étrangères entrant dans le cadre très contraint des exportations d’armement.
La vocation première de l’entreprise est de satisfaire les besoins de la Marine nationale. On est là, comme dans la majorité des pays maritimes, dans la situation d’un monopole bilatéral entre un seul acheteur public et un fournisseur unique (du moins pour les navires de premier rang). Les commandes sont guidées par les politiques de défense et budgétaire nationales. Les Livres blancs et lois de programmations permettent de donner une certaine visibilité pluriannuelle à ces politiques, et les contrats, fermes ou conditionnels, avec clauses de dédit, pénalités, bonifications, donnent à l’industriel la possibilité d’organiser et d’adapter ses moyens. Le risque budgétaire est donc porté par l’État et les conséquences des aléas budgétaires sont contractuellement financées par l’État-client. La multiplication par trois du prix d’achat unitaire des frégates FREMM[6], initialement calculé sur une série de 17 réduite progressivement à 8, illustre cet état de fait.
Une part du risque industriel est également portée par l’État ; c’est le cas dans les formules de régie (le “cost+fee” des anglo-saxons) ou encore lorsque la pérennité d’une activité industrielle stratégique est en jeu (la propulsion nucléaire, par exemple). De par leur montant et leur espacement, tous les programmes sont économiquement critiques pour l’industriel, aussi chaque difficulté majeure (incertitudes liées à l’innovation, insuffisance des ressources, non-qualité, accidents de production) incluse d’ordinaire dans les risques de l’industriel fait l’objet de négociations et de transactions avec la maîtrise d’ouvrage. Il se crée ainsi de fortes obligations réciproques, l’État client, mais aussi actionnaire, se devant d’intégrer la stratégie industrielle dans l’expression de ses besoins militaires. Le financement de la recherche, amont – Recherche et Technologie – ou liée au développement des programmes, est un des principaux moyens et des principales responsabilités de l’État pour orienter la stratégie industrielle de l’entreprise.
Le recours à l’exportation a pu être considéré, par l’État comme par l’industriel, comme un moyen d’atténuer les contraintes d’une relation exclusive. Les commandes à l’exportation apportent un complément d’activité permettant de réduire les effets cycliques des programmes nationaux et absorbent une part significative des coûts de structure. Elles confrontent l’industriel à une concurrence exigeante en termes de compétitivité économique et technologique. Toutefois, l’exportation reste étroitement tributaire de l’État, non seulement par le mécanisme d’autorisation, mais également par la caution politique et l’assistance de diverses natures que l’État vendeur doit apporter à l’État client. Dans de nombreux cas, à l’exemple du système des Foreign military sales américain, les marchés se concluent sous couvert d’accords inter-gouvernementaux. De façon plus ou moins explicite, les États sont amenés à orienter leurs programmes nationaux en fonction de la demande à l’exportation.
La voie de la diversification a également été recherchée, au moins depuis la Libération, comme activité de complément du plan de charge des arsenaux. Après le désastre financier de la commande des plateformes de forage SEDCO, en 1997, la société nationalisée DCN s’est lancée dans les années 2000 dans le nucléaire civil (constructions d’équipements pour centrales civiles) et les énergies marines renouvelables (éolienne, hydrolienne, thermique). Bien que faisant appel à des technologies proches de celles de la construction navale, ces marchés suivent des logiques économiques et commerciales très différentes. Elles nécessitent une organisation commerciale, d’études et de production dédiée et adaptée qui apporte ainsi peu de charge aux moyens dédiés aux programmes militaires, qui restent prioritaires. Ces organisations spécifiques ont commencé à être mises en place à DCNS à partir de 2009, jusqu’à l’abandon de ces activités (vente de la filiale Naval Énergie en 2021), après l’accumulation de nombreuses pertes et l’absence de réelles perspectives commerciales.
Lors de la crise de la construction navale civile européenne des années 1990, due en particulier à la disparition des aides d’État, beaucoup de pays ont vu dans le rapprochement entre constructions civiles et militaires un moyen de subventionner les constructions civiles par le biais des commandes militaires. Ces dernières étant de leur côté confrontées à la baisse des budgets de défense, le schéma n’a pu survivre et, hors Fincantieri, la séparation des activités civiles et militaires est aujourd’hui la situation dominante en Europe. Ainsi, l’espagnol Izar, né en 2000 de la fusion du chantier militaire Bazan et du chantier civil Astilleros, a été démantelé sur injonction de la Commission Européenne en 2005 par séparation de la branche militaire devenue Navantia.
Longtemps opposés par la perspective d’une fusion forcée, Naval Group et les Chantiers de l’Atlantique, aujourd’hui deux sociétés nationales, ont fortement accru leur coopération industrielle dans le cadre d’une spécialisation qui suit une logique industrielle : grands bâtiments, souvent faisant usage de normes civiles, à Saint-Nazaire, bâtiments de combat à Naval Group, porte-avions aux Chantiers de l’Atlantique sous maîtrise d’œuvre de Naval Group, intégration des systèmes de combat à Naval Group.
L'exportation
L’exportation de navires de guerre remonte à la fin du 19e siècle. Jusqu’aux années 1980, la construction et la vente des navires destinés aux marines étrangères étaient principalement confiées à l’industrie privée. Dans les années 1990, cette activité a été vue comme un moyen d’atténuer les effets de la chute des commandes nationales dans les arsenaux, qui ont cherché à la reprendre. Mais l’accession au marché international nécessitait la mise en œuvre de moyens commerciaux que le statut de la Direction des Constructions Navales lui interdisait. Il a donc été créé transitoirement un véhicule commercial sous forme d’une société nationale de droit commun, DCN International. Cependant, les conditions économiques et financières de plusieurs contrats pris à perte dans ce cadre ont fait l’objet de nombreuses critiques. Le rôle commercial de DCN International a été repris en 2002 par une co-entreprise entre l’État et Thalès, Armaris, jusqu’en 2007, date à laquelle la société DCNS a repris le contrôle de sa fonction commerciale. Alors qu’à sa création, la société DCN SA visait un ratio de 50% de son activité à l’export, celui-ci est resté stable, entre 30 et 35%, depuis 30 ans.
Le marché des navires de guerre est pour la France, comme pour ses principaux alliés et concurrents, un marché relevant de l’autonomie stratégique nationale en matière de défense comme de politique étrangère. Une alliance transnationale structurante nécessiterait un alignement durable des intérêts militaires, économiques et internationaux des partenaires, ce qui explique les difficultés, jusque-là insurmontées, de telles alliances. Ces difficultés n’interdisent pas a priori les coopérations de circonstance sur certains programmes, mais le bilan de telles coopérations mérite d’être analysé.
L’exportation de navires de guerre est un acte de politique étrangère dont elle subit les aléas. La vente de deux Bâtiments de Projection et de Commandement a été conclue avec la Russie en 2010 dans le cadre d’un accord entre les deux ministères de la Défense. Alors que les deux navires sont en cours d’achèvement à Saint-Nazaire, leur livraison est annulée et le contrat rompu en août 2015 à la suite de l’invasion de la Crimée par la Russie. Les navires sont revendus à l’Égypte et livrés en 2016. L’annulation brutale et sans préavis du contrat de sous-marins pour l’Australie montre une fois de plus la fragilité des alliances.
Mais l’exportation de navires militaires revêt également, pour la part accessible dans le cadre d’accords internationaux, les caractéristiques d’une activité commerciale classique dans un contexte de forte concurrence. Les industriels européens qui ont dominé le marché international des navires de guerre jusqu’au début des années 2000, sont aujourd’hui confrontés à la concurrence montante de nouveaux acteurs : Chine, Corée du Sud, Turquie, États-Unis.
Compte tenu de la multiplicité de fournisseurs face à des appels d’offres dont seul un petit nombre se conclut chaque année par un contrat, le marché est du type marché de demande, où chaque client impose des caractéristiques spécifiques qu’il souhaite néanmoins éprouvées en service. L’existence, dans la gamme des programmes nationaux du vendeur, de navires proches du besoin exprimé est donc un atout, de même que l’offre de technologies différenciantes. Elle permet aussi de limiter les coûts de développement à la charge de l’acheteur. Les conditions financières (prix, prêts, garanties...) sont également essentielles, de même que le montant et la nature des compensations accordées.
Depuis le début des années 2000, le modèle économique a sensiblement évolué, passant de la vente de navires armés au transfert de technologie, imposant à l’industriel vendeur une présence locale accrue, d’abord sous forme d’équipes d’assistance technique puis avec la création de filiales locales d’approvisionnement, enfin avec l’implantation de chantiers complets.
Cette évolution implique deux conséquences majeures : le transfert de savoir-faire de plus en plus haut dans la chaîne de valeur (maintenance, puis construction, enfin R&D et conception-intégration), et l’augmentation de la prise de responsabilités et de risques du vendeur dans le pays client. Elle conduit à une transformation du modèle d’industrie nationale exportatrice en entreprise multidomestique, avec la perspective de sécuriser des marchés régionaux mais aussi le risque de multiplier des capacités industrielles dont la viabilité à terme n’est pas assurée. La rationalisation industrielle de ces filiales pousse à la mutualisation de leurs approvisionnements, voire à terme leur spécialisation à l’échelle globale du groupe industriel. Ces implantations industrielles doivent également s’inscrire dans une stratégie de coopération politique à long terme et forment donc un obstacle aux rapprochements structurels entre constructeurs navals européens de nationalités différentes.
Les coopérations européennes : une suite d'expériences au bilan mitigé
Plusieurs projets de coopération dans le domaine des systèmes navals ont été engagés depuis une quarantaine d’années. Le programme de chasseurs de mines tripartite (France-Belgique, Pays-Bas) a abouti dans les années 1980 à la construction à Lorient de 35 navires au profit des trois nations coopérantes. Avec sa maîtrise d’œuvre unique et sa chaîne de production en série, ce programme a été considéré comme un succès de coopération. Lancé à la même période, le projet de frégate de l’OTAN NFR-90 devait assurer le remplacement des frégates de six nations d’Europe de l’ouest, du Canada et des États-Unis. Les exigences divergentes des différents partenaires ont conduit à l’abandon du projet en 1990. La France, le Royaume-Uni et l’Italie se sont alors engagés dans le projet Horizon CNGF (Common New Generation Frigate) en 1993. Sous couvert d’un Trilateral Frigate Agreement, l’Espagne, les Pays-Pas et l’Allemagne s’engagent de leur côté en 1992 dans trois programmes nationaux : F100 Alavaro de Bazan (exportée en différentes versions en Norvège et Australie), LCF De Zeven Provinciën et F124 Sachsen, sur la base d’armements américains. Bien que restant partenaire du programme de système d’armes antiaérien principal PAAMS, le Royaume-Uni se retire en 1999 du programme Horizon, au profit d’un projet national de destroyer T45. Horizon s’est poursuivi entre la France et l’Italie. “Pour que les retombées industrielles soient les mêmes des deux côtés des Alpes, il avait été procédé à un partage strictement égalitaire des tâches. Cette organisation extrêmement complexe a finalement pesé sur les coûts et sur les délais, au point que le programme n’a pas été mené à son terme et que seulement deux bâtiments pour la France et deux pour l’Italie ont été construits”[7]. Le coût pour la France en aura été de 2160 millions d’euros (2009), hors système PAAMS[8].
Le ministère de la Défense français lance en 2002 les études d’une nouvelle frégate multi-mission (FMM), programme auquel se joint l’Italie en 2003. Confié à Armaris et Orrizzonte (co-entreprise entre Fincantieri et Finmeccanica) sous contrôle de l’OCCAR, le programme devenu FREMM (frégate européenne multi-mission) ambitionne avec 27 navires projetés entre France (17) et Italie (10) d’attirer d’autres partenaires et constituer la base d’une flotte européenne homogène. Dès 2005, le programme montre de nombreuses divergences entre les exigences françaises et italiennes. Finalement, le programme aboutira à des maîtrises d’œuvre séparées, les achats communs et le partage d’études portant sur moins de 10% du coût total du programme : “Le programme FREMM aurait sans aucun doute pu être mené à bien dans un cadre franco-français, avec des conséquences nulles en termes de délai et infinitésimales en termes de coût”[9]. Aujourd’hui, alors que la série de navires pour la France a été réduite à 8 exemplaires au profit d’un nouveau projet national de Frégate de Défense et d’Intervention, les FREMM françaises et italiennes se font concurrence à l’exportation (Indonésie, Égypte, Grèce).
Dans le cadre du projet de reprise des Chantiers de l’Atlantique par Fincantieri (projet finalement abandonné en janvier 2021) la France décide en 2019 de commander une série de quatre Bâtiments Ravitailleurs de Force : c’est le type Vulcano de Fincantieri qui est choisi contre le projet Brave de Naval Group, et les navires seront construits par parties à Saint-Nazaire et en Italie. La commande en est passée par l’OCCAR mais la maîtrise d’œuvre est confiée à un GME Chantiers de l’Atlantique/Naval Group; l’évolution des projets français et italien conduit à des navires sensiblement différents (déplacements respectifs de 31 000 tpc et de 23 500 tpc).
En 1990, la DCN et la société italienne Whitehead Alenia Sistemi Subacquei (WASS) sont confrontées à des difficultés dans le développement de leurs programmes de torpilles aéroportées Murène et A 290. Les deux programmes sont fusionnés en 1991 et deviennent la torpille MU-90 confiée à un GEIE Eurotorp entre DCN, WASS et Thalès. Le programme est un succès et plus de 1000 torpilles MU-90 sont vendues dans le monde. En 2008, les trois partenaires souhaitent prolonger leur coopération avec le développement d’une nouvelle torpille lourde, Black Shark, dérivée de la torpille italienne A 184, et envisagent de créer une société commune de plein exercice. La France estima néanmoins devoir conserver la capacité autonome de développement de cette torpille, armement principal des sous-marins nucléaires et des sous-marins d’exportation, et décida du développement national de la torpille F 21.
Des discussions engagées en 1991 entre la France et le Royaume-Uni sur une possible coopération sur les futures générations de sous-marins nucléaires d’attaque échouèrent rapidement en raison des liens historiques sur la propulsion nucléaire entre le Royaume-Uni et les États-Unis. En 2002, les deux pays amorcent des discussions sur la participation de la France au programme britannique CVF pour l’acquisition en commun de trois porte-avions à propulsion conventionnelle, deux pour le Royaume-Uni et un pour la France, aboutissant en 2006 à la signature d’un Mémorandum. Ce Mémorandum, qui ne pouvait satisfaire les exigences opérationnelles, techniques et industrielles françaises se réduisait, selon la Cour des Comptes, à “un achat sur étagère par la France au Royaume- Uni de certaines études”[10], pour lequel 200 millions d’euros ont été versés au Royaume-Uni. Le gouvernement britannique, s’appuyant sur ce programme pour réorganiser ses chantiers navals, a exclu de fait tout partage industriel avec la France. La coopération a pris fin en 2008 avec la mise en chantier du premier porte-avions britannique. La France développera seule dans la prochaine décennie un nouveau porte-avions à propulsion nucléaire.
Dès la fin des années 1980, la DCN amorce un rapprochement avec le chantier espagnol Bazan (devenu Navantia) pour le remplacement des sous-marins de type Agosta en service dans l’Armada. Il est alors proposé la co-conception d’un sous-marin océanique de classe 2000 t sur la base d’un concept de sous-marin présenté par la DCN. L’Armada tardant à définir son besoin, le développement du projet, dénommé Scorpène, se poursuit néanmoins en coopération entre les deux industriels et une première commande est prise au Chili par le consortium en 1997, puis une seconde en Malaisie en 2001, les quatre navires étant construits par moitiés dans les chantiers de Cherbourg et de Carthagène. En 2003, l’Espagne décide finalement de développer seule un sous-marin national S-80, se tournant vers les États-Unis pour son système de combat, et affiche son ambition de proposer ce nouveau navire à l’exportation, en concurrence avec le Scorpène. Cette décision scellera la fin de la coopération, Naval Group assurant désormais seul la commercialisation et la vente des sous-marins de la famille Scorpene (Inde, Brésil). Ayant rencontré plusieurs difficultés techniques lors de la conception du S-80, l’Espagne a demandé une intervention accrue de l’industrie américaine dans le programme.
Soumise à une compétition frontale à l’exportation de sous-marins, la France a recherché à plusieurs reprises un rapprochement avec l’industrie allemande, notamment lors de la revente en 2005 du chantier HDW par le fonds de pension américain OEP, puis encore lors de la mise en vente de l’électronicien Atlas Elektronik. Dans les deux cas, le gouvernement allemand, opposé aux offres françaises, a choisi une solution nationale : rachat par Thyssen pour le premier pour former l’entreprise TKMS, rachat par TKMS et Airbus DE dans le second cas. En 1999, le chantier HDW a racheté le constructeur suédois Kockums, ce qui mit instantanément fin à de discrètes discussions entamées par Kockums avec la DCN. Le rachat défensif de Kockums par HDW a résulté en l’élimination du marché export de Kockums qui a finalement été repris en 2014 par le suédois SAAB.
Des perspectives encore incertaines
Trois projets de coopération navale européenne impliquant la France se poursuivent aujourd’hui, d’une part, dans le domaine de la guerre des mines, une coopération franco-britannique et un contrat obtenu par Naval Group de la Belgique et des Pays-Bas, d’autre part une alliance industrielle entre Naval Group et Fincantieri dans le domaine des navires de combat de surface.
Thales est un fournisseur et intégrateur de systèmes reconnu mondialement dans le domaine de la guerre des mines. Lancé en 2012 entre la France et le Royaume-Uni, le programme MMCM (Maritime Mine Counter-Measures) s’appuie sur un nouveau concept de chasse aux mines à base d’engins télépilotés de surface et sous-marins. Ce programme a abouti à un contrat d’études notifié par l’OCCAR à un consortium Thalès/BAe Systems en 2015 et à la commande en 2021 des premiers systèmes pour les deux marines. Exclu ou marginalisé du consortium franco-britannique créé en 2015, deux acteurs français majeurs du domaine, Naval Group et ECA, ont fait en 2019, contre l’avis du ministère des Armées et en concurrence avec Thalès, une offre victorieuse pour le programme belgo-néerlandais MCM, également sur la base d’engins inhabités, s’engageant à implanter en Belgique leurs centres d’excellence en la matière. La compétition et le jeu des alliances aboutissent ainsi à une dispersion des compétences nationales.
S’appuyant sur leur long historique de programmes en coopération, Naval Group et Fincantieri ont envisagé dès 2015 un rapprochement plus structurel. Le gouvernement français ayant refusé en 2018 un échange de participations entre les deux sociétés, celles-ci créent en 2019 une filiale commune, Naviris, destinée à porter les futurs programmes binationaux, à combiner les efforts des deux groupes à l’exportation des navires de surface, et à mener conjointement des programmes de R&D. L’entreprise a démarré en janvier 2020 avec plusieurs commandes : étude de la refonte à mi-vie des frégates Horizon, conduite du projet d’European Patrol Corvette, financé par le Fonds Européen de Défense, et a reçu en juin 2020 un contrat des deux nations notifié par l’OCCAR pour la conduite de cinq études amont. Toutefois, de nombreuses tensions commerciales sont apparues depuis 2019 entre Naval Group et Fincantieri, les deux entreprises se retrouvant en compétition sur plusieurs prospects, situation que la co-entreprise était destinée à éviter. Cette coopération qui n’est pas une alliance de complémentarités, les deux entreprises proposant des navires comparables, ne tirera de bénéfice, si elle est poursuivie, que d’une rationalisation des offres et des moyens industriels. Cette rationalisation obligerait chaque pays à des abandons de compétences et de moyens industriels. Par ailleurs, Fincantieri dont la filiale américaine Marinette Marine, constructeur des Littoral Combat Ships de type Freedom et qui vient de remporter la compétition pour la réalisation du programme FFG(X), se positionne en pivot de la consolidation européenne en renforçant son partenariat avec l’allemand TKMS sur le projet de sous-marins U212 NFS.
Une autre alliance “nordique” se dessine entre Allemagne et Pays-Bas. À la suite des nombreuses difficultés rencontrées par le fournisseur national TKMS sur les programmes de frégates F125 et de corvettes K130, le gouvernement allemand a sélectionné en 2020 un consortium mené par le constructeur néerlandais Damen pour le prochain programme de frégates multi-missions MKS 180. Ce programme, dont Damen s’est engagé à réaliser une part majeure en Allemagne, pourrait être l’occasion d’une restructuration, cherchée depuis plusieurs années, des chantiers navals allemands. Un autre programme qui peut s’avérer structurant pour l’industrie européenne a été lancé par l’appel d’offre des Pays-Bas pour la fourniture de quatre nouveaux sous-marins. Ce projet voit s’affronter trois concurrents : Naval Group associé au néerlandais Royal IHI, Damen associé au suédois SAAB et TKMS. Une victoire de TKMS consacrerait de facto la prédominance de la technologie allemande dans les flottes sous-marines non-nucléaires européennes. Une victoire de Damen/SAAB ou de Naval Group, créerait à l’inverse sur ce marché une deuxième source d’approvisionnement. La victoire de Damen/SAAB lancerait pour sa part un nouveau compétiteur européen sur les marchés asiatiques et sud-américains où Naval Group et TKMS affrontent de plus en plus durement les concurrents sud-coréens et chinois.
Les conditions d'un renforcement des coopérations européennes
Deux types de consolidation navale européenne peuvent être envisagés, l’un d’initiative gouvernementale à partir de coopérations bi- ou multinationales autour de programmes communs à plusieurs marines, d’autre part une coopération d’initiative industrielle, impliquant la création de structures capitalistiques communes et visant, particulièrement, l’exportation sur le marché mondial.
Les nombreuses expériences passées permettent de concevoir les conditions de succès des coopérations pour la réalisation et la bonne fin des programmes, mais également pour encourager à l’établissement d’organisations pérennes. Ces conditions ont été identifiées par la Cour des Comptes dans un rapport de 2018[11].
Les économies budgétaires sont généralement annoncées comme argument principal des programmes en coopération. Dans beaucoup de cas, d’ailleurs, ceux-ci sont décidés pour “sanctuariser” des programmes nationaux dont le financement n’est pas assuré. De fait, le cumul des exigences des différentes marines partenaires peut conduire à un surcoût et un rallongement des délais de programmes qu’il aurait été plus rationnel d’optimiser et réaliser sur la base des seuls besoins nationaux. La réalisation de variantes nationales, réalisées dans le cadre d’un programme intégré conduit au même résultat, car complexifiant toute la chaîne d’études et de fabrication tout en faisant perdre une part non négligeable des gains de série. L’alternative est la juxtaposition de programmes nationaux comme dans le cas des FREMM, mais la coopération n’est plus alors que de façade.
Un partage industriel équitable entre les partenaires (juste retour des engagements financiers) est depuis l’origine mis en avant dans les coopérations européennes. Cependant, cette règle, plutôt que de chercher à faire profiter le programme des domaines d’excellence de chaque nation et de leurs complémentarités, est souvent conçue comme un moyen de développer de nouvelles capacités industrielles nationales, fussent-elles redondantes avec celles d’autres partenaires, l’objectif implicite de chaque gouvernement étant de gagner en emplois et en compétences stratégiques. La règle étant recherchée à tous les niveaux de la chaîne de valeur, la coopération aboutit à une dissémination des capacités industrielles, là où la logique économique attendrait une rationalisation. Le partage des tâches inhérent à la coopération amène la France qui aurait la capacité industrielle de réaliser seule les programmes, à être confrontée au problème du maintien des compétences nécessaires au développement des équipements stratégiques majeurs (sous-marins nucléaires, porte-avions).
Créée en 2004, l’Agence Européenne de Défense (AED) est un organisme inter-gouvernemental destiné à définir les besoins capacitaires européens et à conduire des programmes communs de R&D. Les 27 membres n’ayant pas réussi à s’accorder sur son rôle et son financement, l’AED ne s’est vu confier aucun programme depuis sa création. En 2017, la Commission Européenne a proposé la création d’un Fonds Européen de Défense (FED), doté en avril 2021 d’un budget de 7,9 milliards d’euros pour la période 2021-2027 (0,6% des budgets de défense des pays de l’Union), destiné à soutenir la recherche et le développement de technologies et équipements communs. L’objectif est de favoriser l’émergence de technologies européennes et réduire la dépendance vis-à-vis de pays hors Union (États-Unis notamment). Cette dépendance est aujourd’hui faible dans le domaine naval (hors missiles, domaine où il existe pourtant un champion européen). La coopération européenne de recherche a aussi pour but, de manière générale, de disséminer les compétences scientifiques et technologiques entre les différents membres de l’Union, objectif qui peut s’opposer au renforcement de pôles industriels d’excellence. En tout état de cause, l’avenir du FED comporte encore de nombreuses incertitudes sur sa gouvernance, ses budgets futurs et la participation inévitable de nations hors Union (dont le Royaume- Uni).
Le principal facteur d’échec – ou de non-réussite – des programmes en coopération est la divergence des besoins militaires, souvent évolutifs tout au long des programmes. Cette divergence est inévitable tant les modèles de marines sont différents entre pays. Même dans le cas du projet d’European Patrol Corvette, navire de second rang d’usage général, il existe au moins trois versions nationales différentes.
Une définition, bien en amont, de besoins capacitaires communs, le recours à une maîtrise d’ouvrage réellement décisionnaire et d’une maîtrise d’œuvre unique, l’organisation d’une chaîne d’approvisionnement sur la base de champions d’excellence ainsi confortés sur le marché international, sont les conditions essentielles pour fortifier la coopération navale. De tels principes conduiraient inéluctablement l’industrie, par simple logique économique, à s’organiser de façon transnationale. Ces conditions restent soumises à la volonté politique des États sur le long terme de construire une politique de défense intégrée. Envisageable entre quelques nations dont les efforts de défense sont comparables, une telle politique risquerait néanmoins de pousser les nations européennes qui en seraient exclues à rechercher hors d’Europe d’autres types de coopération.
Les rapprochements structurels entre constructeurs navals européens majeurs sont aujourd’hui exclus pour des raisons de souveraineté nationale, tant en matière de défense que d’influence internationale et de réalisme économique, bien que la vision d’un “Airbus naval” soit périodiquement évoquée. Habituellement, les entreprises fusionnent afin de bénéficier de leviers comme les effets de série en production, l’amortissement des coûts de développement, la rationalisation des moyens ou la conquête de nouveaux marchés... Ces leviers naturels ne jouent pas pour l’industrie navale, chaque nation étant soucieuse de préserver l’indépendance d’une industrie qui fabrique des outils de souveraineté.
Plusieurs types de coopération industrielle ont été expérimentés : achats en commun d’équipements ou achats croisés, alliance commerciale sur un segment donné, en général sous forme de “partage du monde”, coopération sur certains programmes de recherche amont. Ces différentes tentatives sont restées limitées et la volonté des partenaires, soutenus par leurs États, de retrouver une autonomie technique ou commerciale finit par en venir à bout.
La concentration des constructeurs européens est donc largement dépendante de la volonté politique des États, et de leur acceptation du partage d’outils de souveraineté. Quel État est prêt à se résoudre à ce partage de façon irréversible ? La solution intermédiaire peut résider dans la constitution d’entreprises multidomestiques, permettant une large rationalisation des moyens d’études et de production entre leurs différentes implantations, tout en maintenant dans un cadre national certaines activités stratégiques. De tels groupes qui existent dans le domaine des missiles ou des sonars, par exemple, se dessinent dans les navires : italo-américain pour Fincantieri, projet avorté franco-australien pour Naval Group, mais, pour l’instant, au-delà des frontières européennes.
On ne créera le secteur naval de défense européen que s’il y a volonté politique de partage de souveraineté. Dans un article du 27 aout 2021[12], le Commissaire européen Thierry Breton évoque l’“Europe-puissance” et la nécessité de se diriger vers une Défense commune. C’est un langage nouveau au sein de la Commission, qui est loin aujourd’hui d’avoir l’assentiment des 27 nations-membres. Il en évoque les trois conditions : un plan capacitaire commun, découlant d’une politique européenne de sécurité et de défense, dans un cadre institutionnel adapté. L’organisation des industries européennes de défense, notamment dans le secteur naval, en serait la conséquence naturelle, mais ne peut être conçue comme précédant l’union politique.
S'il est besoin d'une conclusion ...
L’annulation du contrat de sous-marins pour l’Australie, illustre parfaitement qu’en termes d’exportations comme de coopérations les enjeux stratégiques nationaux prévalent sur les contrats, quelle qu’en soit la force, et sur les affirmations d’amitiés d’un moment.
L’enjeu pour la France, au-delà de ce contrat, était l’affirmation de sa présence et de son rôle dans la zone indopacifique devenue le centre des confrontations géostratégiques. Cet enjeu devrait, comme la lutte anti-terroriste au Sahel, être partagé par l’Europe. La route est longue.
[1] Cet article a été publié au sein de La Vigie (https://www.lettrevigie.com/la-lettre), hors-série “Marine”, novembre 2022.
[2] Les arsenaux étaient alors soumis à la jurisprudence issue de la loi d’Allarde de 1791, leur interdisant l’accès aux marchés civils.
[3] Charles Tillon, Discussion du budget du ministère de l’Armement à l’Assemblée nationale constituante, 4 avril 1946.
[4] Plan Formation-Mobilité d’accompagnement aux restructurations d’établissements pour les fonctionnaires et ouvriers d’État : primes de départ volontaire, reclassement au sein des bases militaires. Ce plan a été mis en place avec la professionnalisation des armées.
[5] Au point que la Cour des Comptes se verra obligée de préciser en 2001 : “Le droit doit être au service d’une volonté de réforme, et non l’inverse”.
[6] Cf. https://www.ifrap.org/etat-et-collectivites/limmense-gachis-des-fregates-francaises.
[7] Audition de Patrick Boissier, PDG de DCNS, par la Commission des finances de l’Assemblée nationale, 13 mars 2013.
[8] Rapport du Sénat n°150, Projet de loi de finance pour 2013 : http://www.senat.fr/rap/a12-150-8/a12-150-8.html.
[9] Audition de Patrick Boissier, déjà cité.
[10] Cour des Comptes, Rapport public annuel 2014, tome I, volume 1, février 2014. Disponible en ligne à l’adresse : https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/RPA_2014_Tome_I_vol_1_1.pdf.
[11] Cour des Comptes, La coopération européenne en matière d’armement, avril 2018. Disponible en ligne : https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-04/20180417-rapport-cooperation-europeenne-armement.pdf.
[12] Article disponible en ligne : https://www.linkedin.com/pulse/afghanistan-la-d%25C3%25A9fense-com-mune- europ%25C3%25A9enne-nest-plus-une-breton/?trackingId=5vVqctFYTAKlNkixGSHY7w%3D%3D.
07/05/2024