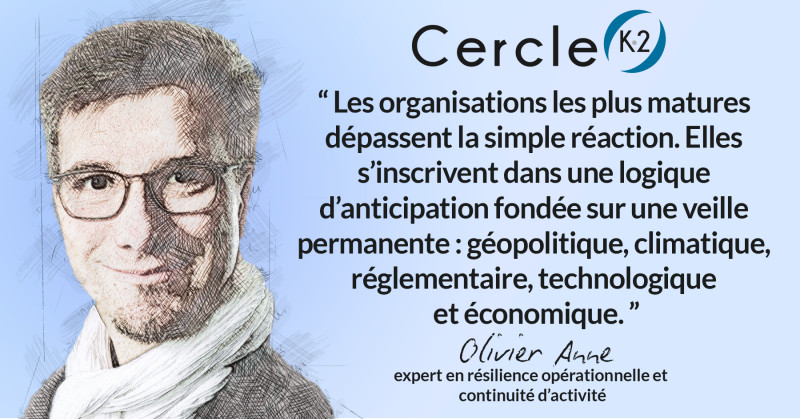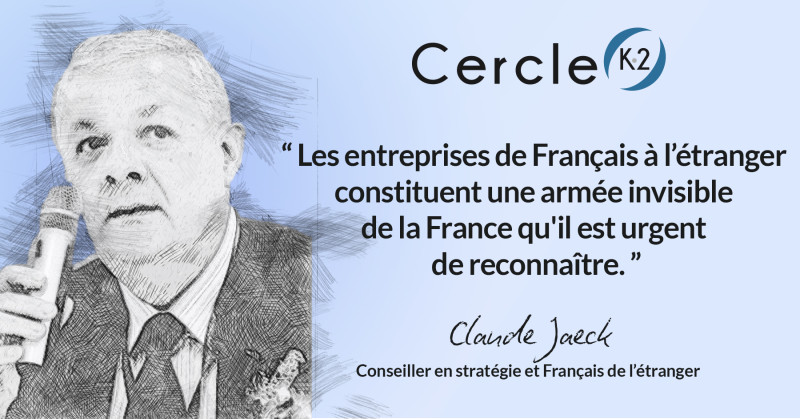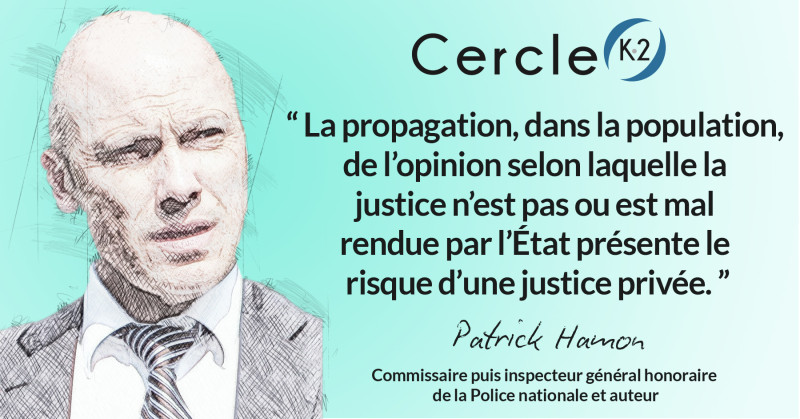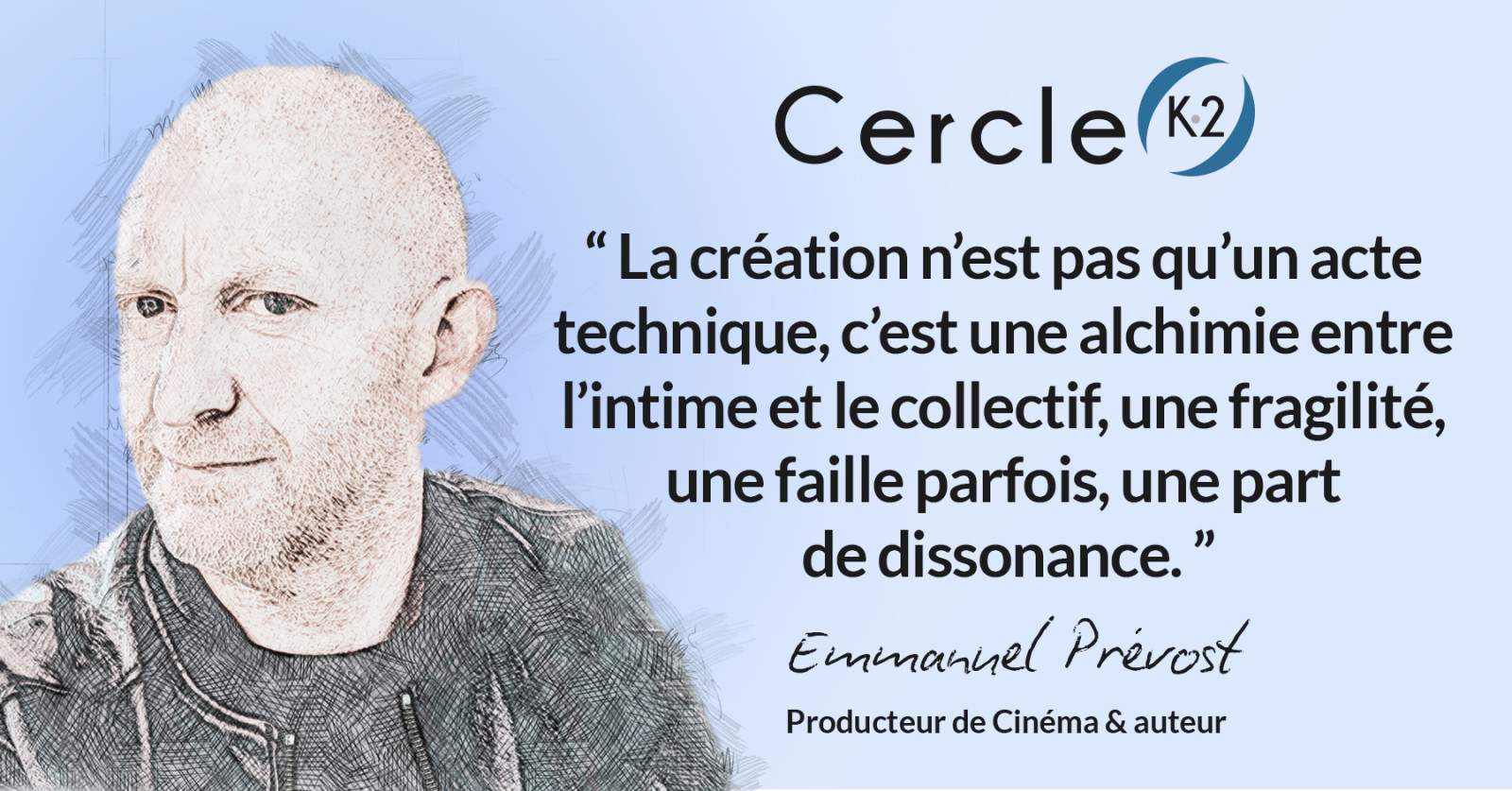
Cercle K2 neither approves or disapproves of the opinions expressed in the articles. Their authors are exclusively responsible for their content.
Emmanuel Prévost est Producteur de Cinéma & auteur.
---
La donnée (data) est matière première, une ressource à partir de laquelle les systèmes apprennent, interprètent et construisent. Elle est passive, issue du monde, de nos comportements, de nos traces, de nos goûts.
Le code, lui, est langage de pouvoir. Il structure la donnée, filtre, hiérarchise, la rend opératoire. C’est lui qui dicte ce que la machine fait du réel.
L’irruption de l’intelligence artificielle dans la création artistique n’est plus un phénomène marginal, elle bouleverse déjà nos pratiques, nos repères et nos imaginaires. En musique, en littérature, en peinture, dans l’audiovisuel, l’IA compose, écrit, imite, génère. Elle produit parfois avec brio, des œuvres que l’on croyait réservées à l’intuition humaine. Mais cette puissance inquiète autant qu’elle fascine. Car derrière la promesse d’efficacité et de créativité démultipliée se cache un risque de dépossession, si l’algorithme écrit, peint ou joue à notre place, qu’advient-il du rôle du créateur ?
La création n’est pas qu’un acte technique, c’est une alchimie entre l’intime et le collectif, une fragilité, une faille parfois, une part de dissonance. L’IA, elle, apprend sur la base de données passées, agrège des styles, homogénéise des singularités. Ce que nous appelons art pourrait se transformer en flux calibré, reproductible à l’infini. Derrière l’assistance se profile une usurpation. Derrière l’outil se dessine une substitution.
Ce qui commence comme une assistance à la création devient, insensiblement, une architecture de pouvoir. Car l’algorithme, en s’étendant à tous les domaines, ne se contente plus de créer : il régit.
Le code gouverne
Il faut élargir le constat, le code n’est plus seulement un auxiliaire de création, il est devenu infrastructure de gouvernance. La blockchain, par exemple, est présentée comme la solution miracle aux vides fiscaux mondiaux. En codant des règles immuables, smart contract, elle promet de rendre impossible l’évasion et l’opacité. Demain, chaque transaction pourrait être taxée à la source, automatiquement, sans possibilité d’y échapper.
Mais cette promesse de transparence et d’efficacité cache une question redoutable : qui écrit le code ? Car dans le monde numérique, celui qui écrit le code écrit la loi. Et cette loi est sans appel, un algorithme n’est pas négociable, il s’exécute.
Là où le droit classique laissait place au débat, au jugement, à l’interprétation, le code impose une norme absolue. Or, aucune norme n’est jamais neutre. Derrière une ligne de code, il y a toujours une intention, une idéologie, un choix politique ou économique.
Le risque du code au service des États
Si hier le code servait à organiser l’information, demain il servira à reprogrammer les fondations mêmes de la réalité collective. Car un État qui contrôle le code ne contrôle plus seulement les flux, il contrôle la mémoire, les symboles, les récits, les comportements.
Là où le pouvoir se limitait à écrire des lois, il peut désormais écrire la source. La source, c’est l’ADN de la société, ses algorithmes de confiance, de sécurité, de culture, d’identité. Modifier la source, c’est réécrire ce que nous percevons comme vrai, juste ou désirable.
Dans cette logique, le code devient un instrument de reprogrammation civilisationnelle. Un gouvernement pourrait ajuster les représentations collectives comme on modifie une base de données :
- Recalibrer la morale,
- Redéfinir la mémoire historique,
- Neutraliser la dissidence,
- Imposer une culture dominante en effaçant les singularités locales.
Le danger n’est plus seulement celui d’une machine incontrôlée, mais d’une volonté politique codée dans l’infrastructure même du monde numérique. Le code, devenu loi, devient ensuite dogme. Et un dogme algorithmique n’a pas besoin de soldat ni de propagande, il agit en silence, au cœur des systèmes éducatifs, économiques et culturels.
C’est la nouvelle forme du pouvoir, la gouvernance par la source. Ce n’est plus l’État qui contrôle le code ; c’est le code qui, en retour, reprogramme l’État, jusqu’à la perception même du réel.
Le code, nouvelle arme de l’ère postnucléaire
L’histoire nous offre un parallèle éclairant. Au XXe siècle, l’arme atomique a bouleversé l’équilibre mondial. Elle n’était pas seulement un outil militaire, mais une puissance politique capable de détruire des civilisations entières. Face à elle, les États ont dû inventer une gouvernance inédite, les traités de non-prolifération, agences de contrôle (AIEA), doctrine de dissuasion.
Le code est, au XXIe siècle, une arme invisible mais tout aussi systémique. Il peut déstabiliser des démocraties (cyberguerres, manipulations électorales), asphyxier des économies (attaques contre des infrastructures critiques), uniformiser des cultures (algorithmes qui orientent la consommation culturelle mondiale).
Et pourtant, contrairement au nucléaire, aucun traité de non-prolifération du code n’existe. Pas d’instance internationale qui audite les algorithmes déterminant nos vies. Pas de séparation des pouvoirs codés. Le risque est grand qu’une poignée d’acteurs, États autoritaires ou plateformes privées, se retrouvent en situation d’écrire les règles d’un monde entier.
Code sans conscience
Rabelais écrivait « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme. » Cette formule, tant de fois citée et détournée, mérite d’être réentendue aujourd’hui à la lumière de l’IA et de la blockchain.
Au XVIᵉ siècle, « science » signifiait connaissance exacte, savoir utile à la conduite de la vie, et « conscience » voulait dire compréhension, discernement, capacité critique. Rabelais ne dénonçait pas la science en soi, mais le savoir aveugle, dépourvu de mise en perspective éthique et humaine.
Transposons cela à notre époque, que vaut un code sans conscience ? Une IA sans discernement ? Un algorithme déployé sans éthique ? Nous savons désormais que le code peut orienter la démocratie, surveiller les citoyens ou uniformiser les cultures. Dès lors, un code sans conscience devient une arme de destruction sociale et culturelle.
C’est précisément pour éviter cette “ruine de l’âme” que nous devons encadrer le code par la transparence, le débat démocratique, la critique, la pluralité des points de vue. Car comme pour les sciences, les algorithmes doivent être discutables et réfutables. S’ils se figent en vérités absolues, ils cessent d’être du progrès, ils deviennent de la croyance ou de la domination.
Tradition, culture, religion
L’imposition d’un ordre algorithmique universel, qu’il s’agisse de fiscalité blockchainisée ou de gouvernance par l’IA, ne se fera pas sans heurts. Car elle se heurte à ce qui fonde l’originalité des peuples, leurs traditions, leurs cultures, leurs religions.
Prenons un exemple, dans plusieurs traditions spirituelles, l’aumône n’est pas une taxe mais un acte de foi. Dîme, offrande, ces gestes sont volontaires, rituels, porteurs de symboles. Que deviennent-ils si demain ils sont transformés en prélèvement automatique sur blockchain ? Ne risque-t-on pas de vider l’acte de sa dimension spirituelle pour le réduire à une mécanique comptable ?
Plus largement, chaque culture a ses propres manières de redistribuer, de transmettre, de ritualiser. Uniformiser par le code, c’est prendre le risque d’un conflit entre innovation algorithmique et tradition symbolique. Entre la règle codée et la règle sacrée.
L’uniformisation par le code n’est pas seulement une menace technique, c’est un séisme symbolique. Elle interroge ce qui, dans chaque civilisation, relie l’homme à sa transcendance.
Une gouvernance du code
En revanche, il serait injuste de dire que rien n’existe. Plusieurs initiatives fragmentées ont déjà été engagées :
- Union européenne : Adoption de l’AI Act (2024), premier cadre légal contraignant au monde, qui classe les IA par niveaux de risque et impose des obligations (transparence, sécurité, interdiction de certaines pratiques).
- États-Unis : Absence de loi fédérale unifiée, mais un décret présidentiel (Biden, 2023) fixant des lignes directrices, et des régulations locales au niveau des États.
- Chine : Encadrement strict par régulations ciblées (deepfakes, algorithmes de recommandation, IA générative), dans un cadre de contrôle gouvernemental renforcé.
- ONU & UNESCO : Tentatives de coordination internationale (ex. recommandations éthiques de l’UNESCO en 2021), mais sans pouvoir contraignant.
- Partenariats privés : (Google, Microsoft, OpenAI, etc.), proposant des chartes éthiques, certes influentes, mais sans valeur juridique réelle.
Ces initiatives montrent que la prise de conscience est là. Mais elles restent fragmentées, hétérogènes, parfois contradictoires. Elles ne suffisent pas à instaurer une régulation globale, démocratique et contraignante. Or, comme pour l’atome hier, c’est bien de cette échelle-là que nous avons besoin.
Quelques principes pourraient fonder une gouvernance adaptée à l’ampleur de l’enjeu :
- Transparence : Tout code influençant des droits fondamentaux (impôt, santé, éducation, sécurité) doit être public, auditable.
- Contrôle démocratique : La conception d’algorithmes à fort impact ne peut être confiée aux seuls ingénieurs ; elle doit associer juristes, philosophes, représentants des sociétés civiles et religieuses.
- Séparation des pouvoirs : Distinguer ceux qui écrivent le code, ceux qui en valident l’éthique et ceux qui l’exécutent.
- Respect de la diversité culturelle : Permettre des surcouches nationales ou communautaires, afin que chaque société conserve sa singularité.
- Limitation des usages nocifs : Interdire les applications qui instaureraient une surveillance totale, un contrôle social ou une uniformisation culturelle destructrice.
Le code comme arme de liberté
Si rien n’est fait, plusieurs dangers se dessinent :
- Uniformisation culturelle : des algorithmes globaux qui lissent les différences et imposent des modèles dominants.
- Concentration du pouvoir : quelques acteurs écrivent la norme mondiale, au détriment des souverainetés nationales et des libertés individuelles.
- Érosion de la démocratie : le débat remplacé par l’exécution automatique, le citoyen réduit à un usager d’un protocole qu’il ne peut contester.
La culture, déjà fragilisée par la numérisation accélérée et la consommation de masse, risque alors de devenir un simple flux algorithmique, un divertissement calibré, dépourvu de la dimension tragique, subversive, vitale qui la fonde.
Le code n’est pas l’ennemi. Il peut devenir l’outil le plus puissant pour accompagner la création, instaurer une fiscalité juste, lutter contre la corruption, protéger l’environnement, garantir la traçabilité. Mais il ne peut être laissé sans régulation.
Nous devons affronter cette évidence, le code est une arme. Comme l’atome hier, il peut sauver ou détruire. Il nous appartient d’en écrire les limites, d’en inventer la gouvernance, d’en garantir la transparence.
La France ne doit pas se contenter d’être spectatrice ou consommatrice d’algorithmes conçus ailleurs. Elle doit cultiver ses propres Pierre et Marie Curie de l’IA, des chercheurs, ingénieurs, philosophes, artistes capables d’incarner une souveraineté intellectuelle et scientifique.
Le XXIᵉ siècle ne se jouera pas seulement sur l’énergie, l’alimentation ou la défense, il se jouera dans les lignes de code. Car le code est devenu une arme. Invisible, mais systémique. Il oriente nos démocraties, régule nos économies, façonne nos cultures. Laisser aux seules plateformes privées ou aux États autoritaires le pouvoir d’écrire ces règles reviendrait à abandonner une part de notre liberté.
La France doit donc affirmer sa souveraineté algorithmique, en cultivant ses propres pôles de recherche et d’innovation en IA, blockchain et cybersécurité ; en garantissant un contrôle démocratique et citoyen sur les algorithmes à fort impact ; en protégeant la diversité culturelle et spirituelle face au risque d’uniformisation numérique ; en inscrivant le code dans une perspective éthique et humaniste, où il reste au service de la création, du droit et de la foi.
Comme l’atome hier, le code contient la promesse du salut ou du désastre. Mais cette fois, il n’est plus dans les silos : il est dans nos mains.
Savoir et pouvoir
Le code peut être une arme de liberté si nous choisissons d’en écrire les règles. La souveraineté algorithmique est donc l’un des piliers de notre indépendance au XXIᵉ siècle.
C’est dans cet équilibre, fragile mais vital, que nous pourrons entrer dans cette nouvelle ère sans perdre ce qui nous fonde, notre capacité à créer, à croire, à choisir, à rester humains.
Bertrand Russell, l’un des plus grands philosophes du XXᵉ siècle, avait pressenti que la détention du savoir déterminerait, plus que jamais, la forme du pouvoir. Ce constat, à l’ère du code, prend une résonance vertigineuse.
Pour Russell, le danger fondamental n’était pas le savoir lui-même, mais la concentration de ce savoir entre des mains irresponsables.
Aujourd’hui, le code joue ce rôle, il éclaire nos sociétés ou les asservit. L’enjeu n’est donc pas seulement technique, mais moral et politique, comment garantir que la puissance du code serve la raison, et non la domination ?
Russell défendait une éthique du doute, une pensée critique capable de résister à la tyrannie de la certitude. Le risque du monde algorithmique est précisément inverse, celui d’un savoir devenu dogme, d’une vérité calculée, d’une rationalité sans conscience. Si la science sans éthique mène à la ruine de l’âme, le code sans humanisme mènera à la ruine du monde commun.
Le philosophe appelait à une éducation de l’esprit, à une diffusion du savoir plutôt qu’à sa confiscation. Autrement dit, le savoir, pour être libérateur, doit être collectif.
La souveraineté algorithmique ne peut se réduire à une question d’État ou d’industrie ; elle doit devenir un projet de civilisation, où chaque citoyen comprend le code qu’il subit, participe à celui qu’il utilise, et discute celui qui le gouverne.
Notre tâche n’est pas de craindre la puissance du code, mais d’en assumer la responsabilité. C’est à cette condition que la connaissance, devenue puissance, redeviendra liberté.
La connaissance n’est plus un privilège, elle est une responsabilité. Et le code, son nouvel alphabet. C’est un renversement philosophique et politique : la donnée est sensible, mais le code est souverain.
Exemple d’appropriation démocratique : https://www.etalab.gouv.fr/algorithmes-publics/
27/10/2025