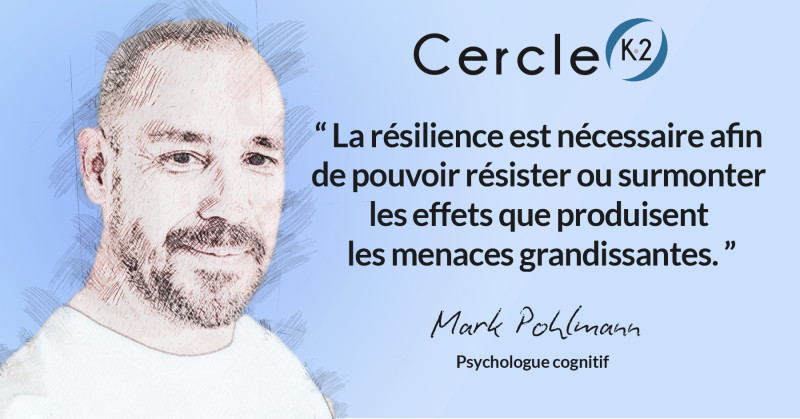Cercle K2 neither approves or disapproves of the opinions expressed in the articles. Their authors are exclusively responsible for their content.
Mathieu Guidère est Professeur des Universités, Directeur de Recherches à l’INSERM.
---
L’anxiété géopolitique n’est pas une émotion fugace ni un trouble réservé à quelques spécialistes du renseignement. Elle est devenue un climat collectif, une expérience diffuse et persistante qui traverse les sociétés contemporaines. Elle s’alimente des tensions internationales, des conflits ouverts ou larvés, de la visibilité permanente des crises et de l’impression d’un monde en déséquilibre permanent. Ce n’est plus seulement une affaire de chancelleries, de militaires ou de diplomates ; c’est un ressenti partagé par des millions de citoyens qui vivent, parfois sans en avoir conscience, les secousses de la scène mondiale jusque dans leur quotidien.
L’expression désigne donc une modalité particulière de l’angoisse collective. Elle prend racine dans le champ géopolitique mais déborde largement sur les dimensions psychologiques, sociales et culturelles. Elle traduit la manière dont les bouleversements internationaux sont intériorisés par les personnes et transformés en états d’alerte, de vigilance et parfois de paralysie. Comprendre ce phénomène, c’est saisir à quel point la géopolitique n’est pas seulement un jeu d’intérêts abstraits, mais un facteur structurant de nos émotions et de nos comportements.
Genèse du concept
L’anxiété géopolitique émerge progressivement après la fin de la guerre froide. La bipolarité entre les États-Unis et l’Union soviétique avait instauré un ordre clair, certes menaçant par le spectre nucléaire, mais relativement prévisible. Avec l’effondrement de ce cadre, les incertitudes se sont multipliées : la mondialisation économique, la montée des puissances régionales, les guerres asymétriques et les menaces transnationales ont inauguré une ère où les repères se brouillent.
Les attentats du 11 septembre 2001 ont marqué un tournant. Le sentiment de sécurité dans les grandes puissances occidentales a été profondément ébranlé, et la menace terroriste s’est installée dans la conscience collective comme une présence invisible. La crise financière de 2008, puis l’émergence des rivalités entre la Chine et les États-Unis, l’annexion de la Crimée en 2014, la pandémie de 2020 et enfin la guerre en Ukraine en 2022, ont amplifié ce climat anxiogène. Chaque crise semble ajouter une strate supplémentaire d’incertitude, rendant plus dense et plus persistante l’expérience de l’anxiété géopolitique.
Une époque sous tension
La multiplication des foyers d’instabilité est au cœur du phénomène. Il ne s’agit plus seulement de conflits localisés dans des zones périphériques, mais de tensions qui résonnent à l’échelle planétaire. La Syrie, le Sahel, le Yémen, le Haut-Karabakh, Taïwan, la mer de Chine méridionale ou encore la frontière russo-ukrainienne forment une mosaïque de menaces interconnectées.
La disparition des distances psychiques est une donnée nouvelle : les chaînes d’information en continu, les réseaux sociaux, les images instantanées des bombardements, des réfugiés ou des destructions abolissent l’éloignement. Ce qui se passe à Gaza ou à Kharkiv est vécu presque en temps réel par un spectateur à Paris, Montréal ou Dakar. L’espace géopolitique est devenu un espace mental immédiatement accessible et donc émotionnellement surchargé.
Inquiétude, stress, anxiété
Il importe de distinguer plusieurs registres. L’inquiétude est ponctuelle, le stress est lié à une pression spécifique, mais l’anxiété désigne un état diffus et persistant. Dans le cas géopolitique, il ne s’agit pas d’une peur précise d’un événement défini, mais d’une appréhension globale face à un avenir perçu comme incertain et menaçant. Cette anxiété se nourrit du sentiment que les repères traditionnels de stabilité se délitent.
Ainsi, l’angoisse n’a plus de frontières ; elle se diffuse dans les opinions publiques au-delà des clivages nationaux : les migrations, les cyberattaques, les épidémies, le climat ou le nucléaire sont autant de phénomènes qui dépassent les lignes de démarcation étatiques et qui nourrissent un sentiment d’impuissance partagé.
La réception des crises internationales passe par des mécanismes de projection et d’identification. Ainsi, l’image d’une ville bombardée suscite de la compassion mais aussi une projection anxieuse : et si cela arrivait ici, chez nous ? Les menaces systémiques comme le climat ou les cyberattaques fonctionnent sur un mode différent : elles suscitent une vigilance permanente sans possibilité de clôture. Cette absence de résolution est un facteur aggravant de l’anxiété géopolitique.
Les neurosciences et les sciences cognitives montrent que l’incertitude chronique est l’un des contextes les plus anxiogènes. Or la scène internationale contemporaine est dominée par l’imprévisibilité, l’instabilité et la volatilité des alliances.
Les États, censés garantir la sécurité, apparaissent parfois ambivalents. Leur puissance est contestée, leur capacité d’action limitée face à des menaces diffuses. Les acteurs non étatiques, qu’ils soient terroristes, hackers ou groupes armés transnationaux, amplifient ce sentiment. Les entreprises technologiques ou les plateformes médiatiques sont devenues elles-mêmes des acteurs anxiogènes, car elles contrôlent une partie des flux d’information et donc de la perception collective.
Anatomie de l’anxiété géopolitique
Les manifestations psychiques de l’anxiété géopolitique sont multiples. Certains adoptent une vigilance accrue, d’autres un désengagement total pour se protéger. On observe ainsi une typologie des réactions : hypervigilance, recherche compulsive d’information, discours catastrophistes, mais aussi déni de la réalité ou retrait apathique.
L’excès d’informations contradictoires entraîne confusion et désorientation, accentuant l’angoisse. La tribalisation politique se nourrit de cette anxiété, en transformant la peur en identité collective : beaucoup se regroupent autour d’une interprétation simplifiée et dichotomique du monde qui divise entre « nous » et « eux ».
Le sentiment de déclassement géopolitique, notamment en France et au-delà en Europe, participe de cette dynamique. L’impression que notre pays ou notre union ne maîtrise plus son destin stratégique nourrit une inquiétude identitaire et politique.
La géopolitique vécue comme traumatisme
Certains événements agissent comme traumatismes collectifs. La guerre en Ukraine a généré en Europe une anxiété mêlant solidarité, peur de l’escalade et sentiment d’impuissance. Le conflit au Proche-Orient agit comme un miroir douloureux, particulièrement pour les diasporas, prises dans un dilemme entre attachement affectif et confrontation à la violence. Le terrorisme, quant à lui, reste un déclencheur d’angoisse immédiate et brutale, dont l’effet se prolonge bien au-delà des attaques elles-mêmes.
La montée en puissance de la Chine suscite une autre forme d’anxiété : la peur d’un basculement du centre de gravité mondial, vécue comme une perte de repères historiques. Cette crainte est moins spectaculaire que le terrorisme mais plus profonde et plus durable, car elle touche à l’imaginaire collectif des grandes puissances.
Les jeunes générations expriment une forme spécifique d’anxiété géopolitique, souvent mêlée à l’éco-anxiété. Le sentiment que leur avenir est compromis par des crises qu’elles ne contrôlent pas crée une détresse silencieuse, parfois traduite en radicalisation politique ou en paralysie face à l’action.
Les réponses culturelles varient : certains groupes valorisent le repli nationaliste, d’autres prônent des formes de solidarité transnationale. Les récits de peur circulent avec une puissance accrue grâce aux réseaux sociaux, renforçant l’idée que chaque personne est exposée à l’échelle globale.
Vivre avec l’anxiété géopolitique
La réflexion sur la santé mentale dans les relations internationales révèle la dimension psychique de la mondialisation. De ce fait, l’anxiété géopolitique ne peut être éradiquée : elle est inhérente à l’interconnexion du monde contemporain. Elle témoigne de notre vulnérabilité collective face aux forces qui dépassent le cadre national. Elle est une mémoire résistante, car chaque crise laisse une empreinte qui alimente la suivante. Elle est aussi une vigilance lucide, car elle rappelle l’importance d’anticiper, de comprendre et d’agir.
Mais elle peut devenir un moteur d’engagement existentiel si elle est assumée plutôt que subie. L’enjeu n’est pas de supprimer l’anxiété, mais de la transformer en conscience partagée, en responsabilité et en créativité politique. Il s’agit plutôt de développer des capacités d’adaptation : la flexibilité psychologique consiste à accepter l’incertitude plutôt que de chercher à la contrôler. La défusion cognitive permet de ne pas se laisser piéger par le flux continu de représentations alarmistes. La clarification des valeurs, le lien social, le soutien mutuel et l’action civique sont autant de leviers pour transformer l’angoisse paralysante en énergie constructive.
Les individus peuvent travailler à leur propre équilibre émotionnel, mais les institutions doivent aussi mettre en place des politiques de résilience, qu’il s’agisse d’éducation aux médias, de préparation aux crises ou de diplomatie préventive.
Penser l’anxiété géopolitique, c’est donc réfléchir à l’impact des relations internationales sur notre santé mentale c’est-à-dire sur notre manière d’habiter un monde instable sans nous y perdre.
24/09/2025