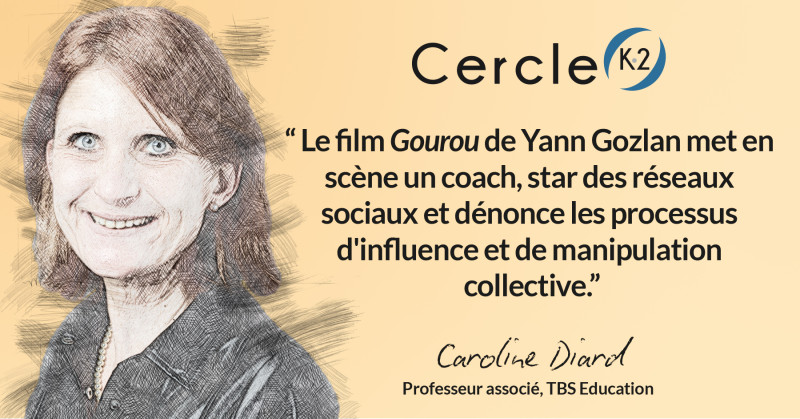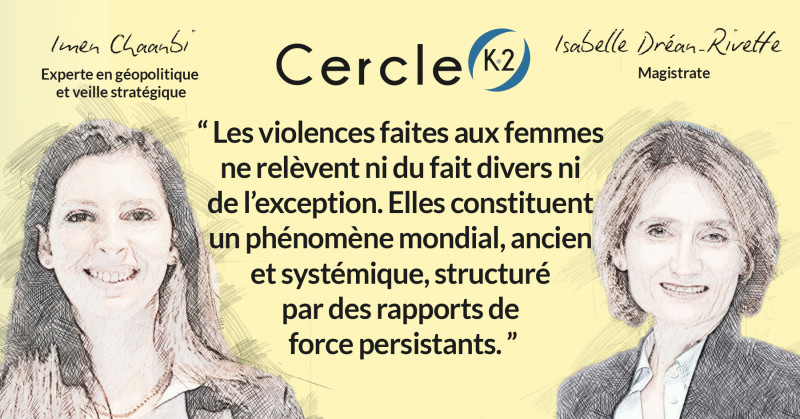Commissions d’enquête parlementaires : Savoir tirer profit du game changer institutionnel
08/07/2025 - 5 min. de lecture
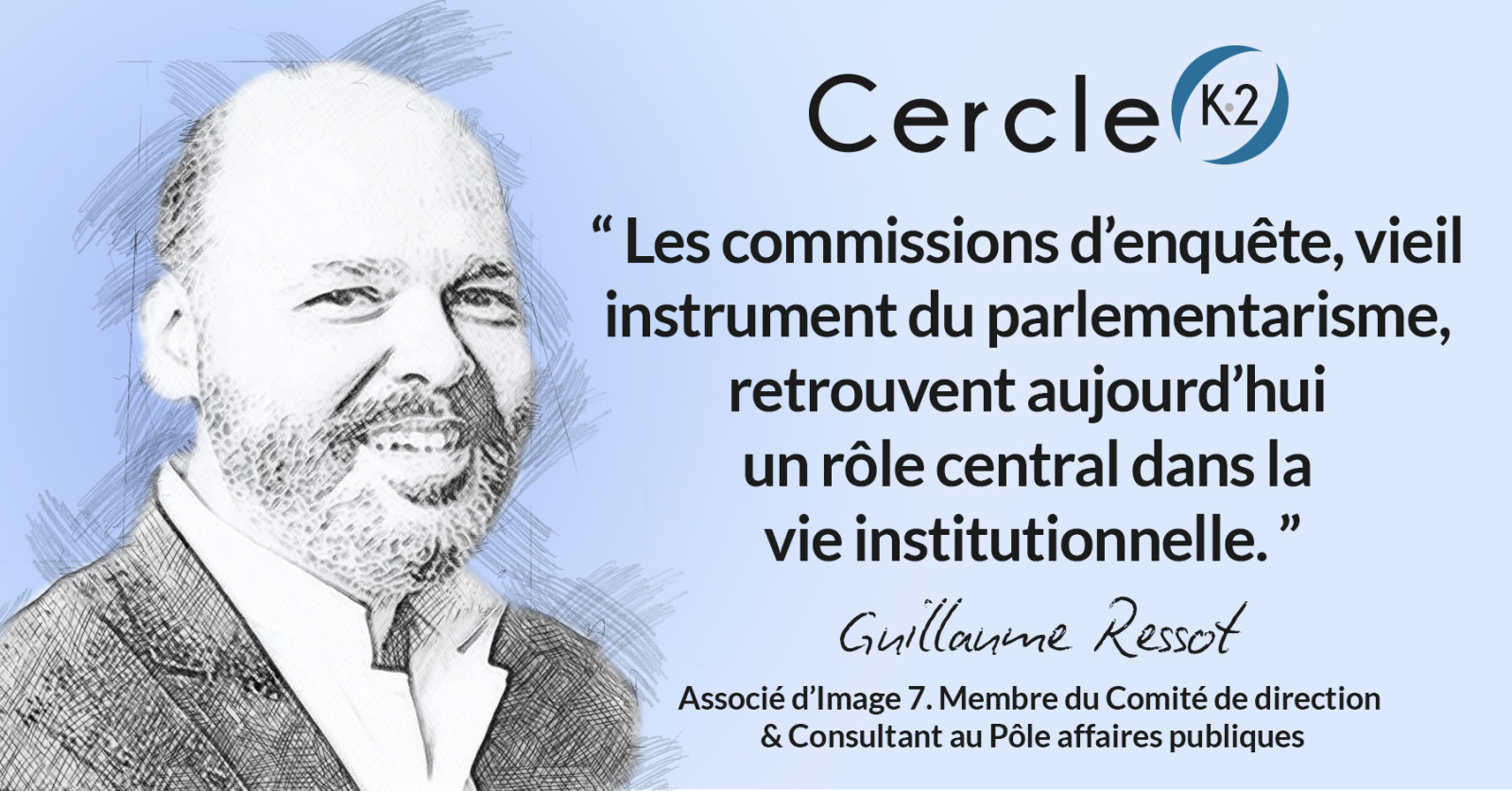
Le Cercle K2 n'entend donner ni approbation ni improbation aux opinions émises dans les publications (écrites et vidéos) qui restent propres à leur auteur.
Guillaume Ressot est Associé d’Image 7, membre du Comité de direction & Consultant au Pôle affaires publiques.
---
Les commissions d’enquête, vieil instrument du parlementarisme, retrouvent aujourd’hui un rôle central dans la vie institutionnelle. En maîtrisant le combo presse-internet-réseaux sociaux en appui de leurs travaux, les parlementaires donnent désormais le maximum de résonance à leurs auditions et à leurs propositions. Ces commissions d’enquête qui renouvellent le genre bouleversent aussi progressivement le mode d’interaction avec le monde politique.
En recrudescence depuis 2024, elles passent désormais au crible tous les champs du sociétal, de l’économique et du social. Elles constituent souvent un préalable aux propositions de loi, concurrençant au passage les traditionnelles concertations gouvernementales.
Mais l’émergence des extrêmes et leur prédilection pour les commissions d’enquête tend à politiser cet instrument de contrôle parlementaire, mis au service ad probationem de certaines thèses idéologiques, tout en réintroduisant parfois une forme de violence sur le fond et la forme, notamment à l’Assemblée nationale. Des voix se sont faites entendre dans la presse pour évoquer l’idée d’un possible détournement de pouvoir…
Mais l’audition en commission d’enquête reste un exercice démocratique obligatoire qui peut donner lieu en cas de refus à des sanctions pénales, peu appliquées jusqu’à présent, mais surtout à des dommages réputationnels liée à une campagne de dénigrement qui peut être menée par les deux co-pilotes politiques de la commission. Refuser cet exercice pose également un problème de principe quant aux rapports que l’on souhaite entretenir avec les institutions sans parler de la dégradation de l’image de marque de celui qui fera l’objet du name on shame.
Un game changer institutionnel
L’utilisation politique et médiatique des commissions d’enquête illustre ce regain du parlementarisme lié à la disparition du fait majoritaire post-dissolution. La fonction de contrôle prend de plus en plus le pas sur la fonction législative, mise entre parenthèses faute de majorité d’idées ou de projet.
Le choix par les commissions d’enquête de thèmes très politiques, parfois très accusateurs, très larges, ainsi que la grande liberté dans le choix des publics auditionnés, illustre la fin de l’inhibition des parlementaires vis-à-vis du Gouvernement.
L’arrivée à maturité de la révision constitutionnelle de 2008 qui a introduit le fameux droit de tirage – chaque groupe minoritaire ou d’opposition disposant du droit de créer une fois par session une commission d’enquête sur le thème de son choix – couplée à l’inflation des groupes politiques a fait le reste…
Ce retour des commissions d’enquête n’est-il alors qu’une parenthèse en attendant 2027 ou inscrit-il quelque chose de plus durable dans le paysage institutionnel ? Difficile à dire.
Les entreprises de plus en plus visées
Du fait du ralentissement économique, de l’affaiblissement du pouvoir présidentiel et de la crise des finances publiques, les commissions d’enquête pointent du doigt les entreprises, suspectées d’avoir profité des largesses de pouvoirs publics trop business friendly. Cela a créé la surprise…
Un cap a été franchi en 2025 avec la commission d’enquête sénatoriale sur l’utilisation des aides publiques aux grandes entreprises qui a fait défiler tous les grands noms du CAC40 devant les sénateurs. Traditionnellement, n’étaient auditionnées que les organisations professionnelles.
Mais loin de la confrontation anticipée, les auditions ont permis au contraire une certaine acculturation public-privé. Les parlementaires ont salué l’effort de transparence et l’envie de coopérer des entreprises quand les grands patrons ont mesuré l’ampleur des contraintes pesant sur les pouvoirs publics et compris qu’il était légitime de savoir si l’utilisation de l’argent public à des fins économiques méritait d’être améliorée.
Depuis, les entreprises ont été confrontées aux freins à la réindustrialisation ou ont dû s’expliquer sur les défaillances de l’Etat face à la gestion des plans sociaux.
On peut regretter parfois certains procès à charge mais cette nouvelle donne joue aussi un rôle positif en matière d’information du Parlement, trop dépendant des administrations et trop coupé du monde économique.
L’audition en commission d’enquête : un exercice de communication particulier qu’il faut maîtriser
Il est donc important que les entreprises fassent ce travail de pédagogie sur l’économie et soient plus transparentes sur leur fonctionnement – elles qui sont encore trop souvent considérées par le politique comme des administrations privées – notamment dans un cadre globalisé où sont mis en compétition les systèmes publics et pas seulement les entreprises. La coopération public-privé dans le nouveau contexte d’ultra-compétition internationale devient dès lors un impératif de survie.
Parce qu’elles sont retransmises en direct et généralement ouvertes à la presse, les auditions ressemblent davantage à des conférences de presse qu’à des réunions à huis clos en dépit des apparences. Chaque propos tenu dans cette enceinte compte car une formule malheureuse coupée de son contexte peut tourner en boucle sur YouTube et les réseaux sociaux pour ridiculiser ou dénoncer l’interlocuteur infortuné.
Comme tout exercice délicat, il se prépare. L’existence d’un propos liminaire permet à l’organisation auditionnée de cadrer le débat et de délivrer ses messages en premier. C’est un atout dont il faut profiter en usant de tout son temps de parole, en structurant bien son propos et en valorisant réalisations et (contre)propositions. Maîtriser la statistique (une idée = un chiffre) et le storytelling sont des coups gagnants.
La démarche doit être transparente, honnête – la commission d’enquête impose de dire la vérité et rien que la vérité – et coopérative. C’est ce qui permet de limiter les risques réputationnels.
Trop souvent, les entreprises peu habituées à l’exercice adoptent une démarche par trop défensive car elles confondent les auditions en commission d’enquête avec les enquêtes préliminaires du parquet ou les auditions par la police et le procès judiciaire. Ce n’est pas le rôle d’une commission d’enquête. Certaines d’entre elles où les parlementaires s’érigent en procureurs et où l’audition devient un duel sont plutôt rares car la plupart sont surtout des auditions d’information. Il faut alors bien comprendre l’enjeu, répondre à ce qui est demandé et anticiper ce que les parlementaires pourront faire des informations transmises, notamment si elles alimentent ou justifient de futurs amendements ou propositions de loi.
Mais les auditions en commission d’enquête peuvent aussi constituer une opportunité de passer des messages devant un collège politiquement pluraliste. Une communication offensive maîtrisée prend alors tout son sens. Le meilleur angle consiste à rester factuel, le plus objectif possible sans tomber dans un contre-discours politique ou trop général qui décrédibilisera le propos. Les propositions techniques sont les bienvenues et peuvent recevoir un meilleur accueil que lors de la discussion des textes législatifs où tout se fait dans l’urgence et la précipitation. C’est enfin l’occasion de pouvoir assurer un suivi avec la représentation nationale pour faire émerger l’intérêt général, qui a aussi une dimension économique.
08/07/2025