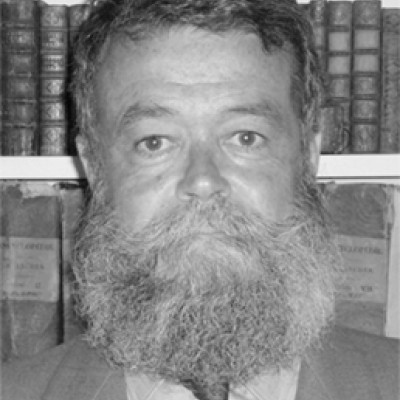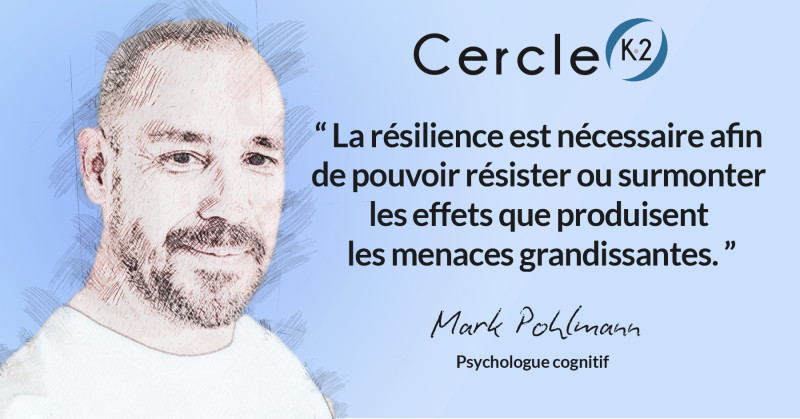Le Cercle K2 n'entend donner ni approbation ni improbation aux opinions émises dans les publications (écrites et vidéos) qui restent propres à leur auteur.
1. Le compte courant d’associés, vague concept ou concept vaste en droit OHADA
1.1. Le compte courant d’associés, ce méconnu en droit OHADA
Réalité de la pratique du droit des sociétés, notamment en France, la création, la gestion et certaines utilisations abusives des « comptes courants d'associés » (CCA) ont donné lieu à des litiges dont les tribunaux et les Cours ont eu à connaître[1], ce qui n’est pas, encore, le cas en droit OHADA. Le législateur africain paraît l’avoir ignoré lorsqu’il légiférait sur l’Acte uniforme initial puis révisé adopté le 30 janvier 2014[2].Il en est de même de la doctrine juridique africaine qui s'est relativement peu intéressée à la notion de « comptes d'associés » auxquels on pourrait penser qu’elle refuse la qualification de « compte courant »[3]. En revanche, les fiscalistes, les théoriciens de la finance d'entreprise et de la comptabilité y consacrent des développements d'autant plus précis qu'au contraire du droit des sociétés OHADA[4], le droit comptable et le droit fiscal le prennent en compte et, au moins en partie, le réglementent[5].
En l’absence d’une définition légale du compte courant d’associé en droit OHADA, on peut définir un compte courant d'associés comme : « l'apport en compte courant consistant pour l'associé à consentir à la société des avances ou des prêts en versant directement des fonds ou en laissant à sa disposition des sommes qu'il renonce provisoirement à percevoir »[6]. L’analyse de cette définition revêt toute son importance sur sa base légale en droit OHADA.
1.2. Les aspects juridiques du compte courant d’associé en droit OHADA
Nature du compte courant d’associé- Dans un arrêt World City c/ SOW Souleymane du 13 avril 2001 précité, la Cour d’Appel d’Abidjan a été amenée à se prononcer sur la nature juridique du compte courant d’associé et sur le point de savoir s’il s’assimilait au compte courant tel qu’on le conçoit en droit bancaire. Par cet arrêt, la Cour estime que dès l’instant où il n’existe pas de remises réciproques, le compte courant d’associé ne peut être assimilé au compte courant bancaire et s’analyse comme un prêt consenti à la société. Cette qualification juridique paraît là, fondée en droit et conforme à la volonté des parties dans la pratique des affaires.
Validité des CCA au regard des conventions réglementées- Le compte courant d’associé constitue en effet dans la pratique une convention conclue entre une société et ses associés[7]. A défaut d’être encadré par la loi ou de faire l’objet d’une convention écrite, le régime du CCA représente un risque que les associés privilégient leur intérêt personnel au détriment de l'intérêt social. Tel peut notamment être le cas en ce qui concerne l’éventuelle rémunération de ce prêt ou, encore, les conditions de délai dans lesquelles il devra être remboursé par la société, le calendrier fixé ou imposé pouvant coïncider avec les désirs de l’associé et non avec les capacités financières ou les priorités de développement de la société. Les comptes courants d'associés n’étant pas explicitement visés ni réglementés par l'AUSCGIE, le doute reste permis, au regard de certaines dispositions[8], de savoir s’ils rentrent vraiment dans le champ des conventions règlementées. Par comparaison, le système français, après quelques hésitations jurisprudentielles, ressort de l'autorisation préalable par les associés[9].
Si rien n'est prévu par la loi dans les sociétés de personnes, société civile, société en nom collectif, ou encore société en commandite simple[10], il semble prudent de considérer que, dans les sociétés de capitaux, la mise en œuvre d’un compte courant doive être soumise aux règles relatives aux conventions réglementées et, en conséquence, être validée par la collectivité des associés.
Limites des CCA- En application de l’article 356 de l’AUSCGIE[11], « à peine de nullité du contrat, il est interdit aux personnes physiques, gérantes ou associées, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s’applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées à l’alinéa premier du présent article, ainsi qu’à toute personne interposée »[12].C’est par cette référence, au demeurant négative, que le droit OHADA appréhende le compte courant : il est interdit qu’un compte courant d’associé soit débiteur. L’existence et la validité du compte courant en droit OHADA sont donc confirmées a contrario, suivant le principe « ce qui n’est pas interdit, est autorisé ». La nullité de la convention prévue par l'article susvisé est d'ordre public.
Outre le droit OHADA, des dispositions de droit national viennent aussi encadrer, et limiter, le CCA. Il en est notamment de l’article 9-2 du Code général des impôts sénégalais, lequel prévoit une double limite : les prêts en compte courant, tous associés confondus, ne peuvent dépasser le montant du capital social ; les intérêts appliqués à ces prêts en compte courant sont plafonnés. Le compte courant est donc, là encore, défini a contrario, par ce qu’il n’est pas ou par ce qu’il ne doit pas être.
2. Pourquoi un statut juridique du CCA en droit OHADA ?
2.1. Les dangers de l’absence de statut
Séparation du fait et du droit- Par la conclusion d'une convention de compte courant, à la qualité d'associé s'ajoute celle de créancier. La dichotomie associé/créancier se révèle dans la pratique, très largement factice et l'associé créancier se retrouve dans une situation ambivalente. S'il donne la préférence à ses intérêts de créancier et exige le paiement du solde de son compte[13], il risque de susciter presque l'ouverture d'une procédure collective dans laquelle, créancier chirographaire, il risque de tout perdre : son avance en CCA aussi bien que son apport[14]. L’absence de règle lui permet cependant de faire primer sa qualité de créancier et de se faire payer, au moins en partie, son compte courant au préjudice de la société elle-même et des autres créanciers.
L’achèvement de l’affectio societatis ?-Dans cette configuration d’un associé qui fait passer sa qualité de tiers avant celle d'associé nous atteignons les limites de l'affectio societatis,lequel devrait se manifester par la solidarité étroite des associés en vue du sauvetage de l'entreprise[15]. Autoriser qu’un associé accorde une trop importante avance en CCA risque ainsi, sans contrôle ni règle, de fragiliser la société et la cohésion entre associés.
Un déséquilibre des forces- La dichotomie de l'associé et du créancier modifie fondamentalement les rapports de contrôle qui existent au sein de la société. Elle introduit un rapport de puissance entre le créancier et les autres associés, le premier pouvant contraindre les seconds à sa volonté sous la menace non dissimulée du retrait de son avance. Il est surprenant que le législateur africain soit resté aveugle et sourd à la pratique de ces avances.
2.2. Quel statut juridique pour le compte courant d’associé en droit OHADA ?
La raison d’être du CCA étant d’assurer à la société une source de financement extra bancaire, et donc plus souple, il serait mal venu de vouloir trop encadrer le CCA[16]. Par exemple, si les avances devaient être bloquées au même titre que les apports[17], il n'y aurait pas seulement une faute de logique juridique ; le risque serait grand de voir se tarir une source de financement[18]. Il est donc louable de laisser une large place à la liberté contractuelle dans la conclusion des accords de CCA afin que celui-ci corresponde, dans chaque société, aux besoins spécifiques de l’entreprise. Ce constat explique en partie le silence du législateur OHADA. A l’inverse, il n’est pas sain de laisser des normes nationales à vocation essentiellement fiscales encadrer a contrario le CCA pour, en outre le limiter. Une telle situation rompt l’harmonisation voulue à travers l’OHADA et risque de faire naître non pas un, mais des statuts du CCA au sein de l’OHADA. La clarté et la simplicité voulues par le législateur OHADA s’en trouveraient aussi mises à mal puisqu’un même opérateur économique devrait soumettre ses avances en compte courant à des règles différentes suivant le pays où se trouvent les sociétés concernées. Si l’on reprend l’exemple du Sénégal, est-il pertinent de limiter le montant des avances en compte courant à celui du capital social, obligeant ainsi les associés soit à immobiliser en capital de l’argent qu’ils pourraient prêter temporairement, soit à ne pas financer la société ?
L'élaboration d'un statut trop contraignant pour les CCA en droit OHADA serait une erreur dans la mesure où l'intérêt de cet outil et l’élément caractéristique de sa réussite reposent sur son habileté d'emploi, sur sa souplesse. Mais, la volonté d’harmonisation et la sécurité qu’une telle harmonisation représenterait pour la société et pour les associés militent pour qu’un socle, restreint et fondamental, de règles communes soit adopté. Ces règles pourraient, entre autres et pour l’essentiel, régir le formalisme du CCA, au moins au-delà d’un certain montant ou niveau, le contrôle de la mise en CCA d’avances par un associé, les conditions de rémunération du CCA, les conditions de remboursement des avances en CCA, notamment en considération des intérêts de la société. Le droit OHADA, adoptant une définition positive du CCA, en ressortirait plus protecteur et plus fort.
---
[1] Com., 23 avril 2013, n° 12-14.283 ; Com., 24 mars 2044, n° 01-12.543 ; Com. 10 janv. 2012, n° 11-10.018 ; Com. 8 juill. 2008, n°06-13.518. Civ. 3e, 3 févr. 1999, n°97-10.399 ; Com. 20 févr. 2007, n° 05-16.698.
[2] Même s’il est évident que des textes comme les articles 356, 450, 507, 853-16 dudit Acte visent au premier chef des pratiques liées à l’existence et à la tenue des comptes courants d’associés.
[3] « Le CCA est un prêt s’il ne comporte pas de remises réciproques et a un régime juridique différent de celui du compte courant bancaire » : C.A. Abidjan, n°401, 13-4-2001 : World City c/ SOW Souleymane, Ecodroit, n° 11, mai 2002, p. 57, Ohadata J-02-190, obs. J. Issa-Sayegh ; Xavier DELPECH, Dalloz Actualités, Précisions sur le régime du compte courant d’associé, 2013.
[4] Pour les besoins de l’étude, on continuera avec le sigle AUSCGIE pour signifier le droit des sociétés OHADA.
[5] Dans le Plan comptable OHADA, le compte courant d'associé est classé parmi les comptes de tiers qui enregistrent des opérations à court terme, 462-Compte courant associé est crédité et débité des fonds avancés temporairement pas les associés. Pareil pour le compte 466-Groupe comptes courants ou encore 2711- Prêts participatifs. Pour une vue d’ensemble en la matière, voir en ce sens, Impôts sur les sociétés-Régime des intérêts de compte courant d’associés-Taux d’escompte de la BCEAO, Newsletter BCA Pme, Grant Thornton n° 2014/134, p. 3 ; M. Dobil, Comptabilité OHADA-Comptabilité des sociétés, AEC-Karthala, Tome 3, 2008, p. 61.
[6] J. Calvo, Les comptes courants d'associés : aspects juridiques et fiscaux, LPA 19 janv. 1998, p. 4 ; F. Vinckel, J.-Cl. Sociétés, Fasc. 36-20, Comptes courants d'associés ; D. Danet, Comptes courants d'associés : pour en finir avec un apartheid juridique, RTD com. 1993, p. 55.
[7] J. Calvo, Les comptes courants d'associés : aspects juridiques et fiscaux, LPA 19 janv. 1998, no 8, p. 4 ; J.-F. Barbiéri, Sur le sort du compte courant en cas de cession de titres, Bull. Joly 2008. 160 ; A. Couret, Dépendance ou indépendance des qualités d'associé et d'apporteur en compte courant, Bull. Joly 1992. 7 ; M. Cozian, A. Viandier, et F. Deboissy, Droit des sociétés, 2014, Lexisnexis, nos234 et s, X. Delpech, Compte courant d’associé, Répertoire de droit des sociétés, 2009, n° 25 et s.
[8] Articles 350, 438 et 853-14 de l’AUSCGIE.
[9] La Cour de cassation semble avoir opté pour la thèse de l'autorisation préalable dans un arrêt de principe du 22 juillet 1986, Civ. 1, 22 juill. 1986, n° 84-15.177.
[10] Il est utile, pour pallier ce silence du législateur, de soumettre le droit du gérant à faire fonctionner un compte courant d'associé (ouverture, remboursement de l'avance…) à une décision des associés.
[11] La procédure légale s'applique également dans les sociétés anonymes (Art. 450 et 507 AUSCGIE), y compris dans la SAS (853-16 AUSCGIE).
[12] Si les associés peuvent prêter à leur entreprise, l’inverse n’est aucunement valable car il s’agirait d’un abus de biens sociaux. Il s'agit là évidemment d'une sage mesure afin d'éviter de regrettables confusions de patrimoine.Toutefois, dans les sociétés civiles et les SNC, le compte courant d’associé peut être débiteur et l’associé a donc une dette envers sa société.
[13] Sauf, lorsqu’il existe entre la société et l'associé une convention de blocage. La société s'engage alors à ne pas rembourser le solde créditeur du compte avant le terme prévu. En général, l'associé s'engage à ne pas demander ni accepter le remboursement.
[14] F. Derrida, Le crédit et le droit des procédures collectives, Etudes Rodière, p. 67.
[15] Y. Guyon, note sous Com., 19 mars 1981, JCP 1982, 19720.
[16] P. Avare, Rôle et influence des comptes courants d'associés dans les petites et moyennes entreprises, Thèse Paris I, 1984, p. 139.
[17] Article 41 de l’AUSCGIE.
[18] A. Couret, Dépendance ou indépendance des qualités d'associé et d'apporteur en compte courant, Bull. Joly, 1992, n° 1, p. 7.
04/09/2015