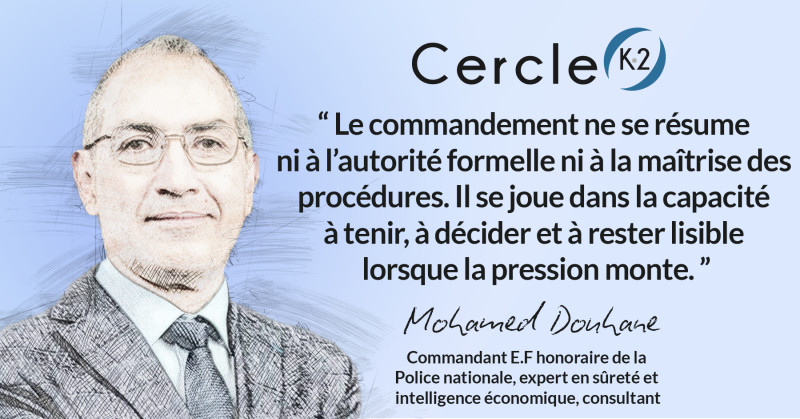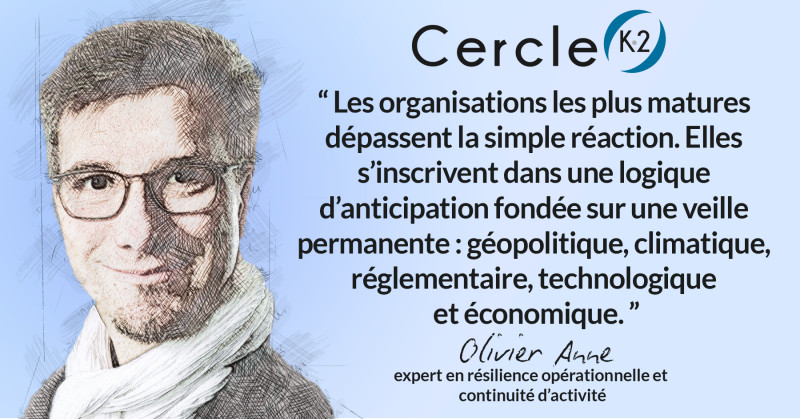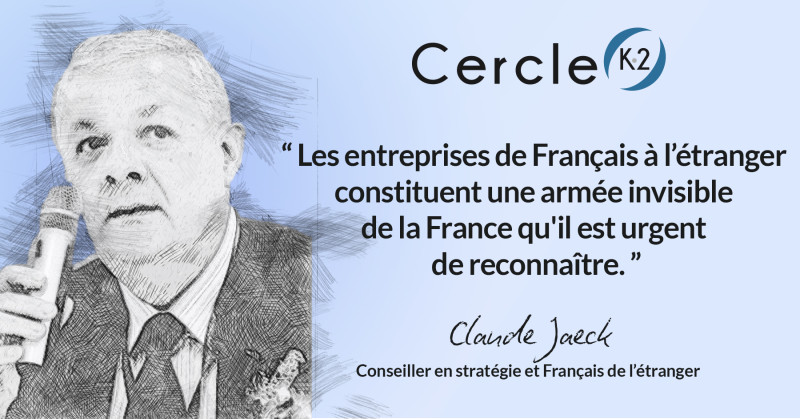Quand l’intelligence artificielle réinvente le quotidien : une journée ordinaire en 2035
10/10/2025 - 8 min. de lecture
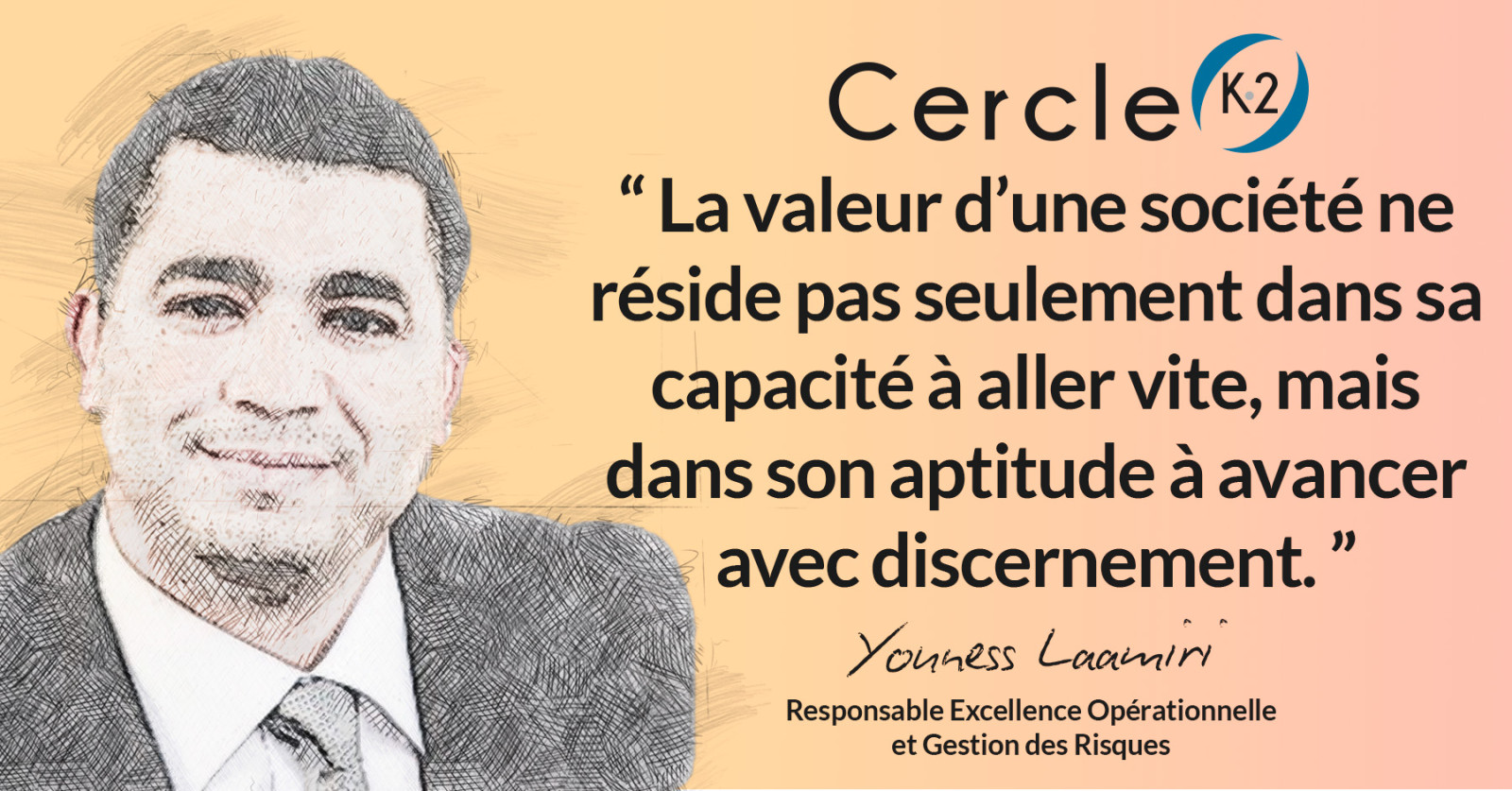
Le Cercle K2 n'entend donner ni approbation ni improbation aux opinions émises dans les publications (écrites et vidéos) qui restent propres à leur auteur.
Youness Laamiri est Responsable Excellence Opérationnelle et Gestion des Risques.
---
Quand l’intelligence artificielle réinvente le quotidien : une journée ordinaire en 2035
Introduction
En 2035, l’intelligence artificielle (IA) ne se contente plus d’être un outil : elle est devenue une infrastructure invisible qui orchestre une grande partie de nos vies. Ce qui, en 2025, paraissait encore expérimental ou réservé à des usages de niche est désormais intégré à chaque geste du quotidien. Pour prendre la mesure de cette transformation, projetons-nous dans la vie d’une famille ordinaire. Leur journée illustre à quel point certains métiers traditionnels ont été métamorphosés, et soulève en filigrane une question cruciale : comment nos sociétés financeront-elles demain l’État, la solidarité et les services publics quand le travail humain ne sera plus la principale source de revenus ?
Une journée ordinaire en 2035
Le matin : l’IA s’invite au petit-déjeuner
Il est 7h30, dans une maison de banlieue française. La cafetière s’est déjà activée, non pas parce qu’un membre de la famille a appuyé sur un bouton, mais parce que l’IA domestique a anticipé l’heure idéale en fonction du rythme de sommeil de chacun. Les courses de la semaine ont été livrées sans que personne ne prenne la peine de remplir une liste : un algorithme croise l’historique de consommation, les préférences alimentaires et les contraintes budgétaires pour ajuster automatiquement les commandes. Le frigo est un tableau de bord connecté.
Sur le trajet de l’école : professeur holographique
Dans la voiture autonome, le fils aîné peine avec un exercice de mathématiques. « Explique-moi encore le théorème de Pythagore », demande-t-il à haute voix. Instantanément, une IA pédagogique projette un schéma holographique dans l’habitacle. L’enfant manipule les côtés du triangle virtuel du bout des doigts ; l’assistant ajuste l’explication à son niveau de compréhension. Le rôle de l’enseignant humain ne disparaît pas totalement, mais il se redéfinit : il devient superviseur, mentor, garant de l’esprit critique plutôt que simple dispensateur de connaissances.
À l’heure de travail : la médecine de poche
Arrivée au bureau, la mère de famille ressent une gêne visuelle. Elle sort son smartphone : la caméra & rétinographe numérique embarquée scanne son œil avec une précision quasi médicale. L’IA ophtalmologique, entraînée sur des millions de cas, détecte une légère anomalie, propose un changement de correction et envoie directement une ordonnance électronique à l’opticien le plus proche. Un rendez-vous physique n’est nécessaire que si l’anomalie dépasse un seuil critique. Le médecin humain devient un expert de recours, mobilisé sur des cas complexes ou rares.
Dans l’après-midi : un avocat virtuel
Le père doit vérifier une clause contractuelle pour une future acquisition immobilière. Autrefois, un notaire aurait été sollicité, moyennant des honoraires conséquents. En 2035, une IA juridique interroge en quelques secondes une base de données internationale actualisée en continu. Le contrat est généré, annoté, et validé électroniquement. Le rôle du juriste humain subsiste, mais sous forme de consultant spécialisé, sollicité seulement dans des litiges stratégiques.
Le soir : un quotidien fluide, mais sans surprise
Au retour à la maison, le dîner s’est préparé presque tout seul. Les fours connectés pilotent les cuissons, les assistants IA gèrent les factures d’énergie en arbitrant en temps réel entre les fournisseurs. La famille profite d’une fluidité logistique impressionnante : presque plus de paperasse, plus de rendez-vous contraignants. Mais derrière ce confort, se pose une question lourde : quels métiers, quelles cotisations, quelles ressources alimentent encore l’État providence ?
Quels métiers ont disparu, lesquels ont été transformés ?
L’histoire de cette famille illustre un basculement massif : nombre de professions autrefois centrales sont aujourd’hui partiellement ou totalement automatisées.
- Médecins généralistes et ophtalmologues de premier recours : remplacés par des diagnostics IA pour les cas courants, ils se concentrent désormais sur les pathologies complexes.
- Professeurs : la transmission de savoirs de base est largement prise en charge par des IA pédagogiques. Les enseignants deviennent des « coachs cognitifs », garants de la pensée critique et du développement socio-émotionnel.
- Notaires, avocats, juristes : les actes standardisés sont générés automatiquement. Les humains interviennent en cas de contentieux ou de stratégie.
- Chauffeurs, livreurs, commerçants de proximité : largement supplantés par les véhicules autonomes et les plateformes de distribution.
- Fonctions administratives intermédiaires : la saisie, le tri, la validation documentaire ont presque disparu, absorbés par des IA de gestion.
Ces évolutions ne signifient pas la fin de tout emploi humain. De nouveaux métiers apparaissent, centrés sur la supervision des IA, la cybersécurité, l’éthique, la médiation homme-machine ou encore la créativité artistique. Mais la masse salariale globale s’est réduite, ce qui amène un défi inédit : moins de revenus humains, donc moins d’impôts sur le revenu et de cotisations sociales.
Le dilemme fiscal et social
En 2025, la fiscalité reposait encore largement sur l’impôt sur le revenu, la TVA et les cotisations sociales. Mais en 2035, si 40 à 60 % des métiers sont partiellement ou totalement automatisés ou remplacés par l’IA, cela signifie une contraction sans précédent de ces bases fiscales. Selon certaines estimations, la perte ne se compterait plus en dizaines, mais en plusieurs centaines de milliards d’euros par an pour la France. Une telle ponction équivaut à l’entièreté du budget de la santé publique ou de l’éducation nationale, et remettrait radicalement en question la soutenabilité de notre modèle social (cf. Automation and taxation, Oxford Economic Papers) [1].
Quelles solutions envisager pour éviter l’effondrement du contrat social ?
Quatre pistes sont ici proposées à notre discernement :
1. Taxer les entreprises d’IA et les robots
La première option consiste à instaurer une fiscalité spécifique sur la valeur créée par les systèmes automatisés. De la même manière que l’impôt sur les sociétés capte une partie de la richesse générée par les entreprises, une "taxe sur la productivité automatisée" ferait contribuer les acteurs économiques au prorata des gains obtenus grâce à l’IA et aux robots *(voir Robot Taxation: A Normative Tax Policy Analysis) [2].
L’objectif n’est pas de freiner l’innovation, mais de compenser la disparition des cotisations sociales liées aux emplois humains supprimés ou transformés. Une telle taxe, si elle était fixée à l’échelle internationale (comme l’accord OCDE sur la taxation minimale des multinationales), pourrait rapporter des centaines de milliards et assurer une redistribution plus équitable des bénéfices de l’automatisation (cf. Do robots dream of paying taxes?, Bruegel) [3].
Le défi, toutefois, est double : éviter que les entreprises délocalisent leurs activités vers des zones à fiscalité plus clémente, et définir une méthode transparente pour mesurer les gains de productivité réellement attribuables à l’IA.
2. Créer un revenu universel de base
La deuxième piste est celle d’un revenu universel de base (RUB), financé par les nouvelles recettes issues de l’automatisation. Chaque citoyen recevrait une allocation mensuelle, inconditionnelle, qui lui garantirait une sécurité matérielle minimale.
Ce mécanisme permettrait de protéger les individus face à la volatilité croissante du marché du travail et de soutenir la consommation. Plus qu’un filet de sécurité, il pourrait devenir un tremplin : en libérant du temps et de l’énergie, les citoyens pourraient se former, entreprendre, s’engager dans des projets sociaux, associatifs ou créatifs.
Pour éviter le risque d’une dépendance passive, certains modèles proposent de conditionner partiellement le RUB à une participation volontaire dans des activités d’intérêt général (formation continue, missions locales, engagement social). Le RUB ne serait pas un simple revenu d’assistance, mais une plateforme de valorisation de toutes les formes de contribution (cf. Inclusive Growth in the Era of Automation and AI) [4].
3. Réinventer la formation continue
La troisième piste consiste à investir massivement dans l’éducation tout au long de la vie. Si l’IA automatise de nombreux métiers, elle crée aussi de nouveaux besoins : superviseurs de systèmes intelligents, experts en cybersécurité, médiateurs homme-machine, spécialistes en éthique algorithmique, etc.
Certes, cette logique existe déjà aujourd’hui, mais elle reste souvent limitée : les formations proposées sont encore trop courtes, trop normatives, et rarement alignées sur les véritables besoins d’adaptation.
Réinventer la formation signifie dépasser ce cadre. Les programmes doivent devenir flexibles, évolutifs et personnalisés, continuellement ajustés aux besoins des individus, des entreprises et de la société. L’effort doit également commencer dès la petite enfance : le système éducatif doit s’étalonner aux enjeux futurs, dépasser une approche uniquement académique et préparer les citoyens à évoluer dans un monde en transformation permanente.
Dans cette perspective, la formation n’est plus seulement un outil économique, mais un levier d’émancipation et de résilience collective, capable d’éviter que l’automatisation ne produise une fracture sociale insurmontable.
4. Pratiquer une décélération consciente
Enfin, une quatrième piste, plus radicale, consiste à introduire une décélération consciente du progrès technologique. L’idée : accepter que tout progrès n’a pas vocation à être poursuivi à la vitesse maximale.
Il s’agirait de développer une véritable éthique du rythme, où l’on ralentit volontairement la cadence de l’innovation et de la recherche de performance. Non pas par peur du progrès, mais pour redonner à la société le temps de s’adapter, de digérer les changements, de mesurer les impacts sociaux et écologiques avant de franchir de nouveaux seuils. Cette approche invite à considérer le progrès comme une construction maîtrisée, plutôt qu’une course effrénée vers l’inconnu.
De nombreuses traditions philosophiques et spirituelles ont rappelé que l’homme ne se définit pas uniquement par sa vitesse ou sa puissance, mais par sa capacité à instaurer des pauses fertiles. Les Anciens plaçaient au cœur de leurs vertus la tempérance, entendue comme l’art de trouver la juste mesure entre excès et insuffisance. Cette sagesse, héritée de la philosophie grecque, garde toute sa pertinence à l’ère de l’IA : elle nous rappelle que la valeur d’une société ne réside pas seulement dans sa capacité à aller vite, mais dans son aptitude à avancer avec discernement.
La décélération consciente s’inspire de cette idée : apprendre à dire non à la frénésie, instaurer des "temps de respiration" collectifs, consolider chaque étape avant de franchir la suivante. Dans ce cadre, ralentir n’est pas régresser, mais au contraire maîtriser la trajectoire.
Concrètement, cela pourrait se traduire par des moratoires sur certaines innovations, des cycles de maturation volontaire des technologies, ou encore des instances citoyennes chargées d’évaluer non seulement les bénéfices économiques, mais aussi les conséquences humaines et sociales de chaque avancée.
La décélération consciente devient ainsi un principe éthique : non pas un frein à la modernité, mais une philosophie du ralentir consciemment, une manière de réinscrire le progrès dans une temporalité plus humaine et plus universelle.
Conclusion
La journée de cette famille en 2035 est à la fois fascinante et paradoxale. Elle montre la puissance de l’IA à simplifier la vie, mais aussi la fragilité des équilibres sociaux et fiscaux sur lesquels reposent nos sociétés. L’automatisation ne doit pas être subie, mais pensée comme un levier collectif.
Quatre pistes ont été proposées ici à la réflexion : taxer l’IA, instaurer un revenu universel, repenser la formation, et plus disruptive encore pratiquer une décélération consciente. C’est peut-être cette dernière qui interroge le plus, car elle bouscule non seulement nos modèles économiques, mais aussi notre rapport intime au progrès.
La question n’est plus seulement "l’IA va-t-elle remplacer l’homme ?", mais "à quelle vitesse voulons-nous avancer, et dans quelle direction ?". La réponse déterminera si 2035 sera perçu comme le début d’un âge d’or, comme le seuil d’une fracture irréversible, ou comme l’espérance que l’Homme retrouve la tempérance, cette vertu qui équilibre vitesse et discernement.
---
Références
[1] Automation and taxation : an empirical assessment in Europe. (n.d.). Oxford Economic Papers.
[2] Dimitropoulou, C. (2024). Robot Taxation : A Normative Tax Policy Analysis – Domestic and International Tax Considerations (IBFD Doctoral Series, Vol. 70).
[3] Christie, R. (2021). Do robots dream of paying taxes? Bruegel Policy Contributions.
[4] Merola, R. (2022). Inclusive Growth in the Era of Automation and AI : How Can Taxation Help ? Frontiers in Artificial Intelligence.
10/10/2025