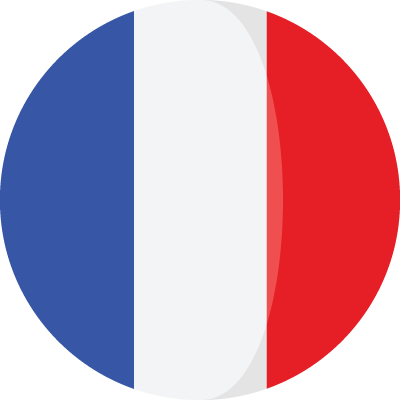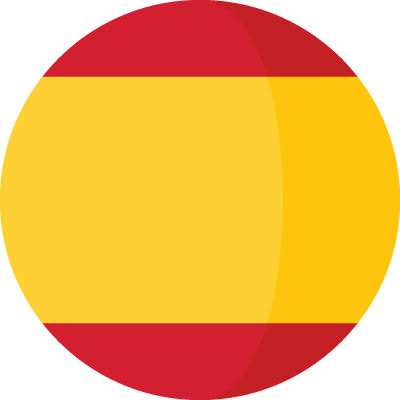Prescrire n'est pas pardonner, prescrire n'est pas oublier
03/02/2022 - 5 min. de lecture
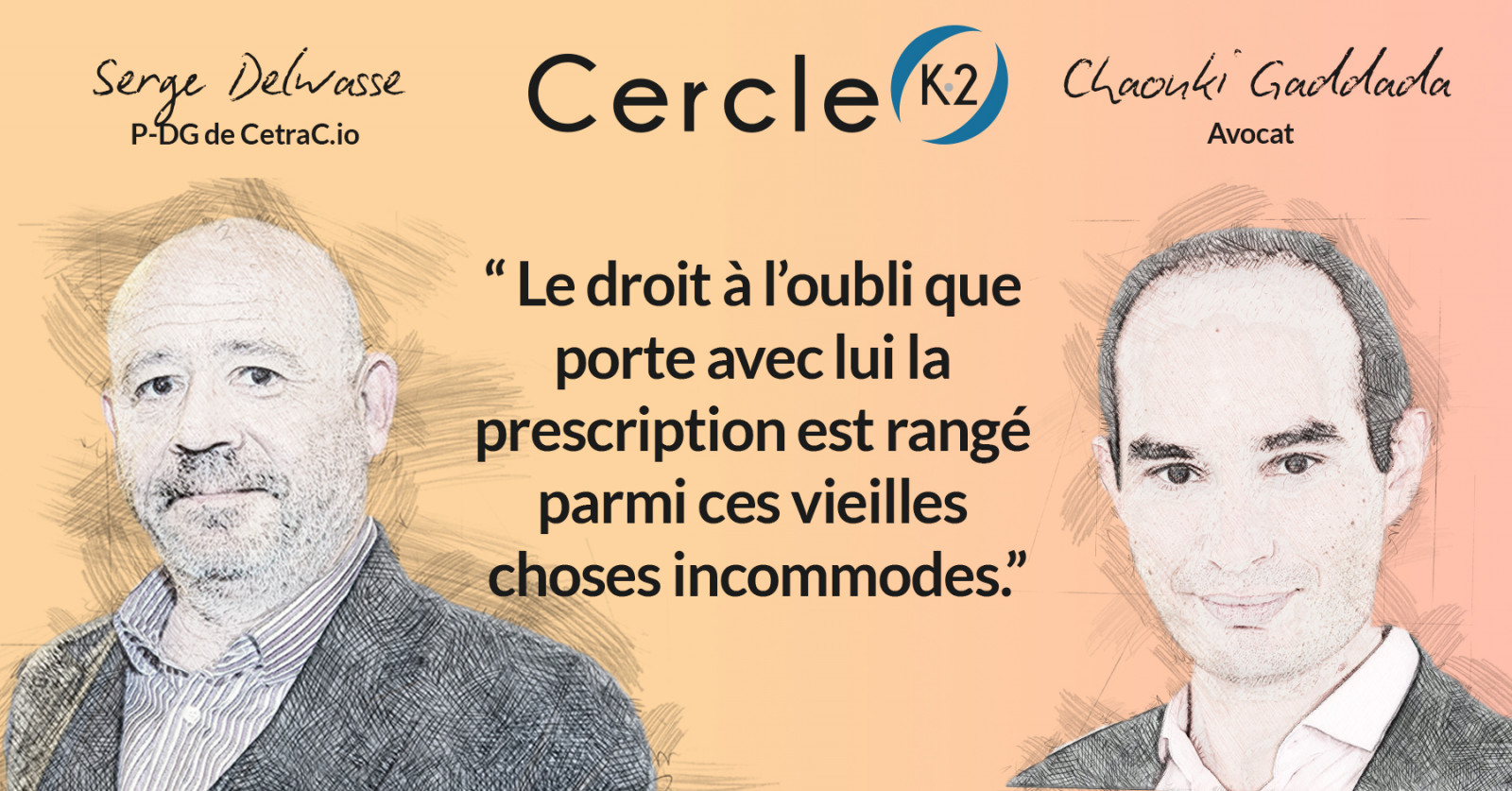
Le Cercle K2 n'entend donner ni approbation ni improbation aux opinions émises dans les publications (écrites et vidéos) qui restent propres à leur auteur.
Serge Delwasse est P-DG de CetraC.io. Chaouki Gaddada est avocat au barreau de Paris..
---
Prescrire n'est pas pardonner, prescrire n'est pas oublier
La libération de la parole est un mouvement profond, qui porte avec lui une nouvelle façon d’interroger notre rapport à la prescription. Concept millénaire s’il en est, la prescription est un mécanisme juridique qui, sur le plan pénal, fait obstacle à la poursuite d’auteurs d’infractions.
Naturellement, les effets de ce mécanisme sont diversement perçus et il est légitime qu’un débat de société s’engage sur sa pertinence, en particulier quand il s’applique à des infractions relevant de ce que l’on appelait autrefois des affaires de mœurs, dont on sait la difficulté à porter la parole et à démontrer les faits.
Il importe cependant de rappeler que la prescription n’a pas été imaginée pour protéger les auteurs d’infraction ou pour faire tort aux victimes, mais qu’il est un attribut essentiel d’une société reposant sur le droit.
Un concept malmené
Relevons tout d’abord un paradoxe propre à notre époque : la prescription n’empêche pas l’ouverture d’une enquête pénale par les services de police judiciaire. Chacun a pu en être témoin récemment à propos d’accusations portées sur des personnalités publiques concernant des faits prescrits. Dans sa communication officielle, le parquet indique que l’enquête pénale est susceptible de révéler des faits similaires, mais non prescrits. Une sorte d’appel à victimes. Le procédé peut être efficace, il est vrai, mais ne participe-t-il pas, dans une certaine mesure, d’une opération de communication destinée à satisfaire l’opinion publique, qui ne peut accepter l’idée qu’un crime ou un délit demeure impuni ?
La prescription heurte, en effet, au plus profond de nous, un sentiment de justice qui se voit privé de la possibilité de s’exprimer.
Le législateur n’est pas demeuré insensible à ce phénomène de remise en cause du principe de la prescription.
Les délais de la prescription pénale, historiquement de 1 an pour les contraventions, 3 ans pour les délits et 10 ans pour les crimes, ont ainsi été doublés et sont passés, respectivement, à 1, 6 et 20 ans. Lorsque par ailleurs les crimes et délits concernent des mineurs, ces délais ne courent qu’à partir de la majorité de la victime, soit une prescription qui peut atteindre jusqu’à 30 ou 35 ans.
En se rappelant que la prescription peut être interrompue, à tout moment, par un acte d'enquête, il en ressort qu’aujourd’hui, pour les affaires les plus graves, la possibilité d’invoquer la prescription est surtout théorique.
Le droit à l’oubli que porte avec lui la prescription est ainsi rangé parmi ces vieilles choses incommodes, que l’on conserve par affection pour le souvenir, mais que l’on cache aux regards en raison de leurs traits vieillis et disgracieux.
La prescription est pourtant nécessaire
Il est une contradiction que tout juriste connaît bien : dans le même temps que les délais de prescription pénale ont été rallongés, on a raccourci ceux de la prescription applicable en matière civile. Ainsi, la prescription civile, en particulier la prescription prud’homale, est passée de 5 ans à 3 ans, même à 1 an pour contester une mesure de licenciement.
Il n’a pas échappé à certains que la prescription, prise d’un certain côté, présente des avantages non négligeables…
La prescription, au-delà d’être un objet politique, est avant tout une nécessité pour toute société.
Issue essentiellement du droit romain, qui en a tracé les contours, elle est en effet destinée à la protection de la société, prise dans son ensemble.
Elle permet d’éviter l’engorgement des tribunaux, dont pâtissent trop de justiciables, et empêche la société de se livrer à une vendetta sans fin. La prescription n’est pas un pardon, ni une preuve d’innocence, c’est un droit à l’oubli pour des faits que l’on juge trop anciens pour réveiller les passions, si dangereuses pour le maintien de la paix sociale.
Elle évite également un débat impossible : comment juger de faits anciens quand les témoins ont, au mieux, oublié ou, au pire, disparu ?
La prescription, pour en comprendre la portée, ne doit donc pas être envisagée sous la lorgnette d’une affaire particulière, qui nous émouvra tous et pour laquelle on n’acceptera pas l’absence de châtiments. Sans place réservée à l’oubli, une société ne peut durablement se protéger. Il faut sans doute le souligner, l’oubli n’est pas synonyme de blanc-seing à des malfaiteurs ou d’abandon des victimes.
Que ce concept, institué par le droit romain, se retrouve dans nos différents systèmes juridiques modernes prouve sa pertinence.
Il faut donc l’accueillir comme un moyen nécessaire à la préservation de notre paix sociale. De la même manière, pour les faits amnistiés ou pour les faits jugés. Une fois sa dette payée à la société, le condamné a le droit à sa réintégration.
Peut-on l’étendre ?
Le sujet est délicat et les oppositions s’affrontent. Que faire des biens légués par l’histoire, parfois issus de crimes ou de pillages ? Des demandes de restitutions d’œuvres d’art volés il y a plus de 200 ans se font en effet plus nombreuses. Faut-il y accéder, aux dépens des musées européens qui ont participé à leur conservation et, pour certaines, les ont sauvés d’une éternelle disparition ?
Des opinions différentes ont été émises sur le sujet. Certains ont proposé de créer une prescription de 100 ans réservée aux délits et crimes d'État (pillages, destructions organisées, esclavage, vol d'œuvres d'art), considérant que cette solution permettrait de régler les problèmes de concurrence mémorielle. D’autres s’opposent au principe de toute prescription concernant de tels faits, considérant que les biens nationaux pillés au cours de l’histoire appartiennent au patrimoine du pays spolié et doivent de ce fait lui être restitués.
…Jusqu’au crime contre l’humanité ?
Le principe d’imprescriptibilité interroge. Y a-t-il des crimes qui par leur extraordinaire gravité et l’extrême horreur de leur nature touchent le cœur de notre humanité et doivent pour cette raison échapper au droit à l’oubli ?
Un consensus semble exister pour rendre imprescriptibles les crimes contre l’humanité.
L’imprescriptibilité ne peut cependant s’envisager que dans les limites de la vie humaine : le décès éteignant l’action publique, il ne s’agit naturellement pas de poursuivre les auteurs du massacre des Vikings ou les responsables de la destruction de Carthage.
Le terme même d’imprescriptibilité semble, donc, dans les faits, inadapté. Mal nommé les choses, c’est ajouter du malheur au monde.
Serge Delwasse et Chaouki Gaddada
03/02/2022