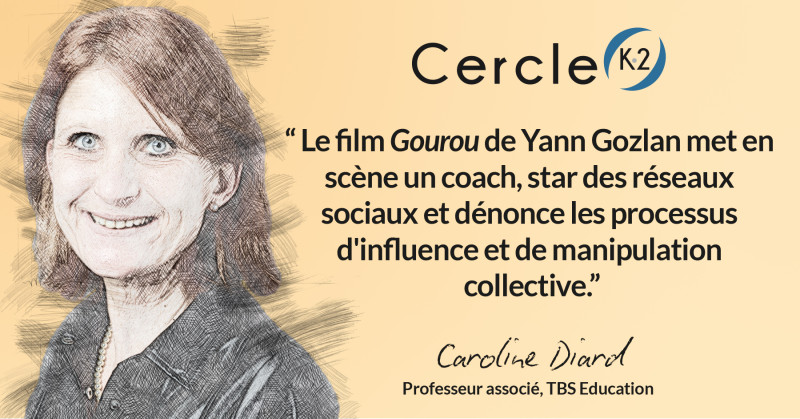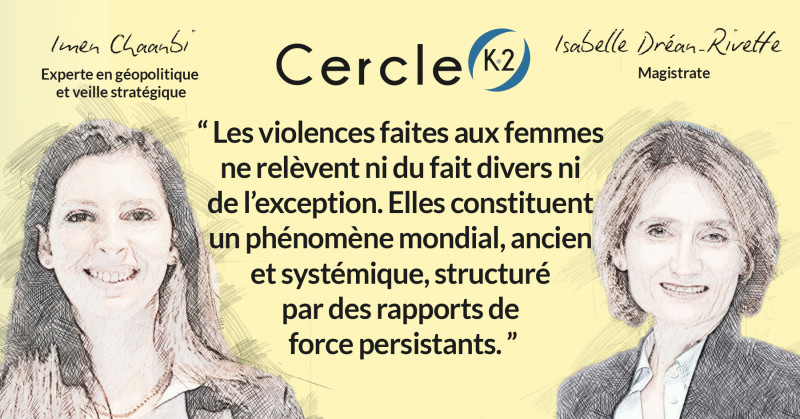Le bel avenir des cabinets de conseil dans la fonction publique
18/02/2025 - 3 min. de lecture
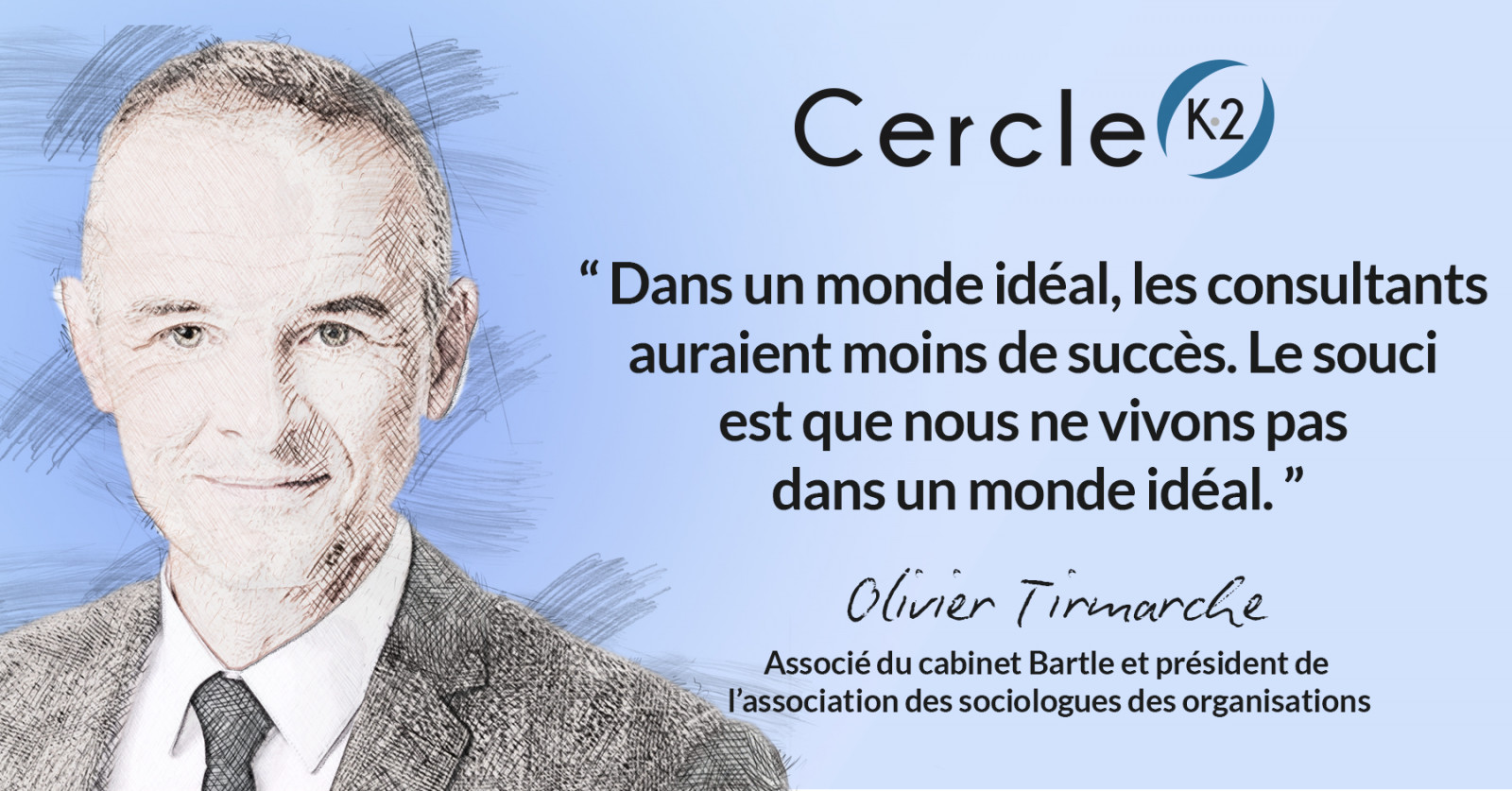
Cercle K2 neither approves or disapproves of the opinions expressed in the articles. Their authors are exclusively responsible for their content.
Olivier Tirmarche est associé du cabinet Bartle et président de l’association des sociologues des organisations.
---
Suite au "scandale McKinsey" qui a servi de prétexte à une critique plus générale des interventions des cabinets de conseil dans les affaires publiques, nos derniers gouvernements ont pris plusieurs décisions, parmi lesquelles la création de procédures de restriction et d’une Agence de conseil interne de l’État. Au fond, l’ensemble des engagements pris se résume à deux composantes : des barrières à l’entrée pour les externes, et des moyens de substitution en interne. Sur le long-terme, ces décisions ne remettront pas en cause la place des cabinets, car ces derniers remplissent des fonctions essentielles, négligées par les détracteurs.
Mimétisme et économie de la pensée
La première fonction des cabinets est de transférer des idées, des schémas de pensée et des normes d’une organisation à l’autre, au-delà des frontières sectorielles. Ces transferts répondent à deux besoins fondamentaux. Tout d’abord, dans un univers concurrentiel qui implique tout autant les organisations publiques que privées, les cabinets de conseil contribuent à un mécanisme parfaitement documenté par les économistes et les sociologues : le mimétisme. Le mimétisme concurrentiel est central parce qu’il est souvent moins coûteux d’observer les concurrents que d’observer les clients, et parce qu’il vaut mieux se tromper avec les concurrents que de se tromper seul. Ensuite, les transferts d’idées, de schémas et de normes permettent aux décideurs d’économiser la pensée et d’agir plus rapidement, quitte à faire l’impasse sur l’analyse de la complexité et des spécificités des organisations qu’ils gouvernent. Des consultants internes ne peuvent remplir la fonction de transfert aussi bien que les externes, car ces derniers tirent leur capacité non seulement des learning expeditions ou des benchmarks, mais aussi et surtout de la diversité des contextes de mission.
Confiance interpersonnelle et réduction de l’incertitude
On a beaucoup glosé sur la proximité relationnelle entre Emmanuel Macron et tel ou tel associé de McKinsey. Plutôt qu’une marque de corruption, économistes et sociologues y voient un phénomène typique des marchés de prestation complexe, dont font partie les professions d’avocat ou de psychothérapeute. Ce qui caractérise tous ces métiers, c’est l’incertitude qui pèse sur la qualité des produits délivrés. Face à l’incertitude, les réseaux de connaissance personnelle et les relations éprouvées par l’histoire remplissent une fonction de confiance. Ni le statut de consultant de la fonction d’État, ni les procédures d’achat public ne réduisent l’incertitude sur la qualité des produits délivrés. Les barrières administratives sont certes utiles pour contenir le risque de collusion, mais elles ne protègent pas contre les livrables défectueux ou le gâchis d’argent public.
Compensation des déficits de coopération
La troisième fonction des cabinets de conseil est là encore contenue dans une critique qui leur est adressée : « en fait ils ne sont experts de rien, leur métier c’est la mobilisation [des acteurs] ». L’affirmation contient une part de vérité. Les consultants sont des professionnels de la comitologie : ils animent des SteerCo, des Copil, des Coproj… qu’ils alimentent en rapports flash, en diagnostics partagés, en feuilles de route… pour enchaîner avec des ateliers collaboratifs, des séminaires… Tous ces dispositifs ont un point commun : il s’agit de réunir des individus provenant d’horizons divers, de faire circuler des informations, et de faire émerger des points de vue communs. Dans des organisations qui sont le plus souvent cloisonnées, les cabinets viennent compenser des déficits de coopération. Les moyens de substitution, en l’occurrence les consultants internes de l’État ne résorberont pas les déficits de coopération. Pire : ils créeront de nouveaux déficits. Ils seront en effet placés en situation de monopole. Or les monopoles ne coopèrent pas ou mal, puisqu’ils n’y sont pas obligés pour survivre. Inévitablement les clients se plaindront de la piètre qualité des prestations, comme ils le font déjà dans de grandes organisations privées dotées de consultants internes. Ils chercheront à échapper au monopole, mais les procédures de restrictions viendront leur compliquer la tâche : il faudra se justifier, trouver les moyens de contourner… Bref, les remèdes se révéleront pire que le soi-disant mal dénoncé par le scandale. Retour à la case départ, avec au passage un supplément de dépenses en temps et en monnaie.
Limites du management contemporain
Le fait que les cabinets de conseil remplissent des fonctions essentielles n’interdit pas d’exprimer des regrets. En effet leur succès manifeste de sérieux défauts du management contemporain. Le premier de ces défauts est la facilité avec laquelle décideurs s’en remettent à des solutions importées, le plus souvent standardisées, trop rarement adaptées aux particularités de leur contexte et aux logiques systémiques associées. Le deuxième défaut est la tendance à fabriquer des cloisons organisationnelles, faute de comprendre la dynamique des relations entre acteurs. Les réponses apportées par les cabinets aux déficits de coopération ne sont pas pleinement satisfaisantes car il s’agit trop souvent de traitements symptomatiques plutôt que de traitements de fond. Dans un monde idéal, les consultants auraient moins de succès. Le souci est que nous ne vivons pas dans un monde idéal.
18/02/2025