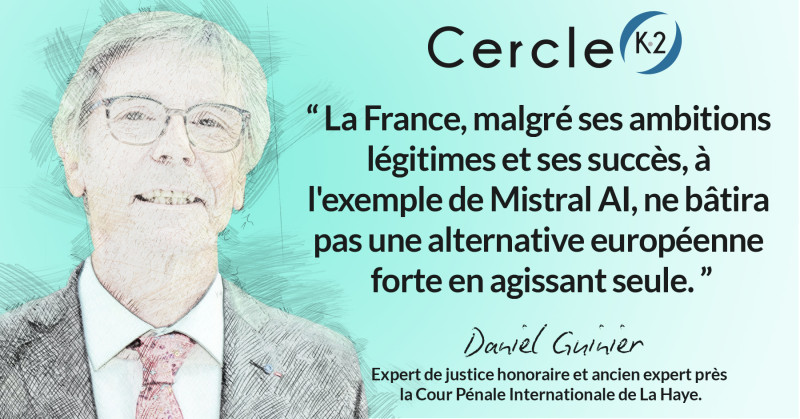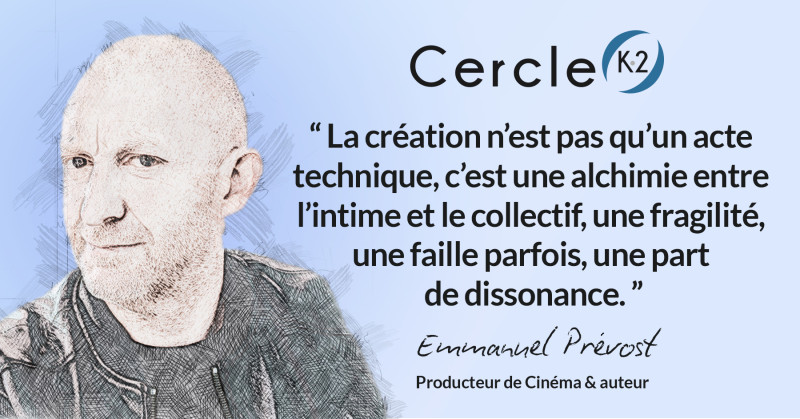La "police de proximité", histoire d’un renoncement français
05/11/2025 - 3 min. de lecture

Cercle K2对所有发布观点既不赞同也不反对,所有观点态度仅属于作者个人。
Vincent Hergott est Délégué national RAID, BRI et Déminage – Alliance Police Nationale.
---
La "police de proximité" : histoire d’un renoncement français
La police de proximité occupe une place singulière dans l’histoire récente de la sécurité publique en France. Souvent présentée aujourd’hui comme une illusion généreuse ou une expérimentation datée, elle fut en réalité l’une des dernières tentatives cohérentes pour renouer un lien organique entre l’État et les territoires. Son abandon ne relève pas uniquement d’une inflexion administrative, il signale une transformation de notre rapport à l’autorité, à l’espace social et au temps long de la prévention.
Entre 1997 et 2002, sous l’impulsion de Jean-Pierre Chevènement, un modèle ancré dans la présence quotidienne et la connaissance fine du terrain se met en place. Les équipes sont stables, identifiées, familières du quartier. Les policiers connaissent les habitants, les commerçants, les leaders informels, les trajectoires de vie, les fragilités, les tensions latentes. Contrairement à une idée répandue, il ne s’agissait pas d’un dispositif naïf mais d’un outil de compréhension sociale. Les interactions ordinaires, sur un trottoir, dans un hall d’immeuble, à la sortie d’un club de sport, produisaient un capital d’information irremplaçable, bien avant l’ère des tableaux de bord sécuritaires ou de la surveillance numérique.
Cette pratique reposait sur une évidence empirique ; la sécurité préventive dépend de l’information fine. L’intuition de Bacon, souvent citée, scientia potentia est, n'avait pas perdu de sa pertinence. Dans les faits, elle signifiait qu’un renseignement humain enraciné permettait d’intervenir avant la rupture, non après.
La réforme de 2003 marque un changement doctrinal net. La police de proximité est jugée trop sociale, trop diffuse, trop lente à produire des résultats visibles. Nicolas Sarkozy en fait un symbole d’inefficacité supposée. Dans le même temps, la France adopte une culture de performance fondée sur des indicateurs quantifiables (interpellations, élucidations, opérations visibles). Les Renseignements généraux disparaissent dans une restructuration plus vaste de l’appareil policier et la connaissance informelle du terrain perd son principal support humain et institutionnel.
Les arguments avancés alors se veulent pragmatiques. On cite les difficultés à mesurer l’effet dissuasif de la proximité dans un modèle piloté par le chiffre, la crainte de confusion des rôles entre travail policier et travail social, la volonté de recentrer l’action sur l’intervention. Ce tournant correspond à un mouvement observé dans d’autres démocraties occidentales à la même époque qui érigent l’efficacité rapide et visible en idéal de mode de fonctionnement de l'action publique. Mais en France, l’effet est accentué par une tradition centralisatrice et une défiance persistante envers les approches communautaires.
Les conséquences se sont déployées progressivement. Dans certains territoires, la présence policière s’est réduite à des apparitions ponctuelles, souvent en situation de tension. La communication entre habitants et forces de l’ordre s’est distendue. La perception de distance, déjà forte dans certains quartiers, s’est amplifiée. On a vu émerger un paradoxe. Plus l’État semblait visible lors des crises, plus il paraissait absent dans le quotidien. Cette forme de “présence-absence” a renforcé une gestion réactive plutôt que préventive, laissant se diffuser une défiance mutuelle.
Parallèlement, un autre acteur institutionnel s’est imposé : la police municipale. Présente au quotidien, au contact direct des élus locaux et des habitants, elle a progressivement assumé une fonction que la police nationale exerçait autrefois. Elle est souvent devenue, dans les faits, le premier vecteur d’alerte, l’acteur du signal faible, l’interlocuteur de proximité. Ce déplacement du centre de gravité de la sécurité locale s’est opéré sans toujours être pensé comme un choix stratégique, mais il traduit une réalité sociale. Là où l'État s’éloigne, la collectivité territoriale prend le relais.
Cette évolution soulève une question centrale : comment articuler aujourd’hui présence humaine, collecte d’information locale et autorité régalienne dans un environnement marqué par la complexification des menaces (violences urbaines, radicalisation, cyber-délinquance) et par la montée des attentes citoyennes en matière de transparence et de légitimité ? La réponse ne consiste pas à rétablir à l’identique un dispositif du passé, mais à réinventer l’esprit qui le guidait : celui d’une sécurité fondée sur la proximité sociale, la connaissance du territoire et la capacité d’anticipation, qualités qu’aucun outil statistique ni dispositif technologique ne peut totalement remplacer.
Une démocratie se protège durablement lorsqu’elle sait conjuguer autorité et présence, fermeté et compréhension, exigence et confiance. À défaut, elle substitue le contrôle à la relation et la puissance à la légitimité. L’expérience de la police de proximité rappelle que l’efficacité ne se résume pas à l'interpellation visible, mais s’évalue aussi dans ce qui ne survient pas comme les violences évitées, les crispations apaisées, la parole préservée.
L’enjeu n’est donc pas mémoriel mais stratégique. La connaissance humaine du terrain demeure un pilier du maintien du lien social. Sans cette capacité à voir, écouter et comprendre, l’État risque de demeurer présent par la force, mais absent par le sens.
05/11/2025