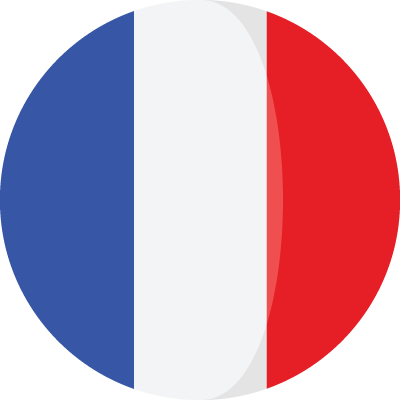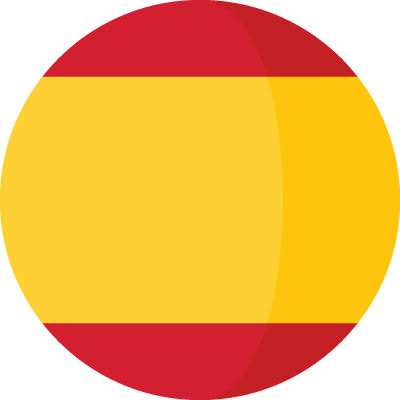Une société sous surveillance ou une société sans surveillance ? Paradoxe d’un dispositif de pouvoir en quête de sens
26/05/2014 - 17 min. de lecture

Cercle K2对所有发布观点既不赞同也不反对,所有观点态度仅属于作者个人。
La sécurité, les besoins qu’elle suscite, les caractéristiques qui la définissent et les mécanismes qui la mettent en œuvre, occupent une place incontournable dans l’espace politique de notre société actuelle. Ces dernières décennies ont connu une évolution majeure dans ce domaine : généralisation de la vidéosurveillance des espaces publics, volonté de « tolérance zéro » à l’égard de la délinquance, mise en œuvre de peines alternatives comme le bracelet électronique, etc. Le traitement actuel de la délinquance -que ce soit en amont du passage à l’acte avec l’émergence de discours préventionnistes, ou en aval avec une approche nouvelle de la pénologie, préfigurent des changements caractéristiques qui en disent long sur l’évolution de notre société. Car au travers de cette nouvelle approche de la sécurité et de la délinquance, n’est-ce pas d’un changement de paradigme social dont nous serions témoin ? Une nouvelle ère désavouant les mécanismes de pouvoirs socialisants que décrivaient Foucault et Deleuze à leur époque, au profit d’un nouveau modèle de pouvoir davantage en cohérence avec les nouvelles valeurs de notre société ?
De la société de discipline à la société de contrôle
De la fin du XVIIème siècle jusqu’au milieu du XXème, les mécanismes grâce auxquels la société met en œuvre les instruments de son contrôle sur l’individu sont décryptés par Michel Foucault dans Surveiller et punir[1]. Cette période qu’il baptise « société disciplinaire » a le projet de « concentrer ; répartir dans l'espace; ordonner dans le temps ; composer dans l'espace-temps une force productive dont l'effet doit être supérieur à la somme des forces élémentaires»[2]. La société soumet l’individu à son emprise par « l'organisation des grands milieux d'enfermement ». L’individu passe tout au long de sa vie d’un univers clos à un autre au sein desquels la société va l’astreindre à ses normes socialisantes. A l’image de l’école, de l’hôpital, de l’usine ou de la caserne, lieux dans lesquels s’expriment les normes et les codes dictées par les institutions qui les régissent, le territoire devient à l’échelle de la société le socle privilégié de l’exercice de la discipline dictée par la société. L’Etat met en place un maillage territorial, un quadrillage généralisé et subtil lui permettant d’exprimer universellement la souveraineté de sa loi, en maîtrisant les individus qui composent ses espaces ; à l’image d'un panoptique[3]. Métaphore de la société disciplinaire, le panoptisme matérialise l’idée d’une société au sein de laquelle la liberté individuelle s’articule autour d’un contrôle normatif omniprésent passant par la coercition des corps et au sein d’un espace déterminé, un territoire défini. Si les gardiens représentent l’exercice de ce pouvoir de contrôle et de surveillance à l’échelle carcérale, la police, est « l’appareil étatique qui a pour fonction […] de faire régner la discipline à l’échelle de la société » (Foucault, 1975). Dans un dispositif disciplinaire, le pouvoir se concentre sur l'individu en maîtrisant les outils de la contrainte des corps. Michel Foucault baptise ce dispositif la « biopolitique », et les mécanismes de sa mise en œuvre le « biopouvoir ».
La fin de la seconde guerre mondiale, voit naître un nouveau modèle social dominant. Expression prêtée à Gilles Deleuze afin de décrire le nouveau paradigme succédant à la société disciplinaire, la « société de contrôle »[4] redessine les contours de l’emprise de la société sur l’individu. Alors que la société disciplinaire intégrait l’individu au sein de milieux d’enfermement cloisonnés les uns vis-à-vis des autres, cette période voit au contraire naître un phénomène de décloisonnement des milieux d’enfermement. La conception de l’enfermement comme exercice du pouvoir est contesté et cette contestation prend prise dans différents domaines. Psychiatrique : en soignant les malades sans les exclure, carcéraux : en proposant au délinquant des peines alternatives à l’emprisonnement, sociaux : en légitimant le champ d’expression à des instances alternatives (syndicats, presse, etc.). L’objectif principal n’est plus de contraindre les individus en les soumettant aux règles que leur espace a mis en œuvre, mais « de gérer leur agonie et d'occuper les gens»[5]. L'État-Providence prend toute sa mesure. Il n’est plus contraignant mais bienveillant. Il construit des logements sociaux pour accueillir ses populations les plus défavorisées, il garantit la santé, la sécurité, et l’emploi. Il n’a plus vocation à dresser des remparts en excluant l’acte asocial perçu comme une remise en cause de sa propre légitimité. Il décloisonne les espaces, intègre l’individu aux mécanismes de socialisation en l’incitant à l’exemple vertueux de la société. L’emprise du pouvoir social dans la société de contrôle ne s'exerce plus tant sur l'individu que sur la population. S'appuyant sur le développement des outils statistiques, le pouvoir dessine les traits caractéristiques de sa population (sa natalité, sa morbidité, sa criminalité, etc.), analyse les tendances et définit les risques. Le contrôle s'exerce dorénavant de manière plus univoque et à travers une vision plus globale. Le pouvoir de contrôle pérennise le paradigme « biopolitique », en le décloisonnant, en le rationalisant et en le soumettant non plus au régime de l’individu mais à la globalité de sa population.
Révélateurs d'une époque, les événements de Mai 68 ont mis en exergue les aspirations d’une société française en quête d’elle-même. Ces événements furent le trait d’union de deux époques : la contestation visible et bruyante de la société disciplinaire, et les balbutiements d’une ère encore en gestation : la nôtre. Ces événements furent portés par les générations nées après la Seconde guerre mondiale. Elles en ont digéré les horreurs et ont contribué à la sacralisation des principes immuables et universels des droits de l’Homme. Elles ont magnifié les valeurs de libéralisme individuel, moral, social et politique (« il est interdit d’interdire ») en les opposant au modèle dominant de l’époque, celui de la société de contrôle, d’un Etat-Providence apparaissant omniprésent, étouffant, obstacle à l’épanouissement individuel. En examinant l’histoire de cette époque à l’aune de la nôtre, la société de contrôle qui a marqué la seconde moitié du XXème siècle, pourrait n’avoir en réalité été que la transition entre la société disciplinaire, et notre société actuelle qualifiée de postmoderne. Ces quelques décennies ont vu germer les fondations de notre ère : la place croissante de l’économie libérale, l’accroissement de la place des réseaux au détriment des territoires et l’évolution des valeurs humaines dominantes. Ces trois facteurs ont servi de socle à ce l’on nomme aujourd’hui la mondialisation.
L’éclosion d’une société nouvelle
La mondialisation a germé sur les cendres de l'éclatement du bloc soviétique. Les modèles économiques occidentaux se sont exportés dans les ex-pays communistes exsangues, au point de convertir la quasi-totalité du monde au libéralisme néo-libéral. Les débouchés économiques et les opportunités ont fleuri et les flux et les réseaux se sont multipliés. Plus aucun obstacle ni idéologique, ni politique ne pouvait plus alors se dresser sur le chemin de la globalisation. Les mutations qui ont accompagné le phénomène de la mondialisation ont consacré des changements sur tous les fronts de notre société moderne. Changements économiques d’abord : scellant l’enterrement de l’ère industrielle au profit de l’ère globalisée et numérique ; changements politiques ensuite : la lente érosion du modèle de l'État-Providence et l’avènement inéluctable d’un modèle libéral ; changements philosophiques : le XXème siècle a vu rayonner le principe de l'universalisme de l'Homme et de ses droits ; changements sociétaux enfin : ces mutations ont ébranlé les distinctions traditionnelles entre espace public et espace privé. Derrière ce changement de paradigme politico-économique et l’agitation des mutations engendrées par la mondialisation se dessinent d’autres évolutions dont la portée peut encore nous échapper, et dont les conséquences sont encore difficiles à lire. En effet la mondialisation portée par sa matrice des flux et des réseaux a bouleversé nos rapports sociaux et sociétaux. Rapport à l’autre d’une part : les interconnexions entre les individus sont devenues les nouvelles valeurs de la sociabilité moderne ; rapport au pouvoir d’autre part : les liens qui unifiaient une population à ses institutions se déforment sous le poids des flux.
Les rapports qu’entretiennent les individus entre eux, avec le pouvoir ainsi qu’avec la société apparaissent de plus en plus difficile à décrypter au regard des grilles de lecture traditionnelles. Le vent de la mondialisation a soufflé sur les Etats, chassant peu à peu un modèle d'État-Providence et apportant celui d’une vision néo-libérale à l’anglo-saxonne de la société. Poussés par les avancées technologiques, cette vision a su s’imposer dans les sociétés occidentales en favorisant le développement des flux commerciaux financiers, puis de communication et d’information. Ces flux se sont multipliés, se sont accélérés au point de devenir la matrice du monde actuel, au service des intérêts privés formés par les réseaux d’agents concepteurs et utilisateurs de ces flux. Ces agents (banques, firmes multinationales, médias, individus, etc.) sont peu à peu devenus les nouveaux acteurs d’un monde dématérialisé et autorégulé. Peu à peu et sous l’influence réciproque des valeurs dominantes et de la libéralisation des échanges de toute nature, cette matrice s’est étendue indifféremment dans tous les espaces sociétaux, modifiant corrélativement le rapport de l’individu à son environnement. Ainsi, la séparation traditionnelle entre les espaces publics et privés se distingue moins nettement. Le rapport entretenu entre l’homme et son pouvoir se teinte d’ambiguïté : chassant la contrainte de son emprise, voire même sa légitimité, tout en réclamant qu’il lui garantisse la protection de cet espace de liberté et d’épanouissement.
Ces changements préfigurent une nouvelle approche en termes de dispositifs de pouvoir en général, et en termes de sécurité en particulier. L'État, qui auparavant avait pour tâche la régulation socio-économique des territoires et des populations dont il avait la charge s’est donc lentement transformé en agent de protection de cette autorégulation. En termes politiques, ces mutations se sont traduites par une approche différente du pouvoir vis-à-vis de l’individu. Le pouvoir n’a plus vocation « à gérer la vie » mais à « laisser vivre ». Les institutions traditionnelles de l'État-Providence avaient pour fonction de protéger l’individu contre les risques sociétaux. Désormais, l'État aspire moins à tuteurer l’individu qu’à protéger la liberté de son espace social ; espace au sein duquel les flux et les réseaux peuvent se mouvoir librement, s’étendre sans barrière et se développer sans contraintes. Mais comment exercer cette fonction de protection indispensable à l’épanouissement de la liberté sans dans un même mouvement, empiéter sur cette dernière et contredire sa propre nature?
La société de surveillance : typologie et paradoxe
L’une des caractéristiques majeures de la biopolitique était de cloisonner les espaces sociaux selon la dichotomie public/privé. Les pouvoirs disciplinaire puis de contrôle projetaient leurs prérogatives socialisantes dans les espaces publics, tandis que l’individu déployait son propre univers social relativement à la place que lui octroyait ce pouvoir, mais en intégrant à chaque fois ces normes socialisantes venues d’en haut. Les institutions avaient pour vocation (c’est-à-dire qu’il en avait la fonction et la légitimité) d’une part de maîtriser les espaces publics et d’autre part de maintenir les écarts entre les espaces publics et privés tout en déclinant à chaque échelon les pouvoirs et les normes qui les régissent. De l’Etat à la famille, en passant par l’école et l’entreprise, l’individu est soumis à un ensemble de micro-pouvoirs reproduisant les normes socialisantes récurrentes destinées à définir son statut, délimiter son action et encadrer son espace de liberté. En quelque sorte, l’individu procédait du pouvoir. Il ne trouvait sa propre essence sociale qu’au regard de sa capacité à assimiler les normes de l’espace public et de sa faculté à intégrer et à reproduire ces normes dans ses espaces privés.
Si elles en ont fait bouger les lignes, les variations ressenties au passage de la société disciplinaire à la société de contrôle n’ont pas remis en cause cette dualité des espaces sociaux. La société actuelle pourtant, a renversé ce modèle. La distinction classique entre espace privé et espace public n’a plus réellement de sens. Influencé par les changements politiques, économiques et sociaux, les degrés de socialisation de l’individu ne se mesure plus tant à sa faculté d’intégration, c’est-à-dire à sa capacité à intégrer les normes socialisantes définies dans l’espace public et à les décliner dans sa sphère privée, qu’à sa faculté de connexion sociale, c’est-à-dire à sa faculté à mettre en réseau et à se mettre en réseau. Les normes sociales ne se déclinent plus selon un schéma pyramidal qui procéderait du pouvoir institutionnel, mais selon une matrice complexe au centre de laquelle se trouve l’individu qui construit son propre espace socialisant par les connexions qu’il opère au sein de son environnement.
A présent, les corps et les flux doivent pouvoir s'exprimer et circuler librement dans des espaces affranchis – qui ne sont donc plus ni privés ni publics, et vidés a priori de tout contenu socialisant ou contraignant. L’individu en considération de son environnement intime (qui possède dès lors une valeur quasi-sacrée), découvre son propre espace ; ou plutôt les différents espaces au sein desquels il va se façonner socialement. Tout refus d’accès à un espace lui apparaît alors comme discriminant, comme « une norme qui encode le flux » aurait dit Deleuze. La société n’obéit plus à la construction verticale des sociétés disciplinaire et de contrôle, mais répond plutôt à une logique horizontale au sein de laquelle le pouvoir n’occupe plus la même fonction. La biopolitique telle que décrite par Michel Foucault n'est plus le paradigme autour duquel s’articulent les dispositifs de pouvoir. Les institutions n'ont désormais plus la vocation de contraindre les corps, de normaliser les flux et de cloisonner les espaces. Elles n’en ont plus ni le pouvoir, ni la légitimité. Les espaces sont libres et se définissent eux-mêmes. Le rôle actuel du pouvoir est dès lors non plus de définir des espaces sociaux (qu’il ne maîtrise plus et qui ne lui appartiennent plus), mais de fluidifier les accès des flux et des corps aux espaces, en estompant tant que faire se peut les contraintes. Cette démarche de fluidification par laquelle le pouvoir exprime aujourd’hui sa fonction se résume au travers de deux voies singulières. L’une que l’on qualifierait de positive vise à faciliter les flux, à libérer les espaces au sein desquels l’individu pourrait évoluer (physiquement, économiquement, intellectuellement, spirituellement, etc.) et donc se façonner socialement. Cette démarche se caractérise par exemple par la reconnaissance de droits spécifiques à certaines communautés ou à la lutte contre les discriminations. L’autre, que l’on pourrait qualifier de négative vise à combattre les menaces qui pourraient s’exercer sur ces flux. Or, ne pouvant exercer de pouvoir normatif et contraignant sur les flux eux-mêmes sans se contredire, les institutions opèrent sur les espaces dans lesquels évoluent ces flux. Le pouvoir ne se décline donc plus sur l’ensemble du spectre social comme il le faisait dans la société de contrôle, en agissant dans tous les domaines qui façonnaient l’individu socialement. Son autorité et sa légitimité se concentrent désormais sur la protection des espaces. Cette protection devient donc quasi-exclusivement de type sécuritaire, c’est-à-dire qu’en se focalisant moins sur les facteurs socialisants que sur les espaces dans lesquels ils s’exercent, le pouvoir délaisse ses champs traditionnels de socialisation pour ne mettre en œuvre son action que sur les registres de la sécurité dédiée aux espaces. La fonction sécuritaire du pouvoir occupe donc une place incontournable dans la société actuelle, et les menaces qu’elles combattent deviennent une préoccupation toujours croissante.
Alors que la société de contrôle était une société de gestion globale du risque alimentée par des outils rationnels d'analyse dédiée à sa population, la société postmoderne définit son mode de gouvernance autour d’une gestion de la menace, s’articulant à la fois sur la surveillance des espaces, et sur la définition perpétuellement renouvelée de cette menace intangible[6]. A une perception subjective opérée sur la population dans la société de contrôle, la société actuelle lui préfère une vision objective fondée sur l’analyse de la menace, sur une surveillance des espaces, puis la détection des menaces précédemment définies dans ces espaces, avant de les neutraliser.
C’est sans doute la raison pour laquelle la délinquance occupe à plusieurs titres une question centrale de notre société. Non seulement elle illustre cette menace pesant sur les espaces et sur leurs caractéristiques fondamentales : leur fluidité et leur liberté ; mais de surcroît elle suscite un intérêt particulier de la part du pouvoir dont la concentration des énergies sur les questions de sécurité et de protection des espaces est devenue la fonction principale.
C’est cet ensemble complexe - où s’enchevêtrent la quête permanente d’une libéralisation des espaces et la place prégnante d’un pouvoir qui cherche à contenir cette liberté des espaces dans des dispositifs de sécurité en constante définition - que l’on nomme la société de surveillance.
Le délinquant de la société disciplinaire et de contrôle manifestait son refus conscient ou inconscient de la conformité humaine au modèle dominant. Les dispositifs de pouvoir avaient pour fonction de juger de son degré d’asociabilité, et de mettre en œuvre un ensemble de mesures plus ou moins coercitives destinées à « dresser » ou à contrôler cette déviance sociale. Les institutions, la prison ou l’hôpital psychiatrique par exemple, avaient cette charge difficile et noble de modeler le délinquant pour en faire un être social et intégré.
La société de surveillance ne considère plus le délinquant comme le faisait les dispositifs disciplinaire et de contrôle, c’est-à-dire en analysant son asocialité ou sa psychologie. Elle vise non plus à punir et rétablir le délinquant, mais à protéger les espaces de liberté du danger qu’ils incarnent ; non plus le risque de l’asociabilité de l’individu mais la menace de son comportement, dont le degré de déviance incarne la vulnérabilité de la société. Derrière la menace que représente le délinquant (que l’on décrit parfois sous les traits du récidiviste ou du pédophile, illustrations symboliques dans l’imaginaire collectif du délinquant/ danger social) se cache l’impossibilité de la société à avoir pu déceler le comportement déviant. Ils incarnent la menace de la liberté totale. Les courants de pensée actuels dans les domaines de la criminologie et de la pénologie s’inscrivent dans cette évolution[7]. Elles démontrent la volonté de contraindre le passage à l’acte criminel. On s’interroge moins sur les causes « subjectives » du passage à l’acte : pauvreté, éducation, psychologie ou origine sociale, que sur ses causes « objectives » : vulnérabilité des biens et des espaces, absence de dissuasion et de suivi des peines, etc. Pour y faire face, le pouvoir s’attache alors à mettre en place différents dispositifs de surveillance de ces comportements qui seront destinés tout d’abord à mieux les réprimer, mais surtout à les dissuader par la systématisation de ces dispositifs dans tous les espaces. La force de l’œil (physique ou moral) posé sur l’individu aurait pour effet de détourner sa volonté de passage à l’acte.
C’est ainsi que la société de surveillance, nouveau paradigme de pouvoir de notre société postmoderne, prend toute sa mesure : coincée entre la quête d’une liberté totale que le pouvoir cherche à promouvoir, et la quête d’une protection totale de cette liberté qu’elle tente vainement de satisfaire ; enfermée dans ce paradoxe que l’une ne peut exister sans l’autre mais que l’une et l’autre se détruisent réciproquement. Cette contradiction explique sans nul doute que la sécurité fasse l’objet à la fois d’une demande toujours plus prégnante, mais occupe aussi une place si controversée et si embarrassante dans notre société.
Foucault et Deleuze soulignaient le paradoxe de la biopolitique à travers le système carcéral qu’ils considéraient comme étant une fabrique de la délinquance. Deleuze affirmait : « la prison échoue, puisqu’elle fabrique des délinquants. Je dirais plutôt : elle réussit, parce que c’est ce qu’on lui demande »[8]. Or, ce paradoxe préfigure aussi celui de la société de surveillance. Par analogie, la société de surveillance pourrait en effet se déterminer ainsi : « On dit que la surveillance échoue puisqu’elle n’empêche pas le passage à l’acte délinquant, on dirait plutôt : elle réussit parce que c’est ce qu’on lui demande ». En effet l’échec inconscient de la surveillance devient le succès de la société de surveillance car elle justifie inconsciemment la liberté totale dont elle procède. En outre son échec tactique devient sa victoire stratégique : chacun de ses échecs légitime un peu plus à chaque fois l’illusion du besoin impératif de la sécurité totale qu’elle tente chimériquement d’atteindre. Le paradoxe de la société de surveillance devient donc sa raison d’être.
---
[1] Foucault, M. (1975). Surveiller et punir. Gallimard.
[2] Deleuze, G. (1990, mai). Post-scriptum sur les sociétés de contrôle. L'autre journal , n°1.
[3]Cette architecture carcérale imaginée par Jeremy BENTHAM (Le Panoptique, 1780) est formée d’un bâtiment en anneau composée des cellules et de leurs prisonniers, et d’une tour centrale dédiée à la surveillance offrant une vue à 360°, sur toutes les cellules. Les prisonniers constamment visibles depuis leur cellule sont soumis à l’hypothèse permanente de la surveillance. Les gardiens exercent un contrôle aléatoire mais systématique sur toutes les cellules et leurs occupants.
[4] Pour la même période, Gilles Deleuze parle de la société de contrôle (Deleuze, G. (1990). Pourparlers. Les éditions de minuit.), quand Michel Foucault parle de société sécuritaire (Foucault, M. (1977-1978). Sécurité, territoire, population, Cours au Collège de France. Hautes Etudes Gallimard, Seuil). Nous retiendrons la première expression qui semble mieux appropriée.
[5] Deleuze, G. (1990, mai). Post-scriptum sur les sociétés de contrôle. L'autre journal , n°1.
[6] La notion de « nouvelles menaces », est apparue comme un critère empirique illustrant les malveillances qui de part leur nature même, remettent en cause notre fonctionnement social moderne. On y trouve indifféremment la menace terroriste, criminelle, les risques de piraterie maritime ou sur internet, ou bien encore les atteintes sanitaires et environnementales. En d’autres termes, elles représentent les facteurs qui déstabilisent sciemment ou non, notre liberté des flux et des corps dans des espaces donnés.
[7] Brantingham, P., & Brantingham, P. (1981). Environmental Criminology. Beverly Hills: Sage Publications.
[8] Deleuze, G. (1990, mai). Post-scriptum sur les sociétés de contrôle. L'autre journal , n°1.
---
26/05/2014