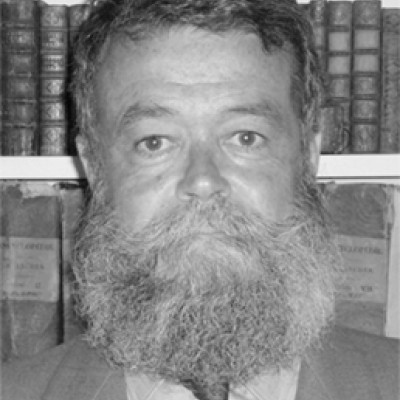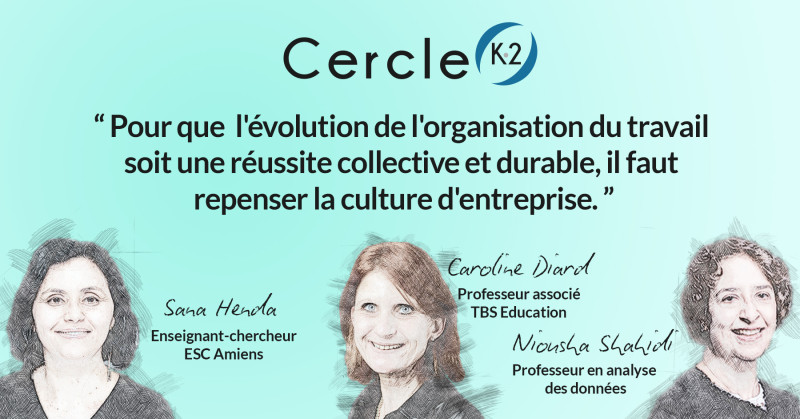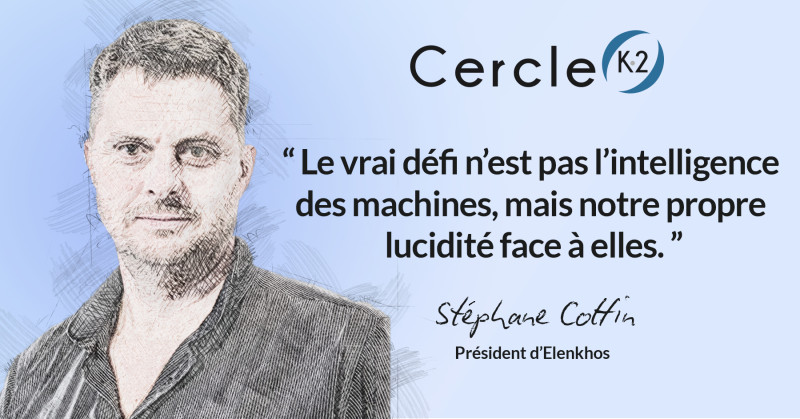Du gouvernement des hommes, de la conduite de l’État et du bon régime politique
23/10/2025 - 15 min. de lecture
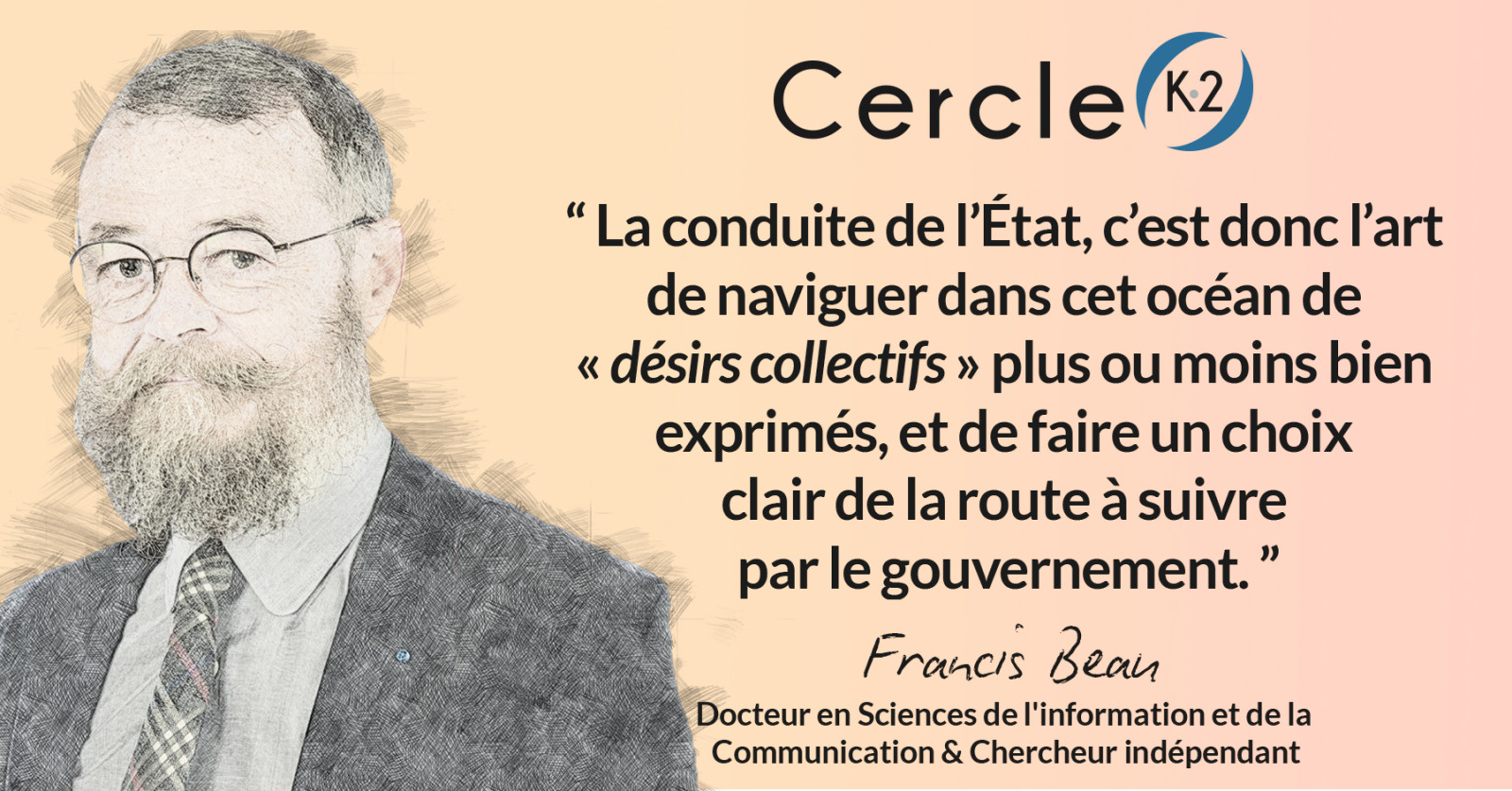
Le Cercle K2 n'entend donner ni approbation ni improbation aux opinions émises dans les publications (écrites et vidéos) qui restent propres à leur auteur.
Francis Beau est Docteur en Sciences de l'information et de la Communication & Chercheur indépendant.
---
Au fond, comme chef de l’État, deux choses lui avaient manqué : qu'il fût un chef ; qu'il y eût un État (de Gaulle à propos du président Lebrun en 1940)[1]
Gouverner c’est prévoir, nous dit le proverbe. Pour être plus précis, je dirais que gouverner, c’est engager l’avenir sur lequel seul nous pouvons agir, quand le présent, enfant du passé, n’est plus en notre pouvoir dès qu’il advient. Agir, c’est anticiper et décider d’exercer un effet sur l’avenir. C’est décider à chaque instant d’un futur possible qui demeure toujours incertain dans l’instant présent. Mais pour agir et engager l’avenir d’un pays, encore faut-il, si l’on en croit le fondateur de notre Ve République, qu’il y ait un « chef » pour en assurer la conduite et un « État » à la mesure de l’entreprise. C’est là tout l’enjeu du gouvernement des hommes, de la conduite de l’État et du régime apte à diriger la cité, soit celui de la politie[2] aristotélicienne.
Dans une chronique récente, Nicolas Baverez nous alerte sur la crise que traverse notre pays. « Nous ne vivons plus une crise politique mais une crise de régime. La France est un bateau ivre, privée non seulement de gouvernement, de majorité, de budget, mais aussi d’État en raison d’une instabilité de l’exécutif […] qui interdit tout redressement du pays »[3]. À condition de redonner à la Politique avec un grand « P » toute la grandeur qu’elle mérite et toute la profondeur à laquelle nous invite Aristote, c’est pourtant bien d’une crise Politique qu’il s’agit, impliquant tout ensemble, le gouvernement, la conduite de l’État et le régime politique.
Considérations théoriques
Gouverner, dans le langage maritime, c’est stricto sensu, manœuvrer une embarcation ou un bâtiment au moyen de son appareil à gouverner. En eau libre, c’est tenir un cap. Gouverner un peuple, c’est donc au sens strict, manœuvrer le "vaisseau"[4] nommé État sur lequel il est embarqué, pour le maintenir sur la route de l’intérêt général. Gouverner un pays, c’est ainsi alterner les coups de barre à droite et à gauche de la route pour maîtriser la bonne marche du vaisseau État chahuté par le vent de l’histoire, des courants politiques contraires, et une mer agitée de destins entrecroisés. Gouverner une nation, c’est mettre la barre de l’État à droite puis à gauche, afin de le maintenir sur sa route en gardant le cap requis par le peuple souverain, celui de l’intérêt général, malgré les éléments défavorables qui voudraient l’en éloigner.
Mais, gouverner, en termes maritimes, ce n’est pas naviguer ou conduire le bâtiment vers sa destination en le situant sur la carte et en traçant la route à suivre : ce n’est ni piloter, ni commander le navire. Gouverner des hommes, si c’est bien stricto sensu tenir un cap, ce n’est donc pas comme on l’entend souvent dans un sens plus large, décider du cap à tenir ou déterminer la route à adopter : c’est seulement se contenter de la suivre. Le chef du gouvernement, le Premier ministre, premier des serviteurs de l’État et chef de tous les ministres, c’est l’homme de barre du vaisseau État. Le gouvernement d’un peuple, est un organe tout d’exécution, dont l’activité s’avère fondamentalement binaire, alternant coups de barre à droite et à gauche pour suivre une route prescrite, tracée par l’autorité en charge de la conduite de l’État, même si cette route est parfois aussi difficile à suivre qu’à tracer.
La conduite de l’État, c’est l’art de diriger ce vaisseau emportant le peuple vers un destin qu’il se choisit en toute liberté, afin de satisfaire cet « ensemble réfléchi et hiérarchisé de désirs collectifs, fait de connaissances et de choix » qui, « associé à une conscience aigüe de l’impérieuse nécessité de compter avec l’autre »[5], fait la bonne politique. Conduire le vaisseau de l’État, ce n’est pas seulement le gouverner en gardant le cap sur la route de l’intérêt général, c’est en démocratie, le diriger en s’orientant dans cet océan collectif de désirs individuels plus ou moins contradictoires exprimés par le peuple souverain. L’habileté de l’homme de barre et la compétence de son gouvernement sont essentielles pour la tenue de route, mais le choix du cap à suivre n’est pas de sa compétence, et son efficacité est étroitement liée à son pouvoir de décision dans l’action qui ne peut être entravé par d’autres sollicitations que celles de l’autorité en charge de la conduite de l’État. C’est au peuple de décider de son destin, à l’État de lui fournir le moyen de faire route pour l’atteindre, et à son chef d’en assurer la conduite.
La conduite de l’État, c’est donc l’art de naviguer dans cet océan de « désirs collectifs » plus ou moins bien exprimés, et de faire un choix clair de la route à suivre par le gouvernement. Celle-ci, parfois bien sinueuse, serpente toujours entre les deux grands courants de la scène politique internationale contemporaine en partie hérités de l’Antiquité gréco-romaine, un socialisme démocratique mondialisé progressiste et idéaliste sur la gauche de l’échiquier politique, et un civisme républicain souverainiste, conservateur et réaliste sur sa droite.
Tout comme le gouvernement d’un pays qui tient le cap en manœuvrant la barre à droite puis à gauche, la conduite de l’État est ainsi une activité intrinsèquement binaire, opposant la droite à la gauche dans un dualisme qu’il convient de considérer, pour exploiter avec bonheur l’alternative de ces deux grands courants et profiter pleinement de leur complémentarité. Sur la route sinueuse de l’intérêt général, il s’agit de naviguer dans l’immensité de l’océan Politique, ainsi nommé en référence à la politie aristotélicienne, ce régime idéal auquel aspirait le précepteur d'Alexandre le Grand. Un tel régime politique prendrait ainsi la forme d’une sorte de monarchie aristocratique, tenue à l’abri de toute dérive tyrannique ou oligarchique grâce aux vertus démocratiques d’une route tracée par le peuple dans une quête permanente de cette grande "Cause publique" républicaine qu’est l’intérêt général. Le choix de la route à suivre n’y serait pas l’œuvre du gouvernement, mais celle du peuple souverain, qui l’exprimerait par la voix de son chef, le chef de l’État.
La conduite de l’État sur la route de l’intérêt général, comme le gouvernement de la nation qu’il embarque sur un océan Politique souvent tourmenté, impose de « naviguer sur l’avant », selon l’expression consacrée par les marins qui savent l’importance de l’anticipation dans la conduite du navire. Anticiper, c’est décider d’un futur possible afin de se mettre en situation d’en assumer les effets. Or le futur est toujours singulier. La décision ne s’accommode guère du « en même temps ». Il faut choisir parmi plusieurs possibles, celui qu’il convient de privilégier, et celui-ci est irrémédiablement unique. L’action, contrairement à la réflexion qui peut la précéder, est toujours le résultat d’un choix ou d’un enchaînement de choix fondamentalement binaires. C’est une succession d’instants opportuns (le kairos grec) auxquels correspondent autant de décisions à prendre, d’alternatives qu’il convient de trancher en n’en conservant qu’une au détriment de l’autre. L’action politique n’échappe pas à la règle, qu’elle soit destinée à la tenue de cap ou à la détermination de la route à suivre. C’est la raison pour laquelle, en démocratie, la souveraineté populaire doit pouvoir pleinement s’exercer sur le choix du chef de l’État et de la route qu’il va tracer, puis sur la bonne exécution de cette trajectoire par le gouvernement qu’il dirige. L’un comme l’autre, le choix de la route et le contrôle de son exécution doivent être pleinement assumés par le peuple souverain doté d’un pouvoir de décision que seule permet une bipolarisation de la vie politique adaptée à cette dualité de l’action.
C’est en effet dans le choix de cette route ou du chef de l’État qui la trace, qu’intervient le risque de dérive démagogique soulevé par Aristote. Ce risque est inhérent à la nature même de ces "vertus démocratiques" hissant le peuple au rang de monarque absolu. C’est donc en premier lieu, au mode d’expression de ce choix, et donc à la méthode de sélection par le peuple du chef de l’État, qu’il convient de réfléchir. Sans légitimité dynastique permettant d’échapper aux dérives démagogiques qui risquent de parasiter le suffrage universel, il semble en effet indispensable de se concentrer sur les modalités d’exécution de ce choix. À cet effet, l’alternative présentée par la dualité des deux grands courants irriguant le monde politique contemporain, qui s’opposent chez nous dans la partition droite-gauche, doit être considérée avec toute l’attention qu’elle mérite : c’est elle qui est garante de l’alternance indispensable au fonctionnement démocratique du régime.
C’est sur la base de cette bipolarisation de la vie politique que l’alternance démocratique peut selon moi être pensée aujourd’hui. Ce serait donc, dans un premier temps, une alternative qu’il convient de trancher par le suffrage universel direct pour donner au peuple le moyen de choisir le courant politique à adopter et sélectionner ainsi le chef capable de déterminer la route à suivre et de nommer un gouvernement rallié à ce courant. Dans un second temps, l’enjeu serait de donner au peuple le moyen d’assurer le contrôle du suivi par le gouvernement de la trajectoire ainsi définie dans le respect de la volonté populaire, par un chef de l’État élu. C’est là qu’intervient le Parlement, dont le rôle n’est pas d’entraver l’action légitime du gouvernement mais de la contrôler. Seule une opposition rassemblée derrière un chef incontesté capable de proposer une alternative crédible au chef de l’État en fonction et à son gouvernement peut prétendre avoir vocation à assurer ce contrôle avec une efficacité suffisante pour contrer toute sorte de dérive et en particulier toutes celles qui résulteraient de la non tenue de promesses électorales purement démagogiques.
Analyse d’un cas pratique
Plus personne ne veut gouverner, parce que tout le monde veut le pouvoir, qui semble facile à ramasser.(Dominique Reynié, à propos de la crise du pouvoir actuelle)[6]
Assiste-t-on dans notre pays, en cette fin de premier quart du XXIème siècle, à une crise de régime, à une crise de l’État, ou à une véritable crise Politique, au sens de la politie aristotélicienne ? Celle-ci impliquerait tout ensemble, gouvernement, conduite de l’État et régime politique, et ne serait en réalité qu’une crise de pouvoir doublée d’une crise de l’autorité fondant sa légitimité.
Comme j’ai tenté d’en établir précédemment les prémisses, ce n’est que sur la base d’une bipolarisation de la vie politique que la souveraineté populaire peut être en mesure de s’exprimer pleinement. Cela demeure sans doute possible, sans changement de régime, en restant dans le moule global de nos institutions actuelles de la Ve République telles que nous les a léguées le général de Gaulle, à condition qu’elles en retrouvent l’esprit d’origine, soit celui d’un régime semi-présidentiel. Celui-ci doit séparer nettement le rôle du chef de l’État élu au suffrage universel direct, de celui du parlement devant lequel le gouvernement nommé par lui est responsable. C’est le marquage clair de cette séparation qui permet d’assurer en toute légitimité l’efficacité d’un gouvernement acquis au chef de l’État, fort de la majorité du parti au nom duquel il s’est présenté devant le peuple souverain. Mais cette efficacité qui fait sa force est en même temps largement tempérée par une opposition tout autant légitime en tant que telle, et forte de son unité garante également d’efficacité. Une telle bipartition oppose aux États-Unis les démocrates aux républicains, comme elle opposait naguère en France, de manière purement formelle il est vrai, la droite à la gauche.
En s’effaçant aujourd’hui, dans notre pays, au profit d’une tripartition paralysante, la droite comme la gauche sont repoussées à des extrêmes qui les rendent infréquentables. Une telle tripolarisation du jeu politique insère en effet entre les deux partis, un centre censé modérer les prises de position par une pratique du « en même temps » systématique, qui ne fait en réalité qu’interdire les choix clairs et suffisamment tranchés pour donner au peuple la possibilité d’exprimer sa volonté. Face au pouvoir en place, quel qu’il soit, qu’il soit de droite, de gauche ou du centre, se dressent alors, non plus une, mais deux oppositions, la droite populaire et un "front républicain" en perpétuelle reconfiguration pour rejeter cette droite infréquentable hors du champ politique. Cette dernière serait en effet la manifestation d’un populisme hideux flirtant avec le fascisme tandis qu’à gauche, l’électoralisme flirtant avec l’islamisme, le racisme et l’antisémitisme serait tout-à-fait "républicain". L’opposition gauche-droite, s’éparpille dès lors au profit de multiples partitions à géométrie variable plus ou moins versatiles, au point qu’aucune véritable alternance ne peut plus advenir et que notre démocratie ressemble de plus en plus à un régime à parti unique, celui du camp du bien.
Cette tripartition de la vie politique associée à une « fabrique du consentement » que j’ai évoquée dans une tribune précédente[7], contribue en effet à façonner un « extrême-centre », à partir de cet « en même temps » systématique, « ni de droite, ni de gauche, mais entre les deux, qui exclut toute alternative claire et suffisamment tranchée pour donner au peuple la possibilité de s’exprimer pour choisir ses représentants en toute connaissance de cause ». Tout débat contradictoire tranché avec un autre camp qui ne « consentirait » pas devient alors suspect, tout affrontement bipartisan suffisamment marqué est condamné, toute majorité claire s’avère ainsi improbable et pire, toute décision stratégique courageuse indispensable à l’action en politique devient impossible. La recherche perpétuelle du consentement pousse inévitablement le peuple à l’impuissance et ses représentants à l’inaction. « La nature ayant horreur du vide, le pouvoir ainsi vidé de son sens, risque alors de tomber comme un fruit mûr entre les mains de manipulateurs mieux avisés, mais pour le coup moins soucieux de la souveraineté populaire ».
Le retour à un bipartisme reflétant l’alternative désormais largement répandue sur la scène politique contemporaine à l’échelle mondiale, qui opposerait, non plus comme naguère le collectivisme au capitalisme, mais une gauche démocrate sociale, progressiste, mondialiste et idéaliste, à une droite républicaine civique, conservatrice, souverainiste et réaliste, permettrait d’assurer la complémentarité entre gouvernement et opposition indispensable au bon fonctionnement de la démocratie. Celle-ci s’exercerait alors au sein d’un régime tel que nous le suggère Aristote, en forme de monarchie républicaine de nature aristocratique, et serait ainsi enfin débarrassée des effets paralysant de ses dérives démagogiques.
La Ve République est « un régime à logique majoritaire », comme le rappelait le comité consultatif pour la révision de la constitution, dans son rapport de 1993. « Son équilibre institutionnel repose sur la constitution d’une majorité parlementaire claire, issue du suffrage universel, qui donne au gouvernement les moyens de gouverner ». L’équilibre sur lequel reposait le régime s’est brisé : « si la droite et la gauche n’ont pas disparu, elles sont l’une et l’autre minoritaires, au point que, même réunies, elles ne formeraient qu’une force d’appoint » nous dit encore Dominique Reynié. « Le bloc central du parti unique est en voie d’effondrement », mais, « les deux forces protestataires semblent avoir le vent en poupe »[8], dans les urnes pour l’extrême droite, dans la rue pour l’extrême gauche. C’est la bonne nouvelle du jour, les Français semblent résister à la dictature « douce » du parti unique qui semble perdre de sa « douceur » au fur et à mesure que la résistance croît. Souhaitons seulement que la crise Politique actuelle puisse se dénouer dans les urnes plutôt que dans la rue.
En ce début de XXIème siècle, notre pays a inventé la politique quantique. Comme la physique quantique utilisant le comportement physique singulier des « bits » quantiques, « chiffres binaires » quantiques ou qubits qui, contrairement aux bits classiques limités aux deux états binaires zéro ou un, peuvent être « en même temps » zéro et un, elle utilise le comportement politique singulier des « partis binaires » quantiques, « bips » quantiques ou qubips qui, contrairement aux bips classiques limités aux deux états binaires de droite ou de gauche, peuvent être « en même temps » de droite et de gauche. Comme l’utilisation des qubits en physique, qui augmente considérablement la puissance des calculs algorithmiques, l’utilisation des qubips en politique augmente considérablement la puissance des calculs électoraux. Souhaitons dès lors que l’utilisation de ces qubits, ne fasse pas tout autant augmenter la puissance du chiffre univoque, comme celle des qubips pourrait considérablement augmenter la puissance du parti unique si celui-ci ne s’effondrait pas sur lui-même comme il semble risquer de le faire en France chaque jour un peu plus, dans les urnes ou pire, dans la rue. La toute-puissance du chiffre univoque risquerait alors de transformer une intelligence vive en aveuglement insidieux, comme celle du parti unique transforme à coup sûr une démocratie « forte » en dictature de moins en moins « douce ».
« Partager le pouvoir avec le Parlement, voici, incontestablement, une rupture », nous annonce en effet le chef du gouvernement dans son discours de politique générale du 14 octobre 2025, devant l’Assemblée nationale. « Le gouvernement proposera, nous débattrons, vous voterez », assène-t-il en se défaussant de la décision finale sur le Parlement. Selon sa conception de la répartition des pouvoirs « l’Assemblée nationale et le Sénat restent l’endroit du pouvoir de décision, du pouvoir d’agir », au détriment du gouvernement qui se contenterait d’exécuter les décisions du Parlement. C’est oublier la nature dyarchique de notre régime semi-présidentiel, qui cumule les pouvoirs d’un chef de l’État élu au suffrage universel, chargé par le peuple de naviguer dans le vaste océan Politique sur la route de l’intérêt général, et ceux d’un chef de l’exécutif nommé par lui, pour tenir le cap ainsi établi. Si son gouvernement est bien responsable devant le Parlement qui en contrôle l’action, afin d’interdire toute sortie de route tyrannique, oligarchique ou démagogique, il ne peut en aucun cas se défausser sur celui-ci des décisions qui lui reviennent pour gouverner sur la route de l’intérêt général établie par un chef de l’État dont la légitimité exprimée par le vote procède directement du peuple.
---
[1] Charles de Gaulle, Mémoires de guerre, vol. III, Le Salut : 1944-1946, Paris, Pocket, 2006, p. 31-32.
[2] Du grec ancien πολιτεία / politeia, « régime politique ». Dans la Politique, Aristote à la recherche du régime politique idéal, préconise une politie qui serait un régime mixte alliant conduite monarchique, gouvernance aristocratique et procédures démocratiques en les gardant de leurs dérives respectives tyrannique, oligarchique et démagogiques.
[3] Nicolas Baverez, La dissolution de la Ve République, FigaroVox, 31 août 2025.
[4] Vaisseau : du latin tardif vascellum, « urne, petit vase ; vaisselle », prenant au XIIe siècle les sens de « récipient » et de « navire », mais également au XIVe siècle, celui de « conduit transportant des liquides organiques » (Dictionnaire de l’Académie française, 9e édition). Le vaisseau de l’État, c’est un récipient ou un conduit, qui transporte ce fluide organique irriguant la nation que l’on nomme peuple.
[5] Francis Beau, De la démocratie en République, Tribune K2, 16/09/2023.
[6] Dominique Reynié, Notre crise politique menace de se transformer en crise de régime, puis en crise d’État, Figaro Vox, 06/10/2025.
[7] Francis Beau, De la démocratie à la République : une question d’autorité, Tribune K2, 20/02/2025.
[8] Dominique Reynié, op. cit.
23/10/2025