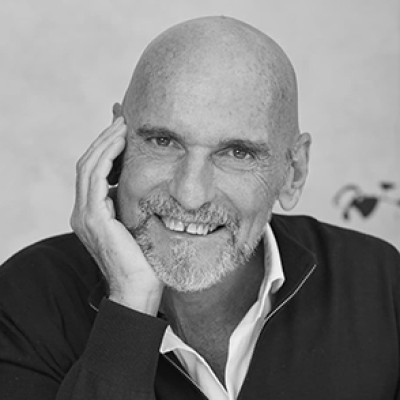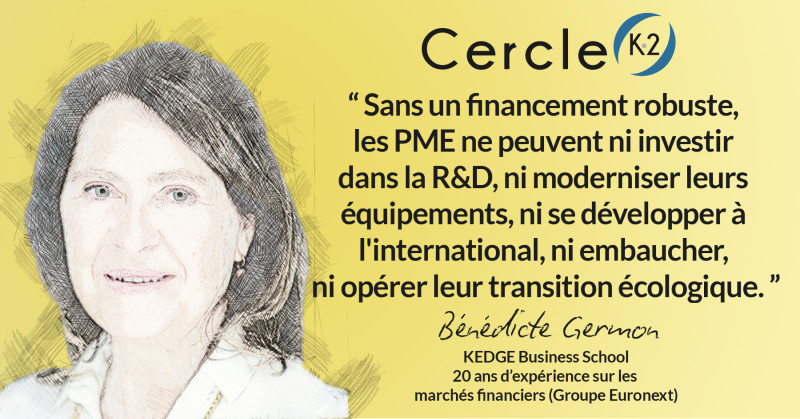De l’idéologie à la réalité : L’européanisation de l’industrie d’armement
18/07/2025 - 16 min. de lecture
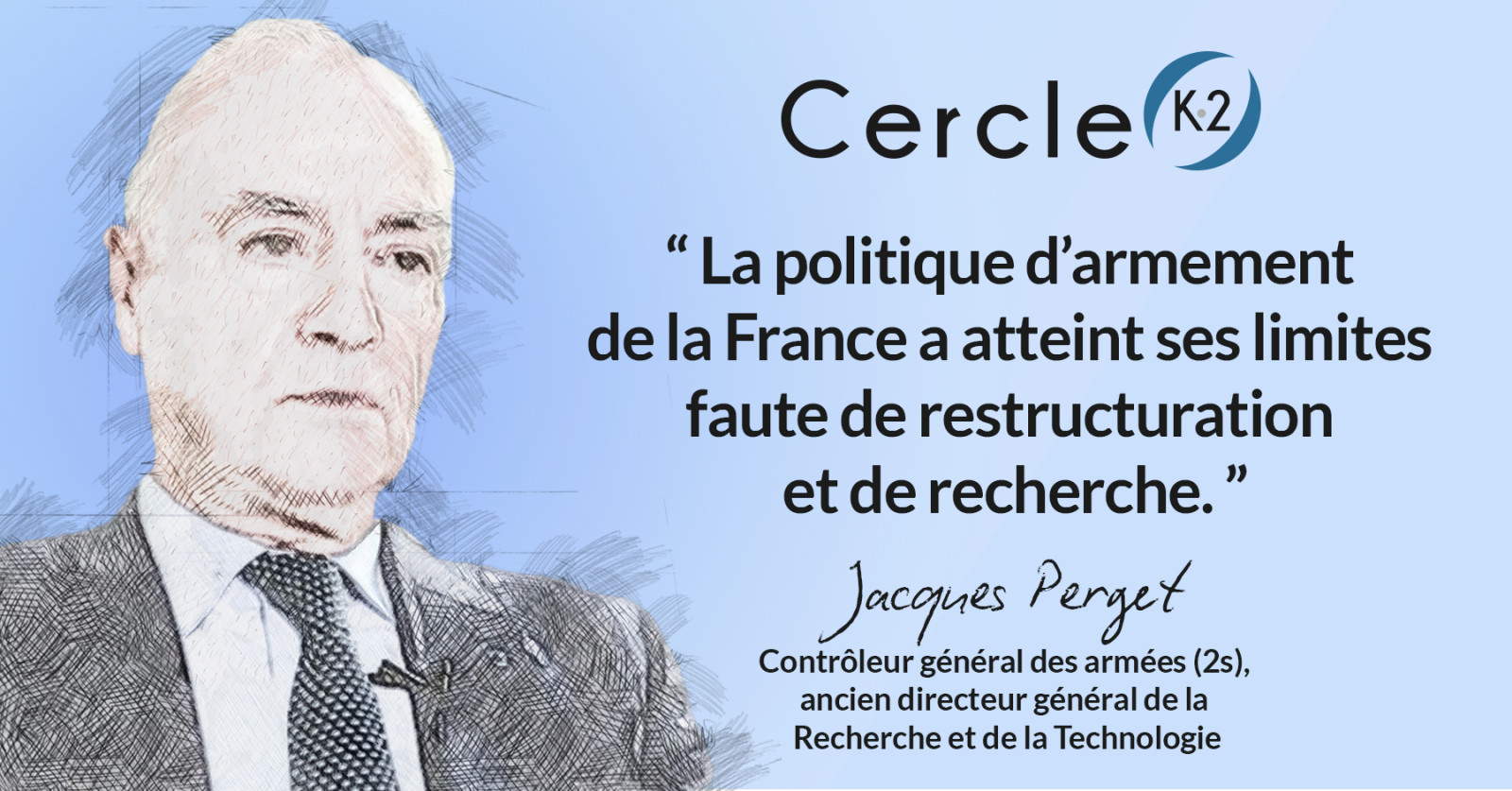
Le Cercle K2 n'entend donner ni approbation ni improbation aux opinions émises dans les publications (écrites et vidéos) qui restent propres à leur auteur.
Jacques Perget est contrôleur général des armées (2s), ancien directeur général de la Recherche et de la Technologie et ancien professeur titulaire de la chaire d’économie industrielle à Paris II.
---
I. L’ÉVOLUTION DES TRENTE DERNIÈRES ANNÉES
Au cours de ces trois décennies, le paysage de l’industrie d’armement en Europe s’est transformé de manière radicale.
Initialement dominée par des préoccupations d’intérêt national, la politique des Etats s’est «libéralisée » sous le double effet de la pression des idées favorables à une ouverture des marchés et de la volonté de faire une Europe de l’armement. C’est ainsi qu’a été adopté un principe de coopération systématique et de formation d’entreprises transnationales au lieu et place des programmes nationaux des Etats, alors que ceux- ci avaient fait la preuve de leur efficacité dans la période d’après- guerre du moins dans les pays qui en avaient fait le choix.
En outre, la diminution dans certains pays des moyens alloués à la Défense – diminution justifiée par les circonstances « les dividendes de la paix » – a précipité un mouvement de restructurations industrielles. Le ralentissement de la commande nationale a en effet poussé les firmes à rechercher – notamment par le biais de la sous-traitance et de la coopération – des modes d’organisation plus souples pour profiter de conditions de coût plus avantageuses à l’international, aussi bien en Europe que hors d’Europe. A noter que cette baisse des crédits répondait aussi à une préoccupation de nature politique et idéologique: la volonté de «libéraliser» les Etats, de manière à préparer et faciliter le passage à un Etat fédéral européen!...
C’est sur ces considérations que l’industrie d’armement – au départ activité de souveraineté limitée aux trois ou quatre Etats européens dominants – a été remodelée pour constituer un réseau étendu à une part plus grande du territoire de l’Union.
Aujourd’hui, si le réseau reste centré sur les trois majors «Royaume Uni, France et Allemagne», il s’est élargi à un premier cercle formé de l’Italie et de l’Espagne (avec lequel les relations industrielles se sont consolidées), puis progressivement à d’autres pays membres de l’U.E en tête desquels se situent les Pays Bas, la Suède, la Grèce, la Tchéquie, la Pologne, la Roumanie ou la Bulgarie…, disposant de capacités industrielles initiales pouvant être mises en relation avec leurs homologues britanniques, allemandes ou françaises 1.
Pour mesurer l’importance de la mutation opérée, l’on retiendra l’exemple saisissant de l’évolution suivie par l’industrie française, au départ – et de loin! – la plus puissante et la plus avancée en Europe dans tous les secteurs à haute technologie.
En effet, après les destructions de la seconde guerre mondiale ( avec démolitions, pillages et transferts en Allemagne), les capacités de la France ont été reconstituées sous la IVème République et plus encore sous la Vème République, dans tous les domaines (aéronautique, espace, nucléaire, électronique, informatique) intéressant la réalisation d’armes stratégiques (force de dissuasion) ou à technologie avancée (avion de combat par exemple).
Cet effort de réindustrialisation a été conduit de façon remarquable, avec des résultats spectaculaires, pour un coût jugé aujourd’hui des plus raisonnables. A ce propos, il faut rappeler que la France, alors sous embargo technologique américain dans les domaines sensibles (notamment nucléaire), a réalisé ces performances avec un souci d’indépendance voulue et assumée, et ce dans des délais extrêmement courts comme en témoignent les deux cartouches ci-après !...
***
A propos de la volonté d’indépendance
Comme illustration de cette volonté, l’on donnera les deux exemples suivants :
1/ Jusqu’au début des années «80», sur instruction datant de Michel Debré, le ministère de la défense présentait, tous les deux ans, un rapport sur les conditions de passation et d’exécution des marchés industriels de manière à prouver que l’ achat à l’étranger ne dépassait pas 5% du montant de la dépense totale.
2/ Si cette politique industrielle d’indépendance (entièrement soumise aux
préoccupations de l’intérêt national dans des domaines jugés stratégiques) a pu être suivie, c’est grâce à un effort de recherche et de développement sans précédent pour conserver les compétences et maintenir le potentiel au plus haut niveau possible: les dépenses de recherche-développement militaire ont pu représenter jusqu’à 40% du total des crédits d’investissement (titre V) des armées.
***
À propos des délais de réalisation des programmes
L’on donnera l’exemple suivant :
Entre le moment où la décision a été prise par le Général De Gaulle de réaliser la FOST (Force Océanique Stratégique)et celui où le premier SNLE (Sous-marin Nucléaire Lanceur d’Engins) a été admis au service actif, sept années seulement s’écoulèrent pour réaliser les
études, les recherches et développements nécessaires, la réalisation du prototype ( Gymnote) et la construction du Redoutable…,alors que nous étions sous embargo américain.
***
Pour autant, à partir des années «70» ( début du passage à la « libéralisation » et à la« dérégulation »économique et sociale), il a été décidé que la commande nationale devait être relayée par des exportations dont le volume permettrait d’amortir sur des séries plus longues le poids des investissements et de réaliser les matériels à des conditions économiques compatibles avec des ressources budgétaires plus limitées : en bref, la priorité « défense et souveraineté nationale » devenait ainsi seconde pour la première fois.
C’est ensuite, à partir des années «80», que l’exportation est également apparue insuffisante pour assurer la rentabilité du dispositif industriel et que – sans procéder aux restructurations préalables2 – la France fit le choix brutal et délibéré d’une politique en faveur de la coopération européenne. L’on donnera comme illustration de ce changement radical d’orientation, l’exemple de l’Aérospatiale: en 1982, les programmes nationaux de cette société représentaient 80% de son activité (contre 20% en coopération); dix ans plus tard, la proportion (national /coopération) était inversée; depuis, elle n’a cessé de se creuser!..
Ainsi, quel que soit le haut niveau de qualité atteint, la politique d’armement de la France atteignait ses limites, faute à partir des années «70» d’avoir su entreprendre les opérations de restructuration et de rationalisation de l’outil industriel, faute aussi de ne pas poursuivi l’effort de recherche et de développement. Cette évolution devait en toute logique conduire, à la fin des années «90», à la création du groupe trans national EADS, puis à celle d’Airbus; elle conduisit de la même manière, au début des années «2000» et par la suite à céder à certains partenaires européens (l’Allemagne principalement) ou extérieurs (les pays arabes… ) des capacités de production et leurs technologies. Compte tenu de l’actualité présente, avec le retour de la guerre, l’on citera en particulier le cas de l’armement terrestre, avec les armes et munitions petits et moyens calibres...
II. LA SITUATION ACTUELLE DE L’INDUSTRIE EUROPÉENNE DE L’ARMEMENT
Aujourd’hui, l’industrie de l’armement représente en Europe un ensemble de capacités reliées les unes aux autres, soit par des montages juridiques formalisant des coopérations établies (sociétés communes, participations croisées, accords commerciaux ou techniques), soit le plus souvent par un réseau de sous-traitances ou d’associations s’organisant au cas par cas à l’occasion de la réalisation des programmes.
L’on notera toutefois une concentration inégale de ce réseau. Les six pays signataires de la LOI3 (Royaume Uni, France, Allemagne, Italie, Espagne et Suède) représentent à eux seuls 75% des capacités et 90% de l’effort européen de recherche technologique.
Le degré d’imbrication et de consolidation de cette nouvelle industrie européenne est par ailleurs variable selon le secteur de l’armement: il est plus marqué dans l’aéronautique et l’espace qu’il ne l’est dans le naval ou le terrestre.
LE SECTEUR DE L’AÉRONAUTIQUE ET DE L’ESPACE
Son poids est considérable: il représente plus des deux tiers de l’effectif total et du chiffre d’affaires de l’ armement, loin devant les secteurs naval et terrestre Cette industrie s’est construite, notamment en France, en maintenant un équilibre entre les activités civiles et les activités militaires, de manière à pouvoir amortir le choc des variations conjoncturelles entre ces deux secteurs et à mieux supporter la charge financière du développement technologique. Elle forme aussi un réseau structuré au sein d’une filière de production complète, unissant autour des mêmes programmes, les grands acteurs industriels que sont les donneurs d’ordre (maîtres d’œuvre en charge de la conception des systèmes d’armes, et motoristes), les sous-traitants de rang1(systémiers spécialisés et équipementiers en charge de la réalisation de sous- ensembles complets) et les sous-traitants de rang 2 (fournisseurs des produits constitutifs).
Malgré ces atouts, la filière aéronautique et spatial est fragile. Du fait de l’ouverture des marchés nationaux, elle s’adresse à un marché dispersé, hautement concurrentiel en Europe et hors d’Europe, dominé par l’industrie américaine sur de nombreux segments (avions de combat, avions de transport militaire, spatial, etc.4); étant entendu qu’eu égard à ses capacités, son marché est à la fois mal assuré et insuffisant, conférant à la filière une précarité structurelle.
En effet, d’un point de vue industriel, sauf l’industrie européenne n’est pas d’ailleurs suffisamment consolidée pour pouvoir affronter la concurrence internationale notamment américaine. Ainsi, chez les avionneurs, identifie -t’on, cinq plate-formistes intégrateurs (Eads-Airbus, British Aerospace, Finmeccanica, Dassault, SAAB-Aéro pour le moment encore) et six systémiers équipementiers (Thalès, Safran, Smith Aerospace, Cogham, Ultra-Electronics, Indra Sistemas). Non seulement ces groupes sont concurrents, mais ils peuvent se trouver en position de conflits d’intérêts en étant
associés à la réalisation des mêmes programmes. L’on donnera à ce propos le cas de British Aerospace qui, associé partenaire à SAAB pour le Gripen et également à Airbus et Finmeccanica pour l’Eurofighter, participe en outreé à l’équipe industrielle de Loockheed Martin sur le programme américain F 35 Lightning!..
En résumé, malgré les liens établis, ce secteur reste globalement divisé, marqué par la force inévitable des antagonismes nationaux aux intérêts stratégiques et techniques différents voire divergents5; sa libéralisation a surtout conduit à renforcer son exposition à la «domination américaine» !...
LES SECTEURS NAVAL ET TERRESTRE
Plus anciens, de taille plus réduite, avec des capacités souvent dispersées, ces deux secteurs traditionnels de l’armement portent, plus que celui de l’aérospatial, le poids de l’histoire et la marque des antagonismes nationaux.
Cette situation, encouragée par l’absence de standardisation européenne et la permanence de spécifications par armée nationale, constitue un frein majeur à la constitution d’une Europe de l’armement capable d’équilibrer le potentiel aujourd’hui américain, demain chinois ou autre; elle présente de ce fait trois aspects négatifs indiscutables:
- elle favorise la pénétration commerciale et industrielle de l’UE par les concurrents étrangers non européens: pour illustration, on se reportera aux ventes de matériel américain en Europe et aux prises de participation, voire de contrôle, dont les sociétés européennes d’armement terrestre en ont fait l’objet ces dernières années;
- elle freine la conception de produits du futur adaptés à la doctrine d’emploi et aux intérêts stratégiques – souvent différents – des armées nationales;
- en conséquence, elle rend cette industrie encore plus vulnérable à la concurrence étrangère, notamment américaine.
POUR L’ENSEMBLE DU SECTEUR « ARMEMENT »
De manière générale, l’industrie d’armement en Europe souffre, en dépit de son niveau de qualité technique, de plusieurs handicaps.
Tout d’abord, son marché n’a jamais été suffisant, ni en taille, ni en stabilité, pour lui permettre de financer ses besoins de développement. Aujourd’hui, dans le contexte géopolitique de retour de la guerre, une réflexion s’impose pour ajuster ses capacités aux besoins évidents et distincts de la défense nationale et de la défense européenne.
De même, l’insuffisant effort fait par les entreprises en matière de recherche- développement et également d’innovation (conséquence de leur position commerciale trop faible et également du désengagement de la puissance publique dans
sa relation « État- Industrie» depuis une trentaine d’années) pèse directement sur leur compétitivité6 et leur aptitude à rester dans la course face à leurs concurrent américains ou autres. A cet égard, la réforme imposée par l’Union Européenne, avec la transposition en droit national de ses directives de 2008 tendant à banaliser le secteur de l’industrie de défense et à le soumettre au mécanisme de la concurrence communautaire , doit être revu pour mieux tenir compte des intérêts nationaux.
Enfin, avec le désengagement précédemment souligné des Etats (privatisation, «dividendes de la paix», et contraction des crédits budgétaires), l’industrie manque de ressources pour financer et garantir son avenir, avec souvent une insuffisance de capitaux propres au regard de son endettement. Par ailleurs, faute de protection juridique et fiscale à l’instar des USA, les entreprises européennes se trouvent fragilisées et exposées aux nombreux risques de distorsion de la concurrence dans la compétition internationale.
En d’autres termes, l’industrie d’armement en Europe, en sortant du cadre national, s’est engagée dans la constitution d’un ensemble dont les contours restent à définir, tant sur le plan proprement industriel que sur celui des finalités et de la vision poursuivies. Sa consolidation reste encore largement à opérer, mais ne pourra se faire sans un projet politique explicite de l’Union Européenne en matière de défense et d’armement, et sans non plus une implication nouvelle et prioritaire des Etats nationaux dans l’affirmation de leurs besoins propres.
III. LES PERSPECTIVES D’AVENIR
Celles-ci peuvent être appréhendées à partir des trois types de besoin que l’analyse précédente a permis d’identifier: le besoin de restructurations, le besoin de puissance publique (implication conjointe des Etats et de l’U.E) et, partant, le besoin de clarification des compétences en matière de politique industrielle entre le niveau de l’Union et celui des Etats souverains.
LE BESOIN DE RESTRUCTURATIONS
Pour consolider un tissu industriel encore trop dispersé, la réorganisation de celui-ci doit se faire autour du concept de métier à l’exemple de la politique suivie aux États- Unis dans les années 80 et 90: elle consisterait à regrouper des sociétés au même métier, soit au sein de groupes mono-sectoriels de la défense, soit au sein de groupes multi-sectoriels civilo-militaires ayant des activités différentes mais faisant appel à un même savoir-faire ou à des technologies analogues. Toutefois ces engagements n’ont de sens que s’ils permettent de réaliser des synergies. Or, sur ce point, l’existence des antagonismes nationaux qui tiennent aux différences socio-économiques et à la permanence des oppositions d’intérêts, constitue un frein – voire un obstacle– majeur. Cette donnée incontournable conduit à s’interroger sur la pertinence des «organisations transnationales» qui ont été mises en place, et se demander s’il n’aurait pas été plus préférable de constituer au niveau européen des structures plus souples de type holding, coordonnant des entreprises industrielles nationales restant autonomes.
A cet égard, l’abandon de la réorganisation du groupe EADS-Airbus proposée par Louis Gallois en 2008 est peut-être à regretter: elle aurait permis de regrouper les capacités industrielles et de recherche par pays de manière plus équilibrée (arm’s length) au sein d’entreprises nationales, celles-ci étant cordonnées par une holding ou autres accords de partenariat. Il ne saurait jamais être trop tard pour revenir sur une solution de ce type aussi opportune…
LE BESOIN DE PUISSANCE PUBLIQUE ET DE VOLONTE POLITIQUE
Ce besoin se fait doublement sentir : au niveau de l’Union Européenne qui, en l’absence d’un traité constitutionnel approprié, reste en recherche d’une assise de son pouvoir politique; également au niveau des États-membres qui, depuis le début les années «90», se sont désengagés de leurs responsabilités.
En effet, en ce qui concerne l’U.E, l’élaboration d’une politique de défense commune conduira nécessairement à la réalisation d’armements spécifiques adaptés à la doctrine d’emploi de la force armée et aux nouveaux concepts stratégiques qui se feront jour à cette occasion. Or le choix de ces armements impliquera, tant au stade de leur conception qu’à celui de leur fabrication, un engagement plus direct de l’Union à condition qu’elle soit capable d’exprimer un projet politique et géopolitique s’appliquant à l’ensemble des pays-membres. Or, l’Union Européenne en est incapable à la fois par son idéologie mondialiste et aussi sur un plan juridique faute d’une souveraineté reconnue par les Traités.
Parallèlement, au niveau des États nationaux qui sont les seuls souverains, le désengagement délibéré de ces dernières années a paradoxalement fait apparaître les limites de la privatisation et a contrario le besoin structurel de puissance publique : l’industrie d’armement, n’ayant pas accès – du moins en Europe – à des marchés suffisamment porteurs pour assurer son développement dans la stabilité, ne dispose pas de moyens (notamment en recherche technologique) pour garantir sa compétitivité dans le temps. La LOI avait pour objet de répondre à cette préoccupation. Force est de constater que son application n’a pas débouché sur des dispositions concrètes à la mesure des enjeux.
Pour cet ensemble de raisons, le réengagement de la puissance publique vis-à-vis de cette industrie est indispensable, tant au niveau des États qu’à celui de l’U.E: il s’agit d’en orienter l’activité et de la soutenir dans une compétition internationale où les rapports de force ont changé.
Ce réengagement de la puissance publique pourrait prendre les formes suivantes:
- une prise de participation des États au capital des sociétés, sous la forme au moins d’une golden share (à l’image de ce que le Royaume-Uni a fait vis-à- vis de sa propre industrie).
- un renforcement des pouvoirs et des moyens de l’AED (Agence Européenne de Défense) pour permettre à celle-ci d’exercer – en liaison avec les Etats souverains – une tutelle sur l’ensemble de l’industrie et de veiller au maintien des compétences.
- la mise à l’étude d’un statut particulier de service public industriel européen reconnu aux industries nationales sur la base de l’article 346 du T.U.E. .
LE BESOIN DE CLARIFICATION DE LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES
L’imbrication actuelle des interventions communautaires intergouvernementales et nationales, rend confuse et souvent inefficace l’action des acteurs publics.
En effet, les politiques nationales, les projets bi ou multilatéraux et, dans le cadre de l’AED, les règlements de l’U.E. ne pourront former les briques d’une politique industrielle cohérente qu’à la condition première que ces différents niveaux d’intervention donnent lieu à une véritable concertation respectueuse du principe de subsidiarité.
En conséquence, le niveau communautaire doit être réservé à l’édiction des seuls principes généraux, les Etats se réservant la liberté d’en fixer les modalités d’application pratique en fonction de leur tradition juridique et de l’intérêt national.
Le niveau intergouvernemental doit, quant à lui, être celui de la prospective et de la gestion des activités industrielles de l’Union ; à savoir:
- pour la prospective, la conduite des études et recherches exploratoires,
- pour la gestion des activités industrielles, la conduite des programmes de fabrication des matériels communs à toutes les armées européennes, ainsi que celle des programmes stratégiques propres à l’Union Européenne.
En revanche, le niveau national doit rester le cadre de compétences approprié aux matières suivantes : la gestion des compétences de souveraineté, la gestion des participations capitalistiques publiques (golden share, contrôle du capital, ...), la gestion de l’emploi industriel de défense, l’acquisition des matériels par la voie de l’importation, le contrôle des exportations, la gestion des programmes stratégiques propres à l’État concerné.
CONCLUSION
En résumé et conclusion, l’on doit comprendre que l’européanisation des industries d’armement n’avait de sens que dans la mesure où l’Union Européenne était capable de se donner un projet et une politique de défense qui lui soit propre dans le cadre de l’alliance qu’elle constitue avec les Etats membres restant souverains. Une telle politique se définit donc par rapport à celle des Etats qui la composent, en particulier par rapport à celle des quatre ou cinq Etats qui jouent un rôle prépondérant. Or ceci n’a pas été le cas.
En d’autres termes, les perspectives de constitution d’une industrie européenne, rationnelle et justifiée sont étroitement liées à l’élaboration d’une stratégie de l’Union Européenne, dépassant la seule préoccupation de l’intégration des capacités nationales dont l’agrégation ne saurait tenir lieu de projet.
Faute de s’être placée sur ce plan, l’européanisation de l’industrie d’armement a eu des conséquences et effets plus négatifs que positifs en particulier pour la France: elle a abouti à un réseau d’interdépendances industrielles paralysantes et limitées dans sa capacité de production, comme en témoignent la situation de la défense européenne et celle des Etats dans le contexte actuel de guerre.
---
1. On notera à ce propos le rôle joué par France-Conversia dans les pays de l’Est à partir du début des années 90 pour la reconversion de leurs capacités industrielles
2. À la différence de la France, nos partenaires européens les plus proches (Allemagne, Grande- Bretagne, Italie) ont au cours de cette période (fin des années 70 et décennie 80) procédé à de vastes opérations de rassemblement et de concentration par métiers (British Aerospace en Grande- Bretagne, Dasa en Allemagne, Finmeccanica en Italie) avant d’envisager de participer à des structures de coopération industrielle européenne.
3. La LOI (Letter Of Intent ) est la lettre d’intention engageant à la fin des années 1990 les six pays signataires cités à s’entendre pour préserver le potentiel de l’industrie d’armement en Europe.
4. De ce point de vue, le segment des drones, pourtant en plein développement, est particulièrement illustratif de cette différence de dynamisme entre les marchés américains, européens, moyen- orientaux et asiatiques.
5. Ainsi,sur les différences techniques de normes et de méthodes pouvant exister entre la France et l’Allemagne, l’on se référera aux difficultés rencontrées pour l’assemblage de l’A400Mqui en ont menacé la réalisation.
6. Il s’agit ici de la compétitivité -volume des firmes, et non pas seulement de la compétitivité- prix mentionnée ci-dessus .
18/07/2025