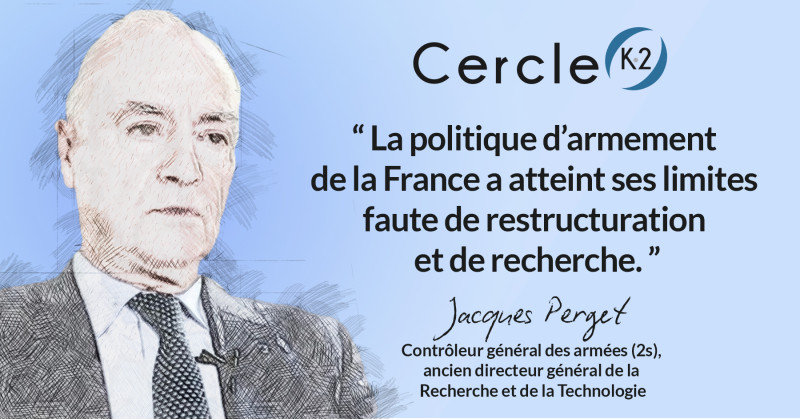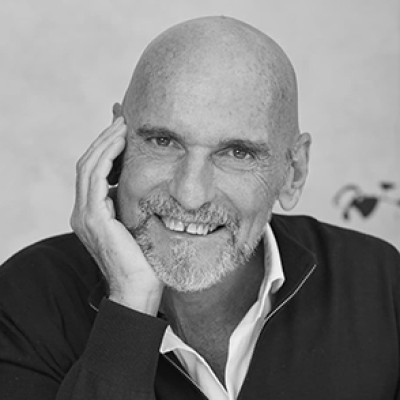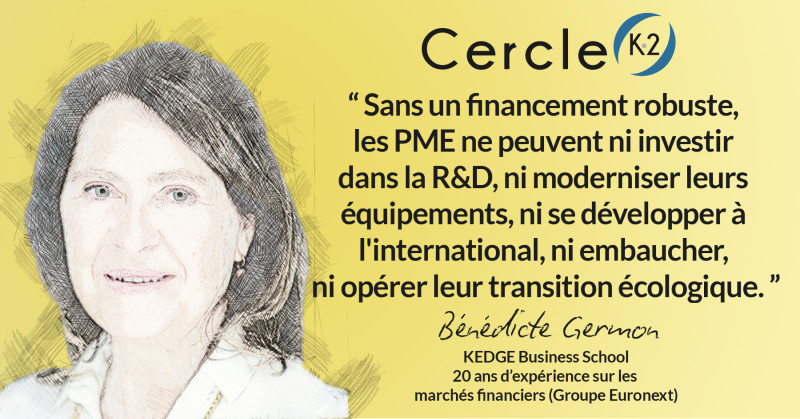Diplomatie française en Afrique : repenser l’alliance pour un avenir partagé
21/07/2025 - 19 min. de lecture

Le Cercle K2 n'entend donner ni approbation ni improbation aux opinions émises dans les publications (écrites et vidéos) qui restent propres à leur auteur.
Imen Chaanbi est experte en géopolitique et veille stratégique.
---
Depuis plusieurs décennies, la relation entre la France et l’Afrique s’inscrit dans une dynamique complexe, traversée par des enjeux historiques, politiques, économiques et culturels majeurs. Ancienne puissance coloniale ayant façonné le destin de nombreux pays francophones, la France voit aujourd’hui son influence remise en question, tant sur le plan diplomatique qu’économique et symbolique. La diplomatie française en Afrique est à la croisée des chemins, face à des transformations géopolitiques, sociales et économiques qui redessinent les rapports de force sur le continent.
Un héritage colonial pesant et un modèle diplomatique en crise
L’histoire entre la France et l’Afrique est marquée par la colonisation, un passé lourd de contradictions, d’inégalités, mais aussi d’interactions culturelles et économiques qui ont laissé des traces durables. Bien que la décolonisation ait officiellement mis fin aux liens coloniaux, les relations postcoloniales ont souvent conservé des dynamiques asymétriques, marquées par une forme d’ingérence perçue par certains comme « paternaliste », et par d’autres comme relevant d’un « néocolonialisme ». Le concept de « Françafrique » illustre cette ambiguïté : un réseau d’influences politique, économique et militaire, souvent opaque, au service des intérêts français mais critiqué pour ses conséquences sur la souveraineté et la démocratie en Afrique.
Aujourd’hui, ce modèle est remis en question à plusieurs niveaux. Sur le terrain, la présence militaire française en Afrique de l’Ouest diminue progressivement, comme en témoigne le récent retrait des troupes françaises du Sénégal, marquant la fin d’une période durant laquelle la France s’appuyait sur des bases stratégiques majeures dans la région[1]. Politiquement, la France doit composer avec une jeunesse africaine dynamique, critique et en quête d’identification à des projets de développement plus autonomes. Sur le plan économique, la concurrence chinoise, américaine, russe, turque ou des pays du Golfe, mais aussi l’émergence d’entrepreneurs africains, modifient profondément le paysage des partenariats.
Un contexte géopolitique bouleversé et une compétition renforcée
Dans un monde multipolaire, l’Afrique s’impose comme un terrain clé où se jouent des enjeux majeurs d’influence internationale. La Chine y déploie une diplomatie économique agressive, fondée sur d’immenses investissements dans les infrastructures, une présence commerciale croissante et une communication adaptée aux aspirations locales. Les États-Unis, quant à eux, déploient une stratégie multifacette alliant coopération sécuritaire, développement économique et diplomatie.
La Russie intervient notamment à travers des partenariats sécuritaires et des campagnes d’influence informationnelle, particulièrement en République centrafricaine et dans la zone sahélo-saharienne.
Par ailleurs, les pays du Golfe, notamment l’Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis, intensifient leur présence sur le continent via des investissements stratégiques, une coopération économique renforcée et un engagement diplomatique ciblé, attirant également l’attention grâce à leur influence religieuse et culturelle. D’autres acteurs, comme la Turquie, affichent une diplomatie plus pragmatique et culturelle, séduisant des populations jeunes et urbaines.
Face à cette compétition intense, la diplomatie française se trouve à un défi stratégique : comment renouer avec les sociétés africaines sans reproduire les schémas d’ingérence du passé ? Comment se repositionner comme un partenaire égal, fondé sur le respect des souverainetés et la construction d’intérêts communs ? Cette redéfinition implique une transformation profonde des instruments diplomatiques, de la coopération militaire et économique, ainsi que de la manière dont la France engage le dialogue avec les Africains, notamment via une diplomatie publique modernisée et numérique.
La diplomatie publique française : un levier en pleine mutation
Historiquement dominée par des approches institutionnelles et étatiques, la diplomatie française s’oriente désormais vers une stratégie plus horizontale et inclusive. Le rôle des acteurs non étatiques tels que les sociétés civiles, diasporas, entrepreneurs, influenceurs numériques occupe une place centrale. Des initiatives telles que la Saison Africa2020 en France[2], qui a mobilisé plusieurs millions de participants autour de la richesse culturelle et économique africaine, ou le Sommet Afrique-France de Montpellier[3], centré sur la jeunesse et la société civile sans la présence des chefs d’État, incarnent cette nouvelle orientation.
Cette diplomatie publique[4] cherche à construire un récit alternatif à celui des anciennes relations coloniales, valorisant les convergences, l’innovation, la co-construction et l’égalité. Elle se confronte cependant à une guerre informationnelle féroce, notamment avec la diffusion massive de messages russes et chinois qui contestent l’influence française à travers des canaux cryptés, des médias locaux et les réseaux sociaux. Par exemple, en République centrafricaine, la radio Lengo Songo[5] et des influenceurs sur Telegram[6] ou Facebook véhiculent des messages qui remettent en cause la présence et l’action françaises.
Cette réalité contraint Paris à repenser ses stratégies de communication en développant des médias francophones ciblant la jeunesse, s’inspirant de formats innovants tels que Brut ou Konbini[7]. Cela passe également par le soutien à la création de contenus originaux via des centres dédiés, comme la Maison des mondes africains et des diasporas[8] à Paris, ainsi que par le renforcement de la présence digitale des ambassades, afin de construire une identité numérique forte et adaptée aux attentes de leurs publics.
Pour y répondre, la France devra miser sur la création de médias numériques jeunes, des projets culturels innovants et le renforcement des liens avec les diasporas. Dans ce contexte complexe, la France est poussée à repenser en profondeur sa présence en Afrique.
Vers une nouvelle diplomatie française en Afrique
La nécessité d’une reconstruction profonde de la diplomatie française en Afrique s’impose aujourd’hui comme une évidence. Cette transformation ne se limite pas à un simple ajustement des méthodes ou à une révision des alliances stratégiques. Elle engage une refondation globale qui suppose de tourner la page d’un passé lourd d’héritages coloniaux, de dépasser le soupçon d’ingérence pour établir une relation d’égal à égal, et de moderniser les outils diplomatiques dans un monde bouleversé par les nouvelles technologies et la compétition globale.
Se départir de l’héritage colonial : un impératif diplomatique
L’un des principaux défis de la diplomatie française réside dans la capacité à se défaire de son héritage colonial. Cette tâche est loin d’être anodine, car elle engage non seulement des politiques publiques, mais aussi des représentations symboliques et narratives profondément ancrées, tant en France qu’en Afrique.
Depuis la décolonisation, la France a souvent maintenu des relations privilégiées avec ses anciennes colonies à travers ce que l’on a appelé la « Françafrique »[9]. Or, ce modèle est aujourd’hui largement critiqué et rejeté par une opinion publique africaine de plus en plus consciente des enjeux de souveraineté[10].
Il ne s’agit plus seulement de transformer ces relations, mais de les réinventer pleinement, en menant un véritable travail de décolonisation des imaginaires et des discours. La diplomatie publique française doit s’engager dans une reconstruction symbolique et narrative profonde. Elle doit refléter un effort authentique pour rééquilibrer le récit, en restituant la parole aux Africains, en valorisant la richesse et la diversité de leurs trajectoires, et en reconnaissant pleinement le rôle stratégique du continent africain dans l’avenir mondial.
C’est un premier pas indispensable pour rompre avec les anciens schémas asymétriques et établir les bases d’une diplomatie fondée sur l’égalité, l’écoute mutuelle, et la réciprocité.
Construire une relation d’égal à égal : dépasser le soupçon d’ingérence
Passer à une diplomatie d’égal à égal implique une redéfinition profonde des partenariats économiques, politiques et institutionnels. Le temps où la France imposait ses modèles, ses priorités et ses solutions est révolu. Le nouveau paradigme doit être celui de la co-construction, fondée sur une compréhension mutuelle des besoins et des intérêts.
Dans ce contexte, la transformation des relations économiques est centrale. Historiquement, la diplomatie française s’appuyait largement sur des échanges asymétriques : importation de matières premières africaines, exportation de produits finis français, et soutien à des entreprises souvent peu intégrées localement. Aujourd’hui, la concurrence d’autres puissances, notamment la Chine et la Turquie, met en lumière les limites de ce modèle.
Comme le souligne Christophe Bigot, ancien ambassadeur de France, « les entreprises françaises doivent désormais s’engager dans une logique de création de valeur locale ». Cela signifie qu’elles doivent investir dans des chaînes de valeur africaines, créer des emplois, favoriser les transferts de compétences, et soutenir les écosystèmes locaux d’innovation. Ce virage vers une « co-industrialisation » ou une industrialisation partagée est non seulement un impératif économique, mais aussi un levier pour restaurer la confiance.
La diplomatie française doit également élargir ses interlocuteurs. Les États africains restent des partenaires essentiels, mais la société civile, les diasporas, les jeunes entrepreneurs et les start-ups prennent une place croissante. Ces acteurs représentent les dynamiques d’innovation, de changement social et d’engagement citoyen qui façonnent les sociétés africaines contemporaines.
Pour incarner cette approche, il est nécessaire de dépasser le soupçon d’ingérence qui plane encore souvent sur les actions françaises. La relation doit s’établir dans la confiance, le respect des souverainetés, et une transparence accrue. Cela suppose également de rompre avec les pratiques opaques héritées du passé, notamment dans les réseaux d’influence politique ou économique qui ont longtemps caractérisé les relations bilatérales.
Modernisation de la diplomatie publique : valoriser les diasporas et repenser les stratégies
L’évolution de la diplomatie française en Afrique passe aussi par une modernisation de ses outils et de ses modes d’action. Dans un monde globalisé et numérique, la diplomatie publique ne peut plus se limiter à la communication institutionnelle classique ou aux visites officielles traditionnelles.
Aujourd’hui, l’écosystème diplomatique français inclut un large éventail d’acteurs : les ambassades, les opérateurs culturels comme l’Institut français ou Campus France, les entrepreneurs, les influenceurs, les médias numériques, et les réseaux de la diaspora africaine en France.
La diaspora africaine, riche et plurielle, joue un rôle stratégique majeur. Au-delà de son poids économique et culturel, elle constitue un relais précieux pour la diplomatie française, notamment dans le domaine du renseignement cognitif[11]. Il permet de mieux comprendre les motivations, les narratives locales, et d’anticiper les évolutions politiques ou sociales.
Par ailleurs, le réveil africain, marqué par une affirmation renouvelée des identités culturelles et linguistiques, pousse de plus en plus les Africains à se rapprocher de leurs diasporas. Ces affinités partagées facilitent les échanges, renforcent la confiance mutuelle et créent des passerelles naturelles entre le continent et ses diasporas. Ce phénomène constitue un levier précieux pour la diplomatie française, qui peut s’appuyer sur ces liens pour nourrir un dialogue plus authentique et mieux informé avec les sociétés africaines. Grâce à leur double ancrage culturel et à leur connaissance fine des réalités africaines, les diasporas apportent ainsi des insights essentiels pour adapter les stratégies diplomatiques et mieux répondre aux défis du terrain.
Pourtant, malgré cette valeur ajoutée, la diaspora reste encore sous-représentée dans les institutions françaises et insuffisamment intégrée dans la conception et la mise en œuvre des politiques diplomatiques. Une mobilisation plus forte et mieux organisée de ces acteurs serait un atout majeur pour une diplomatie publique rénovée, plus efficace et plus proche des réalités africaines.
Le retrait des troupes françaises d’Afrique : un tournant stratégique et symbolique
Un des événements majeurs qui illustre la reconfiguration en cours de la diplomatie française en Afrique est le retrait progressif, puis quasi-généralisé, des troupes françaises de plusieurs pays du continent. Ce désengagement militaire, amorcé au Sahel puis étendu à l’Afrique de l’Ouest, marque la fin d’une époque où la France maintenait une présence militaire permanente sur le sol africain, souvent perçue comme le vestige d’une influence postcoloniale.
Après les départs successifs du Mali (2022), du Burkina Faso (2023), puis du Niger (2024), c’est au tour du Sénégal d’avoir mis fin à l’accueil des forces françaises sur son territoire, décision officialisée en 2024 par les autorités sénégalaises nouvellement élues. Ce retrait, volontairement coordonné avec les autorités locales, s'inscrit dans une dynamique de réajustement stratégique de la France, désormais fondée sur des partenariats "à la demande" et non sur des implantations permanentes. Le Tchad, longtemps considéré comme un bastion essentiel de la présence française dans le Sahel, a lui aussi acté le retrait des dernières unités françaises en 2025, clôturant ainsi un cycle historique d’interventions militaires entamé avec l’opération Épervier en 1986.
Ce retrait illustre une transformation profonde dans la manière dont la France envisage désormais son engagement sécuritaire en Afrique : il ne s’agit plus de maintenir des bases militaires permanentes, mais de privilégier des formes de coopération régionales, un appui ciblé aux armées locales, ainsi que des actions de formation et de soutien menées dans le cadre de mandats africains ou multilatéraux.
Au-delà de l’aspect opérationnel, cette évolution véhicule un message politique fort : la France affirme sa volonté de respecter pleinement la souveraineté des États africains, de renoncer à toute logique de tutelle militaire, et de promouvoir une architecture de sécurité collective conduite par les Africains eux-mêmes, notamment à travers des cadres régionaux comme la CEDEAO ou l’Union africaine.
Ce désengagement ne peut donc être réduit à un simple repli tactique : il constitue un tournant symbolique majeur dans les relations franco-africaines et ouvre une nouvelle séquence, dans laquelle la crédibilité des partenariats se mesurera à leur capacité à reposer sur le respect mutuel, l’égalité stratégique, et leur pertinence face aux priorités exprimées par les sociétés africaines.
Des perspectives de coopération renouvelées
Alors que la diplomatie française amorce sa nécessaire refondation en Afrique, il est essentiel d’illustrer cette transformation à travers des exemples concrets et des projets structurants. Ces perspectives de coopération renouvelée incarnent une diplomatie partenariale, centrée sur l’impact local, le respect des souverainetés, et la construction de relations durables. Ces projets ne se limitent pas à des accords bilatéraux classiques ; ils sont conçus pour répondre aux défis du développement, à la modernisation économique, aux enjeux environnementaux et à la sécurité collective.
Le Sénégal : un partenariat stratégique pour l’innovation éducative et agroalimentaire
Le Sénégal, acteur majeur de l’Afrique de l’Ouest, est un partenaire privilégié dans la nouvelle dynamique diplomatique française. Le pays bénéficie d’un potentiel important dans les secteurs du numérique, de l’éducation et de l’agro-industrie, qui sont au cœur des ambitions franco-africaines.
Le projet de création d’un campus technologique franco-sénégalais illustre cette vision. Ce campus doit devenir un hub d’innovation, combinant formation en intelligence artificielle, développement durable, et agriculture intelligente. Il vise à former des talents capables de relever les défis locaux tout en intégrant les standards internationaux.
Sur le plan agroalimentaire, la coopération s’oriente vers la transformation locale des produits agricoles phares du Sénégal, notamment l’arachide, le riz et les fruits tropicaux. La France s’engage à soutenir les investissements conjoints dans des infrastructures agro-industrielles, favorisant la création de chaînes de valeur régionales compétitives.
Enfin, le soutien à l’initiative Dakar Hub éducatif ambitionne de positionner le Sénégal comme une plaque tournante régionale pour la formation professionnelle et technique, dans une logique inclusive et tournée vers la jeunesse.
Le Rwanda : un modèle pour la coopération en cybersécurité et innovation numérique
Le Rwanda est un exemple emblématique d’une Afrique qui investit résolument dans le numérique et l’innovation. Ce pays, souvent surnommé la « Singapour de l’Afrique », offre un terrain fertile pour un partenariat stratégique avec la France.
La coopération porte notamment sur la cybersécurité, un enjeu crucial pour la souveraineté numérique des États africains. Ensemble, la France et le Rwanda peuvent développer des infrastructures sécurisées, telles que des data centers souverains, et renforcer la formation spécialisée en intelligence artificielle et en sécurité informatique.
Le Kigali Innovation City, écosystème d’entreprises technologiques et de start-ups, bénéficie déjà d’appuis français, tant financiers que techniques. Ce partenariat reflète une volonté d’accompagner les ambitions africaines en matière d’innovation, dans un esprit de partage des connaissances.
Par ailleurs, ce partenariat peut aussi symboliser une réconciliation mémorielle importante. Après la reconnaissance des responsabilités françaises dans le génocide de 1994, ce travail commun contribue à construire une mémoire partagée, fondée sur la vérité et la coopération.
L’Afrique du Sud : diplomatie scientifique et environnementale au service du futur
L’Afrique du Sud, puissance économique et scientifique du continent, constitue un partenaire naturel pour développer une coopération dans les domaines de la santé publique, de la transition énergétique, et de la recherche.
Des laboratoires conjoints franco-sud-africains sont envisagés, visant à renforcer la lutte contre les épidémies et à accélérer les innovations biotechnologiques. Cette collaboration s’inscrit dans une logique de partage des compétences et des ressources, afin de répondre aux défis sanitaires communs.
Sur le plan environnemental, la France et l’Afrique du Sud peuvent co-construire des projets ambitieux autour de l’hydrogène vert, un vecteur d’énergie propre et renouvelable. Le développement conjoint de filières industrielles dans ce secteur innovant positionnera les deux pays comme acteurs clés de la transition énergétique africaine.
De plus, le programme sud-africain de formation d’ingénieurs bénéficie d’un appui via des filières partagées avec les grandes écoles françaises, renforçant ainsi la formation de talents capables de répondre aux défis techniques et industriels du continent.
Le Maghreb : pilier stratégique d’un partenariat euro-méditerranéen renouvelé
Le partenariat avec le Maghreb, notamment le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et la Libye, s’inscrit dans une perspective régionale et méditerranéenne. L’objectif est de développer une plateforme industrielle intégrée, capable de relocaliser certaines chaînes de valeur stratégiques dans les secteurs de l’automobile, du textile, et de l’énergie.
Cette coopération vise à renforcer les capacités industrielles régionales, à créer des emplois, et à favoriser les échanges intra-africains. Pour ce faire, la France propose la mise en place d’un fonds d’investissement tripartite (France–Union européenne–Maghreb), destiné à soutenir les start-ups à vocation panafricaine.
Parallèlement, la coopération s’étend à des enjeux sécuritaires majeurs, en particulier la lutte contre l’immigration illégale et le trafic de stupéfiants, qui demeurent des défis cruciaux pour la stabilité régionale. La France entend renforcer ses partenariats avec les autorités maghrébines pour développer des actions concertées de contrôle des frontières, de lutte contre les réseaux criminels, et de prévention.
Par ailleurs, la gestion de l’eau constitue un autre volet essentiel. Le Maghreb, confronté à des défis croissants en matière de ressources hydriques, bénéficiera du savoir-faire français en traitement et réutilisation des eaux, dans un contexte où l’adaptation au changement climatique est devenue une priorité régionale.
La CEDEAO élargie : vers une diplomatie de sécurité collective africaine
Au-delà des États pris isolément, la diplomatie française doit s’appuyer sur les organisations régionales, comme la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), pour renforcer la sécurité collective.
Une des priorités est la formation commune des forces de défense dans des centres régionaux, sous mandat africain, afin de remplacer progressivement la présence des bases militaires françaises. Cette approche favorise la légitimité et la souveraineté des États, tout en garantissant une capacité opérationnelle collective.
Un autre axe est la co-construction d’un commandement régional de cybersécurité, avec un appui technique français, pour faire face aux menaces numériques qui se multiplient.
Enfin, la coopération en matière de renseignement stratégique partagé, dans un cadre institutionnel africain et non bilatéral, est envisagée pour renforcer la prévention des crises et la stabilité régionale.
La France et l’Alliance des États du Sahel : d’une rupture stratégique à une coopération possible ?
La rupture entre la France et l’Alliance des États du Sahel (AES)[12] , regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger marque une reconfiguration géopolitique majeure en Afrique de l’Ouest. Alimentée par une défiance croissante à l’égard de la présence militaire française, jugée inefficace et paternaliste, cette rupture s’est traduite par des expulsions diplomatiques[13], la dénonciation des accords de défense, et un repositionnement stratégique des États sahéliens vers de nouveaux partenaires comme la Russie, la Turquie ou l’Iran.
Toutefois, cette sortie de la sphère d’influence française ne signifie pas une fermeture à toute coopération future. Une collaboration renouvelée reste envisageable, à condition d’un profond changement de posture de part et d’autre. Du côté français, cela impliquerait de rompre avec toute logique de tutelle pour privilégier une démarche partenariale reposant sur l’écoute, la reconnaissance pleine des souverainetés africaines et une meilleure prise en compte des dynamiques politiques actuelles.
Quant aux pays de l’AES, une stabilisation institutionnelle, une définition claire des calendriers de transition et une volonté affirmée de renouer le dialogue à l’international constitueraient des conditions favorables à la réouverture de relations constructives.
Des champs concrets de coopération existent déjà : cybersécurité, lutte contre la désinformation, éducation, développement économique ou gestion partagée des migrations. Ces enjeux transversaux pourraient servir de socle à une relation apaisée, dépolitisée et plus équilibrée, dépassant les logiques de confrontation pour bâtir un partenariat fondé sur des intérêts partagés et une vision coconstruite de la stabilité sahélienne.
Refonder la diplomatie française en Afrique, un impératif stratégique
La diplomatie française en Afrique est à un tournant décisif. Elle ne peut plus s’appuyer sur un modèle hérité du passé colonial, façonné par la verticalité et le paternalisme. Face aux aspirations croissantes des sociétés africaines et à l’émergence de puissances concurrentes comme la Chine, la Russie, la Turquie ou les pays du Golfe, la France doit bâtir un partenariat d’égal à égal, fondé sur la confiance, la co-construction et la réciprocité.
La perte progressive de l’influence exclusive de la France en Afrique ne doit pas être perçue comme une fatalité, mais plutôt comme un signal fort, appelant à une transformation en profondeur de ses approches diplomatiques. Dans un monde devenu multipolaire, rester pertinent sur le continent implique de repenser le discours, de faire preuve de lucidité face aux zones d’ombre d’une histoire partagée, et surtout de redonner la parole aux Africains eux-mêmes : à leur jeunesse, à leurs diasporas, à leurs entrepreneurs, à leurs sociétés civiles.
La légitimité de la parole officielle française est aujourd’hui souvent mise en doute. Le discours institutionnel est parfois perçu comme distant, technocratique, voire moralisateur, ce qui freine l’instauration d’un dialogue franc et sincère. Il devient donc essentiel d’incarner davantage cette parole, de renforcer la transparence, et d’occuper pleinement les espaces numériques où se forgent désormais les opinions, les imaginaires et les récits concurrents.
Dans ce contexte, la diplomatie publique[14] française doit impérativement évoluer. Elle doit sortir du seul cadre institutionnel pour devenir plus directe, plus accessible, plus digitale. Elle doit être capable non seulement de répondre aux campagnes de désinformation, mais surtout de construire un dialogue authentique, constant et crédible avec les opinions publiques africaines. C’est à ce prix que la France pourra refonder des liens solides, équilibrés et tournés vers l’avenir avec le continent.
Sur les plans économique et environnemental, la France se doit de dépasser les logiques d’aide unilatérale ou de relations déséquilibrées, pour adopter une posture de co-développement véritablement partenariale. Cela suppose de soutenir la transformation industrielle locale, de renforcer les chaînes de valeur africaines, et de s’engager avec les États du continent dans une lutte commune contre le changement climatique.
En somme, la France doit faire un choix historique : se réinventer pour incarner une puissance moderne, solidaire et respectueuse, ou bien risquer un recul stratégique durable sur un continent-clé du XXIe siècle.
Le moment est venu d’écrire un nouveau récit, d’assumer une nouvelle posture, et de proposer une alliance repensée avec l’Afrique. Car c’est dans la construction de ce futur commun que la France retrouvera toute sa légitimité, non plus comme puissance tutélaire, mais comme partenaire engagé et acteur du long terme.
« La France ne peut être la France sans la grandeur »[15] ! Aujourd’hui, cette grandeur ne se mesure plus à la domination, mais à la capacité à forger des alliances fondées sur le respect mutuel et la souveraineté partagée.
C’est ainsi que se construit l’avenir avec l’Afrique. Un avenir que la France écrira à ses côtés !
---
[1] lien
[2] lien
[3] lien
[4] lien
[5] La radio Lengo Songo est identifiée comme un média pro-russe et hostile à la France, parfois qualifié de « sous‑traitant » au service de l’influence de Moscou en Centrafrique. https://lengosongo.cf/
[6] Les opérations d’influence russes sur Telegram et réseaux sociaux, notamment dans le cadre du projet Lakhta, sont destinées à façonner narratives anti-occidentales, notamment anti-françaises.
[7] Konbini est un média digital français fondé en 2008, principalement destiné aux millennials et aux générations Z- https://www.konbini.com/fr/.
[8] Le projet de la Maison des mondes africains (MansA), prévue à Paris à l’automne 2025, constitue un dispositif culturel et médiatique dédié aux diasporas et aux jeunes créatifs africains.
[9] Ce réseau d’influence mêle relations politiques, économiques, militaires et culturelles.
[10] Il est perçu comme une « forme de néocolonialisme, marquée par des interventions politiques souvent perçues comme arbitraires et un soutien controversé à certains régimes » -François-Xavier Verschave, auteur de La Françafrique : le plus long scandale de la République (1998), qui dénonce l’ingérence française en Afrique comme une forme de néocolonialisme.
[11] Ce dernier désigne la collecte et l’analyse d’informations qualitatives liées aux perceptions, comportements, dynamiques sociales et culturelles d’un groupe ou d’une société.
[12] L’Alliance des États du Sahel (AES) a été fondée en septembre 2023 par les trois pays dirigés par des juntes militaires.
[13] Expulsion de l’ambassadeur de France au Mali en 2022. En 2023, au Burkina Faso, la junte militaire dénoncera les accords de défense, départ des troupes françaises. Quant au Niger, la junte expulsera l’Ambassadeur de France et mettra fin aux accords militaires en 2024.
[14] Rapport sur la diplomatie publique française, Institut Montaigne, 2024.
[15] Citation du Général Charles De Gaulle, discours de Bayeux (16 juin 1946) et l’ouvrage Mémoires de guerre (1954).
21/07/2025